à
FRANÇOIS ELLENBERGER
FONDATEUR DU COMITÉ FRANÇAIS D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE
(C O F R H I G E O)
CAROZZI (A. V.) : Préface
DURAND-DELGA (M.) : Du marteau à la plume : l'itinéraire scientifique de François Ellenberger
GOHAU (G.) : François Ellenberger : le retour aux sources
Bibliographie scientifique de François ELLENBERGER
GEZE (B.) : La guerre des trois n'aura pas lieu
ELLENBERGER (F.) : Les leçons toujours actuelles de l'histoire de la géologie
TORRENS (H.) : Pour prendre congé
Ouvrage édité sous la direction de Gabriel GOHAU, Président du Comité français d'Histoire de la Géologie (COFRHIGEO)
Cordonnateur : Jean GAUDANT
Voir aussi les articles publiés en 2000, après le décès de François ELLENBERGER :
|
Au moment où le Président Francois Ellenberger a choisi de prendre du recul et de veiller à la bonne marche du Comité français d'Histoire de la Géologie depuis la tribune d'honneur, il a été décidé de lui rendre l'hommage que mérite son action en publiant un recueil d'articles destinés à résumer sa brillante carrière, à la fois de géologue et d'historien de la géologie et à faire revivre des souvenirs de jeunesse qui remontent à une période où la science pouvait encore être vécue avec humour. Trois des textes qui composent le présent opuscule sont issus de la réunion extraordinaire que le Comité français d'Histoire de la Géologie avait organisée le 17 mai 1995 pour célébrer les quatre-vingts ans de son fondateur. Le quatrième, qui est dû à la plume de Gabriel Gohau, notre nouveau président, montre tout à la fois l'originalité et l'importance de l'œuvre d'historien de François Ellenberger. Une bibliographie qui se veut exhaustive et l'ultime adresse présidentielle du président sortant, qu'il considère comme son testament historico-scientifique, complètent le présent hommage.
Il n'est pas inutile de préciser ici que la majeure partie des articles présentés à François Ellenberger le 17 mai 1995 a été réunie dans un ouvrage distinct intitulé De la Géologie à son Histoire, édité par le Comité des Travaux historiques et scientifiques (CTHS), sous la direction de Gabriel Gohau. Son contenu s'est enrichi de deux articles nouveaux dûs à Michel Durand-Delga et à Bernard Gèze qui avaient présenté le 17 mai 1995 respectivement une biographie de François Ellenberger et un texte de souvenirs humoristiques, tous deux insérés dans le présent opuscule.
Nous avons apporté tout notre soin à la préparation de ce fascicule, comme le faisait lui-même François Ellenberger lorsqu'il éditait les volumes annuels de nos Travaux. Nous espérons vivement que vous éprouverez un vif plaisir à le lire, à le relire et à en méditer les leçons toujours actuelles...
Remerciements.- La saisie informatique et la mise aux normes des manuscrits ont été assurées avec compétence et bonne humeur par Mme Dominique MAUGER dont la collaboration a été vivement appréciée. Melle Colette WADIER et Mme Françoise RANGIN ont également participé activement à l'édition de ce volume dont la couverture a été illustrée avec talent par M. Philippe RABAGNAC. Enfin, la gestion financière du projet a été assumée par M. Goulven LAURENT, Trésorier du Comité français d'Histoire de la Géologie.
Jean GAUDANT
Secrétaire du Comité français d'Histoire de la Géologie (COFRHIGEO)

François Ellenberger, Paris, 17 mai 1995 (cliché D. Serrette)
Il me semble opportun comme préfacier de cet opuscule qui honore notre estimé et très cher François Ellenberger, de retracer l'évolution d'un aspect particulier de ses idées.
Je pense naturellement et égoïstement à son évolution personnelle dans l'interprétation de l'œuvre de Horace-Bénédict de Saussure (1740-1799). Ce fut une agréable surprise et une grande joie pour moi de trouver le portrait de ce savant genevois sur la couverture du second volume de l'Histoire de la Géologie (1994). Ce portrait est accompagné d'un texte élogieux plaçant de Saussure comme l'égal des plus grands géologues et comme un pionnier essentiel de la tectonique. Pour dire vrai, je m'attendais plutôt au portrait d'un autre contemporain francophone de Gottlob Werner et James Hutton comme par exemple Dolomieu.
J'ai longuement réfléchi au contexte de ce choix. Autour de 1983, quand j'ai commencé à connaître personnellement François Ellenberger, il me semblait que son image de Saussure était encore celle, stéréotypée, d'un voyageur fameux, explorateur des Alpes, scientifique complet de haut niveau, et remarquable écrivain scientifique.
Que s'est-il donc passé entre 1983 et 1994 dans la pensée de François Ellenberger? Oserais-je supposer, sans trop de présomption, que mes travaux, qui ont révélé l'évolution de la pensée d'un auteur ancien au cours de son existence, ont pu influencer celle d'un auteur vivant?
L'œuvre de Horace-Bénédict de Saussure sur laquelle je me suis penché depuis plus de vingt ans est un de ces cas trop rares où des circonstances matérielles et historiques ont permis la préservation d'un corpus entier comprenant les publications, les manuscrits inédits, les notes intimes et la correspondance. L'étude de ses manuscrits inédits permet de retracer en détail les étapes de l'évolution de sa pensée scientifique qui aboutit à son concept fondamental des «refoulements latéraux antagonistes» dans le plissement des Alpes et des chaînes de montagnes en général. Cette vision prophétique de la tectonique tangentielle moderne, selon les mots mêmes de François Ellenberger, n'apparaît presque pas dans les fameux Voyages dans les Alpes... par suite d'une transposition composite et incomplète des idées de Saussure.
Au fil des années, alors que je poursuivais et publiais l'analyse des manuscrits inédits de Saussure, j'ai cru déceler, dans mes nombreux échanges avec François Ellenberger, tectonicien lui-même, un changement graduel d'appréciation de la contribution de Saussure qui a fini par prendre graduellement, dans son esprit, sa stature réelle et fondamentale de pionnier de la tectonique.
J'ai ainsi compris pour la première fois que François Ellenberger est un historien sans préjugés qui se refuse à présenter une histoire simpliste et tronquée, comme il l'écrit lui-même. Cette attitude admirable exige un rare esprit, souple et ouvert, capable de faire face à des phases rétrogrades ou prophétiques tout aussi dramatiques que celles subies par certains protagonistes de cette même histoire dont il analyse la trajectoire.
L'attitude si peu répandue A'«historien sans préjugé » n'est en réalité qu'un aspect de la personnalité de François Ellenberger car bien d'autres qualités primordiales étaient requises pour écrire une Histoire de la Géologie comme la sienne. Citons en premier lieu son respect absolu pour les sources primaires. Quelle que soit la langue originelle dans laquelle les textes sont écrits, il a tenu à éliminer sans pitié les nombreuses citations secondaires erronées et maintes fois reproduites dans des travaux superficiels qui encombrent inutilement l'histoire de la géologie. Ainsi, si de nombreux historiens en quête de sujets d'étude imaginent dans leur ignorance que la géologie est une science facile, les écrits de François Ellenberger sont désormais là pour les détromper.
A cette qualité fondamentale s'ajoute sa remarquable capacité à analyser les textes en profondeur. L'évaluation d'une œuvre exige d'avoir acquis préalablement une connaissance de la personnalité de son auteur, de son éducation, des documents qu'il a consultés, de sa correspondance, etc., c'est-à-dire d'avoir en quelque sorte tenté de se glisser «dans sa peau » car sa pensée doit être replacée dans le contexte scientifique, social, politique et religieux de son temps. C'est ce qu'a magnifiquement réalisé François Ellenberger.
N'oublions pas non plus que François Ellenberger a toujours su être pour ses confrères une source inépuisable d'informations car, si l'on prend la peine de solliciter son aide, sa réponse arrive bientôt, documentée et fiable. Il est ainsi, d'une certaine manière, une banque de données dotée d'une âme et d'une bonté qui embrasse, comme il le dit souvent, «tous ses frères » en recherche.
Pour conclure, le compliment le plus sincère que je puisse lui faire est de lui exprimer ici mon sentiment que son Histoire de la Géologie marque à la fois la fin d'une longue période pendant laquelle la référence ultime à laquelle on était naturellement tenté de se reporter était The Founders of Geology d'Archibald Geikie et le début d'une nouvelle ère où l'on a déjà commencé à se dire : «Consultons V Histoire de la Géologie d'Ellenberger» ! C'est le plus vibrant hommage personnel que je puisse lui rendre !
Albert V. CAROZZI
Conseiller étranger du Comité français d'Histoire de la Géologie (COFRHIGEO)
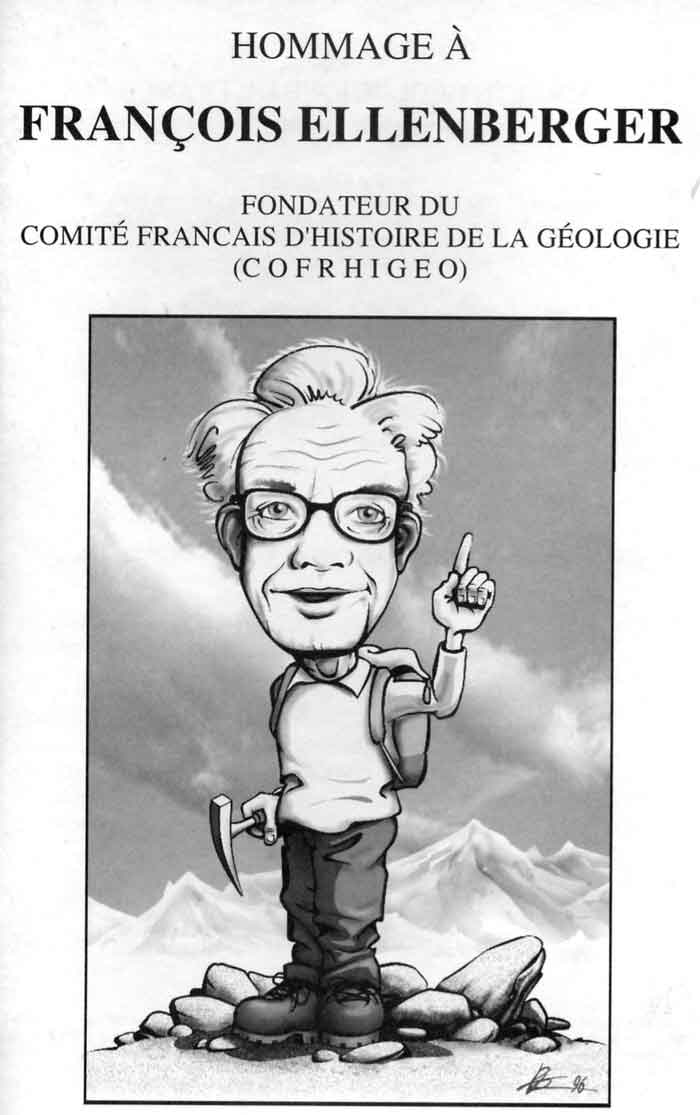
Illustration de couverture : Philippe RABAGNAC
Cher François Ellenberger, vieil et fidèle ami, permets-moi de paraphraser ci-après l'hommage que Maurice Lugeon rendait à August Buxtorf voici près d'un demi-siècle. Ce message s'adresse évidemment à toi, en ce jour commémoratif, mais aussi à ceux qui nous entourent et surtout à ceux qui nous ont succédé —je n'ose dire, qui nous ont suivis ! —, en les invitant à dépasser un instant le nombrilisme lié à la condition humaine.
Tous «doivent se rappeler chaque jour qu'il y a plus de morts que de vivants, que presque tout ce que nous savons, nous le devons aux disparus ; ce que nous sommes et avons été, nous [en] sommes redevables bien plus à ceux qui nous ont précédés qu'à nous-mêmes, encore vivants. Nous avons suivi le chemin péniblement, mais avec joie, tracé pour nous dans les broussailles de l'inconnu ; nous avons à notre tour cherché à défricher la forêt des mystères, mais les plantes recroissent sans cesse; des arbres inconnus remplacent ceux qui bornaient notre vue sur des pays lointains que nous n'avons pu atteindre, et il en sera toujours ainsi. Insatiable, l'homme de science poursuit sa marche et, quand il croit avoir atteint l'objet de ses poursuites, il voit d'autres objets dont il voudrait encore comprendre la signification, la position dans l'harmonie des choses. Il veut un nouveau jouet. Restons donc de ces grands enfants ».
Et, à mon tour et m'adressant à toi, j'ajouterai : « Toi, vieil et fidèle ami, tupeux regarder fièrement en arrière. La tâche que tu as accomplie est grande, très grande, et en ce faisant tu as eu des moments de grande joie ; peut-être as-tu atteint l'extase par moments» : n'aurait-ce pas été le cas lorsque, le 11 juillet 1948, tu découvris les fossiles du «Dogger à Mytilus» dans l'empilement fantastique, jusqu'alors resté insoluble, des assises de la Vanoise ? « Tu as eu bien des récompenses. Tu as ajouté des pierres bien taillées [...] au grand édifice du savoir [...]. A côté de ton métier, je devrais dire de ta vocation d'homme de terrain, tu as été le maître respecté, suivi par des disciples qui t'ont fait honneur». Ces récompenses sont infiniment plus précieuses que le clinquant provisoire des honneurs universitaires ou académiques dont on se soucie peu lorsqu'on évoque ceux qui nous ont précédés dans l'aventure scientifique.
Quand on jette un regard rapide sur ton itinéraire, on peut s'étonner que le géologue de terrain ardent et à la pensée si originale que tu fus, à la clarté des chaînes de montagne ou dans les garrigues languedociennes, ait fait place à celui qui, dans le silence de son cabinet, a développé et organisé en France une branche jusqu'alors peu pratiquée, l'histoire de la géologie. Et pourtant ce désir de scruter les pensées de nos prédécesseurs est sous-jacent dans tous les textes des trente premières années de ta carrière. Par la suite, la joie d'étudier les orogènes a fait place progressivement à la jubilation de celui qui, « comme Ulysse après un long voyage » est revenu se placer au foyer de ses aïeux par l'esprit, afin d'y passer « le reste de son âge».
Ce long voyage, voyons-en les étapes singulières.
Première singularité de cette vie qui en fourmille que d'avoir respiré un air et côtoyé des êtres si différents de ceux que la plupart d'entre nous, citoyens des villes ou campagnards du vieux pays de France, avons connus dans notre enfance.
François Ellenberger a vu le jour le 5 mai 1915 à Lealui, sur le haut Zambèze. C'est une localité de Rhodésie du Nord, l'actuelle Zambie, à dix mille kilomètres de la vieille Europe. L'heureux enfant vécut ses douze premières années en pleine nature, instruit par une mère passionnée d'histoire et par un père qui, Correspondant du Muséum, s'intéressait à tous les aspects du monde vivant et du règne minéral. Ce dernier, missionnaire et ethnologue, était lui-même né au siècle dernier dans l'ancien Basutoland, devenu en 1966 le royaume indépendant du Lesotho, enclavé en pleine Afrique du Sud. C'est dans ce même Lesotho que plus tard, de 1955 à 1963, François Ellenberger organisera des missions du C.N.R.S. Son frère Paul, devenu missionnaire après son père, avait découvert là de riches sites d'ossements et des pistes de Vertébrés primitifs, Dinosauriens en particulier, dans les grès continentaux du Stormberg (Trias supérieur - Lias) qui couronnent le célèbre Karroo. Bornons-nous à rappeler l'intérêt des résultats qu'obtiendront les frères Ellenberger, en particulier le fait que les successions dans le temps des pistes de Vertébrés sont analogues en Afrique du Sud et en France.
Montauban et Grésigne. - Ce n'est un secret pour personne que François Ellenberger appartient à une famille de religion réformée. Ainsi s'explique-t-on que, dès 1928, il se retrouve à Montauban, vieille citadelle du protestantisme, «ville de sûreté» avant d'être démantelée par Richelieu et livrée aux dragonnades... Le voilà pensionnaire à l'Institut Jean-Calvin, où bientôt le rejoindra son frère Paul, plus jeune de quatre ans et demi. C'est là qu'il passera son baccalauréat, alors en deux parties, en 1932-33, avant d'y être répétiteur, durant les années de préparation à la Licence.
Après ses études secondaires, François Ellenberger suivra en effet à la Faculté des Sciences de Toulouse l'enseignement de deux maîtres exceptionnels : en zoologie, Albert Vandel, biologiste adepte du mobilisme wegenérien ; en botanique, Henri Gaussen, un créateur de la phytosociologie. En géologie, le contact se fera surtout avec Gaston Astre, claudicant assistant du professeur Louis Mengaud. Astre l'influença durablement grâce à son savoir encyclopédique sur tous les aspects de la nature.
Montauban. Le Tarn est bordé là de hautes et vieilles demeures en brique rose qui se reflètent dans ses profondes eaux. Des hauteurs de Saint-Martial ou du chêne de Beauso-leil, on devine à l'orient les masses surbaissées de la Grésigne. Les deux frères Ellenberger distinguent «le velours turquoise de la vieille forêt [...] et la ligne pure des grandes voûtes». C'est leur lieu d'évasion certains dimanches : le petit train, aujourd'hui disparu, qui remonte en rive sud le cours de l'Aveyron, les amène avec leurs vélos au pied du site de Bruniquel, célèbre par ses abris sous-roche paléolithiques, aux portes de la mystérieuse forêt.
La beauté des paysages inspire à l'adolescent des accents poétiques [texte inédit, fin des années 30] : « Grésigne ! Collines bleues à l'horizon de l'Est, croupes rondes, massives qui dominent [...] la houle des replis successifs du Bas-Pays... ; leur forte assiette évoque la solidité des vieilles constructions... Mystère de l'éternelle forêt, calme tranquille et majesté, puissance des savantes courbes, galbe absolu, parfaite sculpture des âges sans nombre... Trente kilomètres d'air moelleux, d'abîme horizontal métamorphosent la substance même des êtres lointains. Certainement c'est la vraie nature du monde qui transparaît dans le bleuté des horizons ; vous ne pouvez la posséder en y allant : l'analyse détruira le charme... Collines bleues de la Grésigne, comment pourrais-je vous avoir à moi... ? Je veux vous visiter, en pèlerin avide. J'ai soif du monde».
Le voilà donc, pédalant vers la Grésigne. Et, perçant le voile mystérieux dont l'entoure son esprit romantique, il en découvre les aspects concrets. Le rêveur fait place, et peut-être à regret, à l'analyste méthodique et scrupuleux.
L'automne 1945 amènera la convergence, en Grésigne, de trois jeunes géologues qui successivement en ont étudié séries et structures. Bernard Gèze, l'aîné, venu de Montpellier, François Ellenberger, arrivant des Cévennes — le pays de sa mère — , et l'auteur de ces lignes, proche «albigeois», entamons notre amicale et longue «complicité». Lors d'une course près du dolmen de Vaour, à discuter d'une singulière dépression garnie d'une macrobrèche basique dont la genèse est toujours incertaine, Gèze et moi restons stupéfaits devant l'extraordinaire agilité d'un homme qui, trois mois plus tôt, souffrait des conditions éprouvantes de prisonnier de guerre...
De Toulouse à la Rue d'Ulm. - Reçu en tête d'un concours pour obtenir une bourse de licence, François Ellenberger aura souvent la coquetterie de rappeler la médaille de vermeil de l'Association des Anciens Elèves de la Faculté des Sciences de Toulouse, qui lui fut décernée en 1936. Il est admis à l'Ecole Normale Supérieure en 1935 et, avant d'obtenir en 1937 l'agrégation des Sciences naturelles, il aura soutenu le Diplôme d'Etudes supérieures qui précédait alors le concours d'agrégation.
C'est dans le laboratoire de Léon Bertrand et sous la responsabilité officielle, fort détachée, de Louis Barrabé, qu'il réalise en 1936 une étude de sa chère Grésigne. En une cinquantaine de pages, il donnera l'année suivante à la Société d'Histoire naturelle de Toulouse, dont Gaston Astre est la cheville ouvrière, ses observations et ses conclusions tectoniques. Cinq ans plus tard, jeune étudiant à Toulouse moi-même, j'ai été placé sur cette même région par Bernard Gèze, qui venait d'excellemment décrire l'évolution hydrogéologique du proche Quercy. Le 6 décembre 1943, dans Paris occupé et grelottant de froid, le hasard veut que deux notes concurrentes sur la Grésigne soient présentées devant la Société géologique. Elles sont l'œuvre de deux prisonniers, l'un dans son camp d'Autriche, l'autre dans sa geôle temporaire d'Espagne : premier contact inconnu d'un long itinéraire parallèle, scientifique et professionnel ! Relisant aujourd'hui les travaux d'Ellenberger, l'on est frappé par leur degré d'exactitude et par la profondeur de raisonnement de ce géologue d'à peine vingt ans. Un demi-siècle plus tard, on constate que seules des retouches ont pu être apportées à son tableau.
La Grésigne, accident singulier, est un petit «pli de fond», comme aurait dit Emile Argand, d'énergie verticale kilométrique. Ellenberger [1937] lie au plissement de ce massif jusqu'à l'air libre l'accumulation, essentiellement à l'Oligocène, de puissants conglomérats qui, à l'Aquitanien, seront chevauchés vers le sud par le cœur permien et secondaire du massif. Même si la précision de ces datations, qui sont en général retenues, a fait l'objet de discussions, l'image essentielle reste. La Grésigne résulterait du «coulis sèment profond du Quercy» à l'extrémité du faisceau de failles de Villefranche, terminaison sud du grand accident brisant du Nord-Nord-Est au Sud-Sud-Ouest le Massif Central français. Ellenberger, retrouvant certains enseignements d'Emmanuel de Martonne, observe aussi les restes disséqués d'une ancienne surface d'érosion perchée, qui a subi la dernière déformation anticlinale de la Grésigne. Seule prémonition non vérifiée, mais comment l'imaginer alors? Le «noyau cristallin» qui pourrait marquer l'axe du pli n'existe pas, comme l'a montré par la suite un forage profond qui a traversé trois kilomètres de grès rouges permiens au cœur de l'anticlinal.
Dans son ardeur, Ellenberger effectue ensuite [1938a] la comparaison de la Grésigne avec la Montagne Noire (la vraie, celle des occitans!), bourrelet montagneux qui barre l'horizon au Sud des collines de l'Albigeois. Retrouvant l'intuition d'André David, normalien — géographe, lui — fauché à la fleur de l'âge en 1915, Ellenberger observe le premier et définit la grande «faille de Mazamet » : fracture inverse E-W amenant ce « petit pli de fond typique» qu'est la Montagne Noire à surmonter les molasses continentales de l'Eocène supérieur-Oligocène qui s'étaient accumulées à son pied nord. Ainsi Grésigne et Montagne Noire, tous deux plis de fond subcontemporains, se font face; ils chevauchent l'un vers l'autre, à quelque quarante kilomètres de distance horizontale. Ellenberger y voit la «répercussion des paroxysmes pyrénéens», loin au Nord de la chaîne. Cinquante ans après, rien de tout cela n'est démodé.
Ses études sont achevées. Il commet l'erreur de ne pas retarder son service militaire. Aspirant officier à l'Ecole d'Artillerie de Fontainebleau (1937-38) — d'où son premier regard sur «les polis éoliens des rochers de grès» [1938b] —, il choisit ensuite le 105e régiment d'artillerie de Bourges, où sa famille est alors établie. Et naturellement il arpente la campagne voisine, en s'intéressant à la genèse des cavités à minerais de fer pisolitique, objet de remarques qui resteront, celles-là, inédites.
1940-45. - Voilà notre ami plongé dans les problèmes de sa génération : 22 juin 1940, à Saint-Dié, le sous-lieutenant Ellenberger, comme la majorité des soldats de la 5eme Armée française, se retrouve prisonnier de guerre. Le camp d'Edelbach (Oflag XVII A) se situe en Basse-Autriche, à cinquante kilomètres au Nord de Krems sur le Danube. Les champs de bataille d'Austerlitz, de Wagram, ne sont pas loin mais cette fois les débris de l'armée française se retrouvent derrière les barbelés... Pendant la captivité, Ellenberger va se consacrer à étudier l'aspect géomorphologique et les quelques données géologiques observables dans ce carré de quatre cents mètres de côté. Le camp est isolé en pleine campagne, sur le plateau du Waldviertel, la «Sibérie autrichienne». Cinq ans durant, les officiers prisonniers tournent en rond, dégazonnant dans leur marche incessante le sol, déjà usé et altéré, établi sur les unités moldanubiennes de la chaîne varisque. Une véritable «université de captivité» se constitue, avec recteur (le mathématicien Jean Leray) et directeur d'études en Sciences naturelles (le biologiste Etienne Wolff). Outre les conférences et cours en équipe, qui aboutirent à de vrais certificats de Licence-ès-Sciences, Ellenberger dirige certains camarades d'infortune au sein d'un «laboratoire» de pétrographie. Un petit microscope polarisant bricolé va permettre l'examen de quelque trois cents lames minces, collées sur des lames de verre à vitre. L'examen de fouilles d'évasion permet quelques observations précises des gneiss polymétamorphiques du substratum, véritables tectonites injectées, ultérieurement soumises à des processus siliceux épither-maux. Un lambeau de sables et cailloutis éocènes ( ?) révèle des débris de «grès lustrés» à plantes. On exhume des bois silicifiés oligo-miocènes, avec définition d'un «chêne d'Edelbach» ! Trois fragments de bélemnites sont les témoins du transport de fragments mésozoïques, sur le socle de Bohême. Et aussi d'innombrables débris préhistoriques et archéologiques.
Tels sont les résultats de ce labeur, qui paraîtrait dérisoire dans sa durée s'il n'était héroïque. A la «petite France» — point le plus haut, au Sud-Ouest du camp — «les prisonniers aimaient à [...] rêver le soir en contemplant avec nostalgie le couchant et l'horizon Ouest très dégagé», vers la patrie perdue...
Cette extraordinaire et peut-être unique expérience scientifique fut réalisée de façon quasi-clandestine. Un petit volume : Métamorphisme, silicifications et pédogenèse en Bohême méridionale en fut tiré [1948a]. Dans sa préface, Eugène Wegmann évoque cette aventure en ces termes : «à l'aide d'une synthèse de méthode et d'improvisation, de caractère éminemment français, aidés par un entêtement d'origine bernoise... » : le préfacier évoque ici les origines de la famille paternelle d'Ellenberger. Avec Wegmann, on ne peut que partager étonnement et profonde admiration pour ces patients efforts, dominant les heures de découragement liées à cette longue captivité. Il en résultera des considérations originales sur les rapports entre tectonique et métamorphisme dans ce vieux socle. On peut y voir l'origine de l'attrait pour les « zones profondes » qui restera constant dans l'activité d'Ellenberger.
Une telle expérience laissa évidemment une marque profonde sur cet homme qui fut ainsi, de 25 à 30 ans, empêché d'obéir à sa vocation de géologue de terrain parcourant de vastes espaces libres. Au printemps 1945, je ne me doutais pas quand l'unité de commandos parachutistes dont je faisais partie plantait ses fanions au col de l'Arlberg, porte du Tyrol, que non loin au Nord-Est de là, mon aîné François Ellenberger et ses camarades, entourés de soldats ennemis encore armés, «se traînaient, épuisés et affamés, sur les routes», en rapportant sur leur dos des kilos de documents, de préparations et d'échantillons, tirés de deux années d'efforts soutenus...
Le 12 mai 1945, au terme de 7 ans et 7 mois sous l'uniforme, notre héros est démobilisé. Le voilà donc revenu en France, engagé comme Agrégé-Préparateur au laboratoire de Géologie de la rue d'Ulm, dirigé par Louis Barrabé. Plus tard, en 1949, il sera nommé Chargé de Recherche au C.N.R.S., puis Maître de Recherches en 1956, après sa thèse.
C'était l'époque où de vives discussions s'instauraient entre géologues parisiens sur les rapports entre Crétacé et Tertiaire aux portes de la capitale. Ellenberger s'intéressa ainsi à la célèbre «craie à tubulures » de Meudon, qu'il assimila à un banc-limite, suivi d'une lacune sous-marine. D'autres se querellaient sur la signification du fameux «calcaire pisolitique» de Vigny... Vieux débats, qui ne sont pas encore totalement obsolètes !
La solide formation pétrographique reçue à l'Ecole Normale Supérieure puis développée en captivité amène Ellenberger à s'attaquer, dans les Alpes françaises, à un sujet difficile, encore presque vierge : la Vanoise. Il souhaite étudier le front externe, occidental, du métamorphisme alpin, aux confins entre Briançonnais et «Schistes lustrés». Rapidement il s'aperçoit que la stratigraphie, presque inconnue, de ces formations plus ou moins transformées et très tectonisées est une clé indispensable. Cette discipline devient donc «centre et base de ce travail». Soucieux d'obtenir de bonnes préparations, il est conduit à tailler de ses mains les roches qu'il veut dater ou étudier. Il va jusqu'à monter un atelier de fortune en montagne ! Ainsi peut-il reconnaître des reliques de microfaunes, parfois conservées à l'intérieur d'albites néoformées dans les «marbres chloriteux» de Vanoise. Il arrive ainsi à reconnaître toute une série de niveaux insoupçonnés, du Dogger — découvert en 1948, c'est l'illumination! — au Paléocène. Son exploit le plus extraordinaire réside dans la datation de plusieurs horizons dans les roches carbonatées triasiques, par dégagement ménagé à l'acide acétique, prolongé des jours durant, de plus de cinquante espèces de Mollusques et d'Algues Diplopores, qui permettent de définir une «province briançonnaise» (on trouve le mot dès 1949), intermédiaire entre mer germanique et mer alpino-dinarique. La méthode de dégagement en est, dit-il, «affaire de patience, de loisirs et d'acide» ! On pourrait ajouter : d'un extraordinaire esprit de suite et d'un déconcertant optimisme.
Nous sommes en haute montagne, en grande partie au-dessus de 2000 mètres. Ellenberger cartographie méthodiquement une surface de mille quatre cents kilomètres carrés. Tout l'homme se trouve dans ces phrases : «La joie demeure, joie de la lutte, joie de comprendre [...], joie des départs à l'aube et des retours sain et sauf à la nuit tombée, bonheur immérité de découvertes inattendues».
Son mémoire, « déjà trop lourd» confesse-t-il, signe le renouveau de la pensée française sur les Alpes après la Seconde Guerre mondiale : une époque d'or où voisinent cordialement Jean Fabre, Marcel Lemoine, d'autres encore. Cette thèse est un travail de maturité : Ellenberger a 39 ans quand il la soutient en 1954 à Paris. Cartographie détaillée et stratigraphie, appuyée par une solide paléontologie, en constituent l'ossature. Il en ressort mille faits nouveaux. Détachons l'appartenance au Briançonnais de la masse de la Vanoise, sur laquelle le large charriage des «Schistes lustrés» est maintenant prouvé ; la définition d'une zone intermédiaire entre les deux précédentes, celle que caractérise le «Lias prépiémontais » de la Grande Motte, défini en 1948 ; l'étonnante ressemblance de séquence et de faunes entre les séries de la Vanoise et celles des Préalpes médianes, en Suisse, actuellement allochtones mais dont la position d'origine est ainsi argumentée, contrairement aux interprétations suisses d'alors. L'auteur a cependant exprimé ses «sentiments d'insatisfaction profonde» devant des «recherches perpétuellement inachevées»: le mythe de Sisyphe renouvelé ! Cependant des idées générales, telle la notion de «substitution de couverture », s'avèrent satisfaisantes : un recouvrement allochtone (les « Schistes lustrés») remplaçant la couverture stratigraphique antérieure du substratum, préalablement éliminée, d'un domaine plus externe (le Briançonnais).

Fig. 1. -Le pot de thèse de François Ellenberger à l'Ecole Normale Supérieure (28 juin 1954). Le nouveau docteur entre son père Victor Ellenberger (à gauche), et Bernard Gèze (à droite). (Cliché P. Mémin).
Ellenberger aborde aussi un redoutable sujet qui a suscité des querelles plus que centenaires : les «gneiss du Sapey» ! Ces roches sont intercalées en un feuillet d'au plus trois cents mètres d'épaisseur, sur cinquante kilomètres de long, entre les «schistes et grès » du Carbonifère supérieur et le « Néopermien » détritique, apparemment discordant. Qualifiées de «migmatites du Sapey», elles résulteraient d'une singulière migmatisation latérale, pouvant aboutir à des granitoïdes renfermant des enclaves des roches affectées. Pour lui, « ces roches gneissiques sont nées, au Permien moyen, sous un toit probablement peu puissant et au-dessus du Mouiller intact». Cette audacieuse interprétation fut discutée : ainsi E. Niggli et Nabholz préféreront y voir, lors de la Réunion extraordinaire de la Société géologique de France en septembre 1954, une lame tectonique d'un orthogneiss d'origine granitique ; on montrera ultérieurement le caractère composite de cet ensemble, qui comporte des reliques de socle métamorphique anté-namurien. Mais la situation géométrique de ces « gneiss du Sapey » reste bien celle qu'Ellenberger avait cartographiée.
Lors de cette célèbre réunion, qui rassembla de nombreux participants et parmi eux maints maîtres des Ecoles française et suisse des Alpes, la discussion porta aussi sur le métamorphisme alpin, dont la connaissance était encore à ses débuts en France. Pour Ellenberger, «les choses s'expliquent au mieux dans l'hypothèse d'un métamorphisme régional principalement post-tectonique, né sous une surcharge disparue» (il lance le terme de «géosynclinal de nappes»), alors que pour d'autres, tels Niggli ou Michot, le métamorphisme accompagne la mise en place des unités tectoniques superposées. La tendance d'Ellenberger est d'y voir un épisode bref, lié à la structuration synschisteuse post-nappe, lors de l'Eocène terminal ou au début de l'Oligocène. Dans son article du Livre à la mémoire du Professeur Paul Fallot (1960-63), La Vanoise, un géanticlinal métamorphique [1963d], il porte le coup de grâce à la théorie, encore dominante en France, du métamorphisme géosynclinal. Comme c'est souvent le cas, l'avenir réunira certaines des hypothèses qui s'opposaient alors sur des phénomènes qui sont, au vrai, incomplètement élucidés. En tout cas, cet épisode du métamorphisme alpin est bien de l'âge que lui assignait Ellenberger mais il semble bien qu'il a un lien avec la réalisation des nappes elles-mêmes.
François Ellenberger a avoué dans l'introduction de sa thèse — chose inhabituelle chez les chercheurs — les hésitations ou les erreurs commises au début de son enquête : il a analysé sa propre évolution en face des questions soulevées. Cela l'amène tout naturellement, dans un historique fort de 55 pages, à exposer la succession des conceptions et des motivations de ses prédécesseurs. Il est devenu leur familier, éprouvant la «joie grave et douce de sentir parfois comme [leur] présence physique [...] marchant devant lui sur le chemin ». Cette attitude respectueuse d'autrui est aux antipodes de celle de trop nombreux scientifiques de notre époque «d'apparence» qui font métier ou d'ignorer, ou de sous-estimer, ou de piller subrepticement l'apport de leurs devanciers, dans le désir puéril de grossir leurs propres résultats et de s'attirer ainsi crédits et promotions auprès de commissions dites compétentes...
Le mémoire de thèse d'Ellenberger sera imprimé dans les mémoires du Service de la Carte géologique [1958a]. C'est un véritable monument, dont la plupart des données de base et bien des interprétations demeurent. Le 13 juin 1960, le prix Viquesnel de la Société géologique lui est attribué. Mais cet énorme effort, qui a pris huit ans de sa vie, explique qu'à bout de forces, son auteur ait consacré seulement quarante pages à une « introduction » à la tectonique de la Vanoise, qu'envisageait son projet initial. Jean Goguel, qui présente le lauréat, regrettera que le considérable relevé cartographique, où seuls certains détails restent à élucider, n'ait pas abouti à son terme, malgré le désir exprimé. Il faudra attendre presque vingt ans pour que d'autres, tel J.-F. Raoult, reprennent le flambeau. Il restera pourtant attaché à sa Vanoise, en participant en particulier à la défense du « Parc national » qui y sera plus tard créé.
Ainsi s'illustre un aspect de François Ellenberger. Il estime avoir compris les énigmes essentielles des difficiles problèmes auxquels il s'est heurté. Il a réussi à mener à bien la rédaction et l'impression de son volumineux travail. Mais il a besoin de souffler et, saturé, de changer de régions et de préoccupations.
Peu de temps après sa thèse, un événement important se produit dans la vie du chercheur solitaire du CNRS, qu'a jusque là été François Ellenberger. La vague de création de postes dans les universités de France, qu'envahissent des cohortes de nouveaux étudiants, commence à déferler. Une Maîtrise de Conférences de « Géologie de terrain » est fondée à la Sorbonne : initialement confiée à Pierre Routhier, qui est rapidement conduit à épauler puis à remplacer dans sa chaire de Géologie structurale et appliquée Louis Barrabé, elle est attribuée en 1957 à Ellenberger. Le nouveau professeur a 42 ans, ce qu'expliquent ses nombreuses années sous les drapeaux puis le long parcours de sa thèse.
Epoque bénie à ses débuts où un abondant choix pouvait être opéré parmi les étudiants enthousiastes qui se pressaient aux portes des laboratoires, assiégeant spécialement les jeunes «Maîtres de Conférences» que nous étions, une demi-douzaine de nouveaux promus, à la Faculté des Sciences de Paris. Ellenberger, lui, avait la charge particulière de former à l'étude du terrain les candidats à la Licence-ès-Sciences. Il s'occupait ainsi des étudiants du certificat de Géologie historique que dirigeait Pierre Pruvost en seconde année de licence et, en troisième année, de ceux de Géologie structurale et appliquée dont L. Barrabé puis P. Routhier assureront successivement la direction. Les premiers ont pour base Lagrasse, gros bourg des Corbières au Sud de la Montagne d'Alaric : au printemps 59, ils seront 73 participants, pour neuf jours de terrain. Les années se suivant, ce seront au total des centaines d'étudiants qui courront la garrigue ou escaladeront les duplicatures de la Cagalière, accidents avant-coureurs d'âge éocène de la nappe des Corbières. Quant aux élèves de Géologie appliquée, ils seront placés sur l'arc tectonique de Saint-Chinian, qui affronte le Paléozoïque de la Montagne Noire : toujours en 1959, ils seront 89, durant quinze jours. Un groupe de joyeux assistants, tout frais émoulus de leurs études supérieures, aident Ellenberger à encadrer leurs cadets dans les deux régions. Parcourant vignes et taillis, ils traquent les limites entre formations et, à Saint-Chinian, analysent les chevauchements et «failles plates» qui recoupent la série mésozoïque-éocène. Magnifiques leçons de choses dans une nature généreuse, aux splendides affleurements offrant, comme dira Ellenberger, trop d'informations pour faciliter le raisonnement! Joyeux drilles, les jeunes parisiens s'ingénient à forger des rapports parfois houleux, souvent complices, avec la population occitane, aux abords complaisants mais intérieurement inquiète. Jugeons-en par ce texte du jeune professeur rendant compte à ses collègues sorbonnards : « un groupe qui comprenait, je le souligne, d'excellents éléments, a poussé le dynamisme jusqu'au bord de la mauvaise éducation, cela en ville ». Qu'on sache que les dits éléments avaient bloqué par des moyens variés, charrettes en particulier, les issues de Lagrasse, cité riche d'une brigade de gendarmerie... Mais l'indulgence complice du responsable suprême trouve une explication benoîte, du fait que « les étudiants commencent à être dégoûtés et révoltés par les difficultés universitaires immédiates [...]je ne leur donne pas tort». Voire...
C'est l'époque, autour de 1960, où un intense bouillonnement agite l'Aima Mater. Les vieilles enceintes craquent, les esprits s'agiteront bientôt. Un Mouvement national pour le Développement scientifique (M.N.D.S.) se crée, animé par le mathématicien André Lichnerowicz, entraîné à Paris par le futur doyen Marc Zamansky. Il recrute parmi les «jeunes » maîtres de conférence, titre alors réservé aux professeurs en début de carrière : Pierre Routhier, François Ellenberger et quelques autres succombons aux sirènes brouillonnes de notre grand aîné Louis Glangeaud, alors familier de Zamansky. Un défilé est organisé de la Sorbonne vers la «Halle aux Vins» afin de faire hâter la construction du campus de Jussieu. En tête, une brochette de professeurs en robe rouge à rangées d'hermine, coiffés de leurs hautes toques. Zamansky a passé la ceinture noire, normalement intérieure, par-dessus la robe professorale, ce qui fait très va-t-en-guerre. Une photographie parue dans un hebdomadaire, qui devait être Match, immortalise à ses côtés les professeurs «révolutionnaires», ce qui permet à un perfide journaliste de dénoncer cruellement — et à contre-temps — la sclérose de l'université ! La haute stature d'Ellenberger domine le groupe.
La nouvelle université se prépare. Le plan organisant les laboratoires (surfaces revendiquées, emplacements relatifs souhaités, aménagements intérieurs) suscite des sueurs froides chez celui qui est chargé de coordonner des demandes parfaitement inconciliables et parfois humoristiques : l'un des «responsables » plaidant pour une flottille d'hélicoptères afin de tourner au-dessus du Bassin parisien. Ellenberger, pour l'heure, s'occupe de son enseignement « de terrain » à partir du refuge que continue à lui fournir Louis Barrabé, à l'Ecole Normale Supérieure, dans son laboratoire de la rue Lhomond. Menacé d'être regroupé un jour avec certains de ses collègues, il freine des quatre fers et exige un service à part, hors des chaires dont dépendait statutairement la «Géologie de terrain». Les manifestes-circulaires pleuvent entre collègues. En janvier 1963, Ellenberger exprime sa méfiance des grandes écoles techniques — l'Ecole de Nancy, dirigée par son lointain archicube Marcel Roubault, est ainsi visée —, dont les ingénieurs-géologues sont soupçonnés de vouloir éliminer progressivement les jeunes diplômés de l'université dans les organismes publics! Il proclame son découragement devant le malthusianisme qu'il observe autour de lui : modicité des moyens, locaux vétustés, manque de collaborateurs techniques efficaces... En 1962, d'importantes modifications administratives ont lieu. Le décès de Louis Barrabé l'année précédente amène le démembrement de l'empire dont cet homme modeste avait hérité. L'ancienne chaire de «Géologie structurale et appliquée» de la Sorbonne éclate en deux. Pierre Routhier conserve l'essentiel, le grand service de Géologie appliquée. François Ellenberger obtient une nouvelle chaire, consacrée à la «Géologie des grandes régions du Globe», chargée des écoles de terrain. Ce titre bizarre résulte de l'opposition de certains augures qui n'acceptent pas de voir un jeune collègue paraître régner seul sur la Géologie structurale, dont dépend une partie de leur activité : ce qui n'empêchera pas le qualificatif contesté d'apparaître en sous-titre sur la plaquette du cours inaugural d'Ellenberger. Le 10 novembre 1962, il rappelle l'histoire de ses prédécesseurs Léon Bertrand et Louis Barrabé, se choisit un parrain supplémentaire dans la pittoresque personnalité d'Ami Boué, l'un des fondateurs de la géologie moderne... et de la Société géologique de France, dont il a découvert une rarissime autobiographie posthume, écrite anthumément, en fouillant les réserves de la Société [1962d]. Dans un style primesautier, il raille enfin la situation de sa chaire : « Qui dit chaire, dit, en général, service, laboratoire. Le nôtre existe ; il est vaste, clair, moderne, bien équipé, avec des locaux spécicdisés de toute espèce. Il existe, mais hélas! en pointillé, dans l'air, quelque part à une vingtaine de mètres d'altitude dans l'espace aérien de la Halle aux Vins, au-dessus des chais de GRAP et Dubonnet. [...] Notre beau laboratoire imaginaire a du moins un mérite, c'est de s'inscrire dans des architectures non point passées mais futures, que des voix optimistes estiment devoir se matérialiser d'ici trois ans. Jusque là, nous serons, j'en ai peur, réduits au triste sort des squatters, vivant de la charité, de l'hospitalité d'autrui... ».

Fig. 2 - Au laboratoire de Géologie de l'Ecole Normale Supérieure, en 1964. Deux ans plus tôt, François Ellenberger était devenu titulaire de la nouvelle chaire de Géologie des grandes régions du Globe (Géologie structurale). (Cliché P. Mémin).
Ainsi Ellenberger demeure-t-il cantonné à l'Ecole Normale, où un nouveau Maître de Conférences, André Jauzein, va prendre la succession du second poste de Barrabé. Position inconfortable : Ellenberger est mal à l'aise, du fait de cette situation ambiguë et de l'atmosphère délétère que font régner certains professeurs géologues de la Faculté des Sciences. Il écrit se sentir «bridé, étouffé, seul». Justification en tout cas de son départ sans tambour ni trompette, par simple transfert, dans un vrai laboratoire du nouveau Centre universitaire d'Orsay, qui coupera en 1965 le cordon ombilical de sa mère-Sorbonne. Ellenberger y trouvera des collègues aimables, en particulier dans la personne de Jan H. Brunn, ancien chercheur du CNRS, comme lui, chargé à Orsay de la Géologie historique.
C'est l'époque où la fièvre des réformes de l'enseignement supérieur commence à saisir le corps universitaire. Des commissions se réunissent, discutent indéfiniment, faisant et défaisant les projets en fonction des intérêts bien compris des commissaires. Les anciennes licences sont mises à bas : on sépare des maîtrises — ex-licences augmentées d'une année de formation — d'Enseignement, pour le recrutement des enseignants du Second degré, et des maîtrises de Recherche, pour la noblesse équestre des futurs scientifiques. Ellenberger s'élève violemment, en janvier 1966, contre cette réforme : «Il faut avoir connu (comme le soussigné) les privations et les angoisses d'un jeune étudiant obligé de subvenir à ses propres études et astreint à toutes les privations pour se révolter devant un tel système d'élimination, aussi réactionnaire et hypocrite que possible ». La crainte d'une sélection sociale le pousse à combattre une «Maîtrise en Géologie» trop spécialisée, arrangeant certains professeurs. C'est pourtant ce qui sera créé, avec la curieuse conséquence — notre protestataire ne l'avait pas prévue —, que la structure « généraliste », censée devoir devenir formation-croupion, sera suivie par le plus grand nombre et qu'y seront recrutés quantité de chercheurs de bonne qualité.
La période 1958 à 1968 est une époque d'intense foisonnement scientifique à Paris. Jusqu'en 1965, c'est dans le cadre de la Société géologique, installée au second étage du 28, rue Serpente, dans l'immeuble dit des Sociétés Savantes. Ellenberger y joue un rôle important comme mentor et porte-parole des plus jeunes. Dans la longue, étroite et sombre salle de séances qu'ont connue les plus anciens parmi nous, il intervient fréquemment sur les sujets les plus variés lors des communications orales. On le voit en particulier contrer des tentatives nomenclaturales insolites, recommandant, en particulier, l'abandon des termes de Lias, Dogger, Malm : les mânes d'Oppel ont dû frémir. Ellenberger s'élève à juste raison, l'avenir le montrera, contre ces «réformes prématurées et peu solides» : ce qui ne changera pas son allergie constante à la vogue des stratotypes.
A cette intense vie intellectuelle participent quelques grands anciens : les académiciens de l'époque ne se sentaient pas humiliés de s'asseoir parmi les moins gradés, toutefois dans les premiers rangs de l'assistance. Les jeunes membres des nouvelles équipes que la conjoncture a permis de constituer à la Faculté des Sciences font nombre. C'est une époque où de vives controverses surgissent, leur objet scientifique dissimulant mal, souvent, de vieilles inimitiés personnelles. Le soir, après la séance, des jeunes et des moins jeunes se réunissent non loin de là, dans un bistrot de la place Saint-André-des-Arts, à boire des chopes d'excellente bière en devisant gaiement. François Ellenberger grignote régulièrement des saucisses sèches et plates qualifiées de «gendarmes». Epoque bénie du point de vue de la vie collective d'une vraie communauté.
Les choses commenceront à se gâter lorsque, expulsée par le propriétaire de l'immeuble, qui n'est autre que l'Université de Paris..., la Société géologique doit vider les lieux et se réfugier dans un nouveau local, enfin trouvé grâce à l'action de grands anciens agissants, tels Raymond Furon, Jean Marçais et l'alors jeune Jean Ricour, rue Claude-Bernard. L'absence initiale de salle de réunion entraîne une errance d'amphithéâtre en amphithéâtre prêtés par l'Ecole Normale ou l'Institut Agronomique... Du coup, la désaffection, dont les causes sont d'ailleurs multiples, atteint les sociétaires, tels des oiseaux chassés de leur nid.
Durant cette période, l'activité de François Ellenberger s'exerce dans des directions variées. Il réfléchit encore à ses études alpines par des considérations sur les paragenèses du métamorphisme alpin, par une remise en question du style «pennique» d'Emile Argand auquel il préfère, pour le bâti interne des Alpes occidentales, des explications par cisaillement. Il est amené à écrire quelques mises au point, seul ou en collaboration, dans le Livre à la mémoire du Professeur Paul Fallot, sur la structure des domaines évoqués dans sa thèse et leur cadre général. Il donne un excellent article sur le Trias briançonnais, lors du Colloque sur le Trias français [1963b], qui suscite une remarque inhabituelle, de la part d'un maître de la géologie helvétique, Rudolf Trümpy : «Les géologues suisses sont pleins d'admiration pour les travaux de M. Ellenberger. Il est tout à fait remarquable que ses études sur les terrains métamorphiques de la Vanoise aient permis de débrouiller la stratigraphie du Trias non-métamorphique des Préalpes suisses». C'était en effet, en quelque sorte, le monde renversé !
En relation avec les camps de terrain, Ellenberger entreprend avec ses collaborateurs — trop nombreux pour qu'on puisse les citer— la cartographie détaillée de secteurs situés à l'avant de la nappe des Corbières, qui sera schématisée sur la feuille « Capendu », et dans l'arc de Saint-Chinian. Parmi divers résultats d'importance, il faut distinguer un article de 1967 où sont décrites Les interférences de l'érosion et de la tectonique tangentielle tertiaire dans le Bas-Languedoc... L'auteur y dessine avec soin des coupes qui purent alors surprendre : des «faillesplates» délimitent autant d'écaillés empilées vers le Nord et qui tranchent net les couches préalablement plissées. Son analyse [1967b] y reste un modèle de précision. Il est amené à s'intéresser aux limons post-nappe de ces régions, comme la «molasse de Thézan », qu'il estime pliocène, alors que l'auteur de ces lignes y voyait plutôt de l'Oligocène : cette petite querelle sera résolue par l'adoption, des deux côtés, d'un âge intermédiaire, Miocène inférieur !
On voit alors voisiner et collaborer amicalement des jeunes « diplômitifs » corbaricains des groupes d'Orsay et de la Sorbonne. Reste le souvenir nostalgique de discussions passionnées et stimulantes dans la garrigue épineuse. Je n'ai cessé d'admirer la finesse d'observation et l'acuité de réflexion de mon sympathique aîné, tout en regrettant que les rapports aient été autres avec certains éléments d'universités languedociennes s'attaquant aux mêmes problèmes, qui étaient il est vrai dans leur «royaume» administratif.
L'attention d'Ellenberger et de certains membres de son équipe se porte également sur la zone axiale de la Montagne Noire, plus précisément sur la partie sud-est des monts de l'Espinouse. Retrouvant dans ce cas d'infrastructure de l'orogène hercynien les formes en plis couchés des nappes simplo-tessinoises, il écrira en 1967 : «L'on imagine le Caroux comme formé [avant le serrage tardif qui lui a imprimé son aspect présent] de lourdes digitations gneissiques isoclinales séparées par des feuillets subhorizontaux involués plus ou moins plats de micaschistes» [1967J]. Idée qui fera son chemin, même si de nombreux autres modèles sont actuellement plaqués sur ces structures énigmatiques.
Parmi les géologues parisiens ayant, à ce jour, dépassé les cinquante ans, beaucoup se souviendront de ces années où un sujet de fixation a été constitué par «la Pinède de Durban». Nous sommes là entre le Paléozoïque du massif de Mouthoumet et le front de la nappe cisaillante des Corbières, à matériel mésozoïque. Cette nappe épiglyptique, sur relief émergé donc, a ployé sous ses avancées chevauchantes les crêts morphologiques que déterminaient les barres calcaires de l'Eocène. Mais l'interprétation de singuliers dispositifs tectoniques, visibles sur quelques kilomètres carrés, va entraîner des échanges passionnés entre deux groupes rivaux, l'un de Montpellier, l'autre de Paris. Ce qui est extrusions de calcaires aptiens à travers des couches plus jeunes pour les uns, est lambeaux allochtones pour les autres. François Ellenberger contemple, souriant, les horions que se portent les adversaires, tout en suggérant, en 1965, de pratiquer de petits forages. Proposition qui fut suivie, grâce à l'emploi en mai 1974 d'une nouvelle foreuse du B.R.G.M., dont le fonctionnement fut testé à cette occasion : cela permit de prouver, en deux points-clé, le caractère allochtone de l'Aptien contesté. L'objet du litige était si local, l'acharnement des deux camps si affirmé, que des observateurs extérieurs se demandèrent si les adversaires n'avaient pas «monté» l'affaire pour se mettre en valeur! Ce fut l'occasion d'un poème truculent de notre futur Président, utilisant à cette occasion la même veine que Maurice Lugeon dans sa «Chanson du Moine Thrust» (Lausanne, 1913). Voici donc un extrait des «Djinnologues» [1966], poème en dix-sept strophes «tiré des Orientales (Corbières) » :
En feu,
Soucis
De peu,
Eglise,
Tour grise,
Balise
Des gueux.
Sur le bourg
De Durban
Un bruit sourd
Dans le vent :
On piétine
Les épines,
On s'obstine
Au couchant.
Vers la Pinède
Sinistre bois
Que le ciel m'aide !
Tous, je les vois :
Ils vitupèrent,
Ils déblatèrent
Et vocifèrent,
Chacun pour soi...
L'élucubration ardente
Des inquiétants magiciens
Va déchaîner la tourmente
Sur les monts languedociens
Au souffle de leur esprit
Du Crès au Caria maudit
La terre s'émeut et bondit :
C'est le grand rut de l'Aptien !
Comme le plafond d'une armoire
Le roc blafard jaillit au ciel,
Dans un élan contradictoire,
Verticalement tangentiel.
L'essaim des horsts flottants s'avance
La klippe enracinée s'élance,
Le cap trois cent dix-neuf balance
Au fouet des hurlements formels...
La comédie s'épuise,
Les héros sont lassés.
Leur vieille barbe est grise,
On en a tous assez.
Ô gosses des villages !
Contemplez ces nuages :
Voyez leurs vains mirages
Se fondre, s'effacer !...
Vaste Nature
Aux mille seins
Tu n'avais cure
De ces mesquins !
Flots de paroles,
Colères folles,
Amitiés molles,
Qui s'en souvient?
Cistes roses,
Romarin,
Fleurs écloses,
Vent marin.
Le ciel roule
Et s'écoule
Sur la houle
Du terrain.
L'histoire
Prend fin.
A boire, copains !
Corbières
Ou bière,
Nos verres
Sont pleins.
Mai 1968. - Dans les années 60, l'« escalier C» de la vieille Sorbonne conduisait au laboratoire de l'auteur de ces lignes. On concevra que, de ce seul fait, son regard sur les événements de cette époque soit resté subjectif! Nul doute que, vue d'ailleurs, leur perception ait été différente...Une agitation désordonnée s'empare des milieux intellectuels, médiatiques et politiques. Le mouvement semble venu de Californie. L'esprit naturellement contestataire de la jeunesse étudiante s'exprime dans les universités, de Los Angeles à Varsovie, à la manière des événements qui, en 1830 ou 1848, embrasèrent de proche en proche les capitales de l'Europe. A Paris, le mouvement insurrectionnel, limité initialement à une partie du 5ème arrondissement, est mis à profit pour déstabiliser le pouvoir et obtenir de nouvelles conventions sociales. Le regard qu'au cœur de la tourmente les professeurs, responsables et souvent créateurs de laboratoires, jettent sur ces agitations est divers. Beaucoup, surtout parmi les plus âgés, disparaissent dans le silence de leurs retraites. Quelques autres, surtout parmi les plus jeunes, tentent de s'opposer afin de sauver ce qu'ils estiment, à tort ou à raison, ne pas être des privilèges de nantis. Remises en question, rancœurs, ambitions s'expriment et se bousculent lors d'«assemblées générales» rappelant — mutatis mutandis — des séances de la Convention ! A la Sorbonne, où la plupart des laboratoires de la Faculté des Sciences se trouvent encore localisés, c'est un mois de singulière désolation : l'inconscient qui, le matin, tient à regagner son laboratoire désert constate les dégâts après les échanges nocturnes entre cocktails Molotov des uns, grenades lacrymogènes des autres.
La situation diffère loin de la capitale. A Orsay, François Ellenberger vient d'avoir 53 ans. Apparemment inspiré par l'esprit des Lumières, il est partagé entre l'attirance pour la contestation de la jeunesse étudiante et le souci de canaliser son expression. L'édition de son cours multigraphié, Introduction à la Géologie structurale de l'Europe [1968], lui permet de s'exprimer. Il débute ainsi : «Amis, mes jeunes camarades de la Pentecôte 1968, ce cours vous est dédié». Dans le développement qui suit, l'auteur rappelle toutefois une phrase prêtée à Salvador Dali : «Les plus belles et les plus profondes révolutions culturelles se sont faites sans barricades, la violence insurrectionnelle animant l'esprit seul... ». Et, dans ce cadre qu'il veut voir dominé par la raison, il conclut : «Courage, amis, embarquez au grand large! notre combat continue ». Ce qui lui permettra, il l'espère, de faire connaître aux jeunes impatients qui l'entourent la fort intéressante fresque qu'il brosse de l'évolution des idées sur la géologie de « notre patrie européenne». La brochure s'achève sur un ton humoristique : «L'auteur, sa dévouée secrétaire et le lecteur (s'il lui arrive de lire jusqu'à cette page) estiment, chacun pour leur compte, que les conclusions les plus brèves sont les meilleures [...] Peut-être ce premier tome aura-t-il une suite, à savoir une description de l'Europe, région par région. Sinon vous écrirez ci-dessus : CAETERA DESUNT» (soit : Le reste manque !). Ce sera le cas...
La tourmente passée, la vie reprend ses droits, dans des universités soumises à un nouveau statut, où l'ancien système de «démocratie oligarchique» du corps des professeurs a été balayé ! François Ellenberger va bientôt être appelé à présider la Société géologique. Son allocution d'entrée, le 24 janvier 1972, exprime bien son état d'esprit : amitié scientifique, mise en commun permanente, appel à plus de rigueur et d'autodiscipline, travail et publication en équipe. S'adressant «plus spécialement aux plus jeunes, puisque [écrit-il] l'on m'a dit que j'avais eu la faveur de leurs suffrages», il rappelle le bon vieux temps où les séances de la Société se tenaient rue Serpente : « en mauvais élèves, déjà frondeurs, nous étions quelques-uns à nous approprier invariablement les meilleures places qui étaient celles du fond. Assis là sur la grande table, le dos à la muraille impressionnante de vieux bouquins tapissant tous les murs de cette salle, jambes ballantes, nous dominions la situation en comptant les coups... ».
Le contraste est grand avec l'absentéisme régnant en 1972. Les temps ont changé : les laboratoires, installés au large maintenant, riches en jeunes chercheurs, se satisfont de leurs querelles internes et constituent autant de citadelles repliées sur elles-mêmes, que l'exemple de quelques «patrons» n'arrive plus à mouvoir.
Le nouveau président de la Société n'est pas gâté par la situation. Des politiques à courte vue ont, les années précédentes, sous des présidences d'esprit traditionnel assistées de conseils d'administration timorés, rompu l'adéquation nécessaire entre deux données de base : les ressources de la Société et le volume des publications. Dès l'entrée, François Ellenberger l'exprime : « vu les circonstances, cette responsabilité m'inquiète ». Les délais d'impression approchent maintenant les deux ans, et le bourrelet des textes en souffrance s'accroît dangereusement. La désaffection devient tragique : de 1971 à 1972, le nombre de membres chute de presque moitié (de 2100 à 1250), ce qui va accroître un déséquilibre qui menace de devenir mortel. Certains ont cru pouvoir reprocher au nouveau président la responsabilité de cet état de fait, dont il venait d'hériter, son seul tort ayant été d'avoir accepté ce poste dans une période désastreuse. Il a plaidé dans son allocution finale [ 1973a] que, sous sa présidence, l'inflation du déficit a été stoppée par une énergique politique de sévérité aux nouveaux manuscrits, qui furent souvent réduits en volume pour paraître aux Comptes rendus sommaires (la formule a, hélas, aujourd'hui disparu), et un «fonds de rattrapage» ouvert aux donateurs a été constitué. Il faudra cependant des mesures draconiennes, développées l'année suivante par son successeur, qui a l'immense avantage de puissantes relations dans les instances officielles, pour ramener le navire à flot. Ellenberger s'adresse ainsi à lui : «Je crois avoir laissé à mon très dynamique successeur, le Président Millot, une situation à la mesure de son grand esprit d'organisation, à charge pour lui d'achever de conduire l'attelage sur la berge du gué». L'optimisme revient : le nombre d'inscrits remonte de 1250 à 1600 dès 1973. Mais cette dure période a laissé sa trace dans l'âme de François Ellenberger, qui a mal accepté l'évolution de plus en plus rapide de cette Société, à laquelle il s'était identifié, et qui s'éloigne de plus en plus de ses traditions en tentant de s'adapter aux évolutions incertaines du temps présent.
La période d'après 1968 voit Ellenberger focaliser son intérêt sur les vieux socles. Il avait déjà, en Montagne Noire et dans les Mauritanides lors d'une excursion organisée par J. Sougy et quelques autres, montré son attirance pour ces problèmes. C'est toutefois la Scandinavie qui, durant plus de huit ans, va constituer son domaine d'élection. On lui demande d'encadrer un groupe sous forme de direction d'une R.C.P. (Recherche coopérative sur Programme) du C.N.R.S. Cette structure «Socle et Calédonides» regroupe des chercheurs s'intéressant au socle dalslandien (= grenvillien) du Sud de la Norvège et ceux de son équipe propre qui s'attaquent aux nappes de la chaîne calédonienne. Il en découlera un certain nombre de thèses de doctorat. Ce programme de recherche doit probablement résulter des belles excursions qui avaient été consacrées, en 1960, à la chaîne calédonienne lors du Congrès international de Copenhague. Nous avions été nombreux à être conquis par cette étonnante tectonique en grandioses nappes de charriage dont les feuillets, empilés à la manière de mille-feuilles, reposent quasi à plat sur un substratum parautochtone. Jusqu'à cent kilomètres à l'Ouest du front chevauchant, des fenêtres font apparaître, sous le matériel métamorphique des nappes, le Cambro-Silurien souvent presque intact qui forme la couverture discordante du socle précambrien du bouclier baltique. Ce projet (R.C.P. n° 193) avait recueilli d'emblée les suffrages de la Commission de Géologie du C.N.R.S. : il fut proposé en tête du classement des demandes en 1968 et lors des renouvellements de 1971 et de 1974. Une séance spéciale de la Société géologique permettait, le 29 mars 1971, de réunir une quinzaine de communications, dont les deux tiers concernaient les Calédonides. Ellenberger en confiait la présentation à son disciple André Prost dans un numéro spécial de la revue de Nancy, Sciences de la Terre, publié l'année suivante. Ultérieurement sera opéré un recensement des travaux effectués sur les Calédonides Scandinaves, et l'on voit ainsi qu'une cinquantaine de titres sont dus à l'équipe française dans une région traditionnellement anglophone. Fin 1976, un changement de structure au C.N.R.S. amène l'éclatement (la décomposition ?) de la Géologie, jusque-là dans une seule Commission, en deux sections rivales : l'une consacrée aux problèmes de surface, l'autre — à laquelle se rattache le groupe Ellenberger — aux zones profondes. Le nouveau responsable de cette dernière aurait bien aimé disjoindre une géologie physico-chimique, couverte de moyens, d'une géologie naturaliste, section-croupion vouée à la disparition. Ayant échoué, il se console en faisant allègrement effectuer des coupes claires dans les crédits affectés à ceux qui ne font pas partie de son groupe de pression. La R.C.P. Scandinavie se trouve alors amputée de près de la moitié de son budget, ce qui entraîne une protestation indignée de son chef (lettre-circulaire du 10-12-1976 à Claude Allègre) dénonçant ces «fort peu démocratiques — et fort peu scientifiques —façons défaire d'une minorité agissante en France » : un règlement de comptes qui inaugure deux décennies de brimades à l'égard des groupes manifestant une insuffisante révérence à l'égard des théories nouvelles et surtout de leurs chefs auto-proclamés.
De ce long raid collectif, François Ellenberger retire plusieurs conclusions principales. L'une a trait au caractère « ensialique » de cet orogène, qui ne comporterait pas de matériel océanique nettement caractérisé : ainsi peut s'expliquer déjà l'hostilité de ceux pour qui la structure des grands orogènes à nappes doit obligatoirement inclure le matériel ophio-litique d'océans perdus. Sans doute regrettera-t-il que ceux dont il guidait les pas ne soulignent pas davantage le caractère original de ce véritable modèle orogénique Scandinave, difficile à expliquer il est vrai. Une autre conclusion, qu'Ellenberger n'a jamais cessé d'exprimer au cours de sa carrière [cf. 1955c, 197ld], a trait au «caractère second des relations entre la mégatectonique », celle des nappes, et les microstructures au niveau du tissu rocheux, dont l'étude n'est pas moins indispensable, en particulier du fait de sa relation avec le métamorphisme. Ces deux types structuraux ne relèvent pas, selon lui, des mêmes processus. Une telle attitude s'est constamment opposée à celle d'autres écoles, celle de Montpellier en particulier, qui ont longtemps espéré pouvoir expliquer les grandes structures par l'étude des petites. Un quart de siècle plus tard, on doit déplorer que l'irrégulier polyphasage des schistosités ait souvent échoué à donner l'explication des grandes structures dans les chaînes plissées.
La période norvégienne couronne la carrière de géologue de terrain de François Ellenberger. Jusqu'aux approches de la retraite, il continuera à suivre les travaux de nombreux élèves sur des sujets variés, souvent en relation avec des sociétés minières. Ainsi aura-t-il la satisfaction de constater que la plupart de ses élèves ont réussi à trouver un emploi, grâce au mode de formation qu'ils ont suivi. A cette époque, la géologie effectue, par l'emploi de méthodes géophysiques et océanologiques, essentiellement américaines à leur début, un pas considérable dans l'explication des grands processus géologiques. La «nouvelle Tectonique globale» est, en France, prise en charge par un groupe composite de hérauts, dont l'histoire méritera un jour d'être contée. Une telle conception unitaire de l'évolution du globe enthousiasme le public, géologique ou médiatique, par la simplicité de ses solutions, fondées sur les mouvements relatifs de plaques lithosphériques. Les progrès qui lui sont dus sont immenses, en particulier dans l'actuel domaine marin, soit les 2/3 de la surface du globe, jusqu'alors presque inconnu. De ce fait, le triomphalisme des «plaquistes» devient sans mesure.
La connaissance de la nature océanique initiale de maintes ophiolites a également permis de progresser dans l'explication d'un certain nombre d'orogènes. Mais cela a entraîné l'acceptation sans discussion de recettes toutes faites, alors que, chez les authentiques artisans de la Tectonique des plaques, bien des évolutions se sont produites depuis la naissance de la théorie. On comprend ainsi que, chez les tectoniciens à terre spécialistes d'immenses orogènes, scrutés consciencieusement depuis des décennies, il ait été difficile d'accepter tout de go la «nouvelle Tectonique globale». Et l'on doit dire à leur décharge que, dans beaucoup de chaînes plissées, des interrogations essentielles demeurent.
Dans ce débat, François Ellenberger a pris une position en flèche, témoignant d'un exceptionnel courage, dont il a assumé les conséquences. Homme de liberté, proclamant que parfois « il faut savoir ignorer», ayant appris combien, dans l'avancement chaotique de la connaissance scientifique les théories sont fragiles et fugaces, il s'est initialement [1970b] dressé contre «cette théorie, ou plus exactement, cette hypothèse des plaques [...] Islam simplificateur [qui] balaie comme un torrent la forêt confuse des dogmes partiels et contradictoires, des doutes trop longtemps ressassés, le foisonnement des faits trop longtemps, trop stérilement emmagasinés dans la dispersion générale». On ne saurait mieux décrire les insuffisances, trop exclusivement descriptives, des équipes qui, depuis un quart de siècle, avaient cependant fait considérablement avancer la connaissance de maints orogènes de tous âges.
Ellenberger n'a pas hésité à tenter d'arrêter le flot dans un pamphlet retentissant paru à la Société géologique : Déluge et plaques : propos d'un mandarin impertinent [1978e]. Sa connaissance encyclopédique des erreurs de nos prédécesseurs, dont il essaie toujours de discerner la logique, lui fait dénoncer « la Vérité préalable nécessaire et suffisante pour le docile troupeau plaquiste où il fait si bon bêler en chœur et où chacun, dans la masse, se fait illusion qu'il marche en pointe» ! Et l'on conçoit que l'auteur de ces propos ne se soit pas fait que des amis, surtout lorsqu' il ajoute : « Ce grand besoin de sécurisation serait attendrissant si la perte de l'esprit critique ne s'accompagnait souvent aussi de comportements moins édifiants où l'on voit les « Révolutionnaires » installés au pouvoir accaparer places et crédits et, devenus misonéistes [lire : hostiles à la nouveauté], tracasser les francs-tireurs, de leur vindicte. Au temps de Pasteur, les subventions eussent afflué à l'A.T.P. Génération spontanée» [A.T.P. = formule d'aide collective du C.N.R.S. dans les années 60-70].
Ellenberger a beau jeu de rappeler la succession des théories et des hypothèses qui, dès les balbutiements des premiers géologues aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, ont souvent précédé l'analyse des réalités. Le cas le plus exemplaire lui est fourni par Léonce Elie de Beaumont (1798-1874) dont il décrit le cheminement intellectuel dans son Introduction... de 1968. Cet homme imposant, de haute taille, au front dégarni, au menton dominateur, pétri des certitudes héritées d'une Grande Ecole, fut un meneur d'hommes. Avec son collègue Dufrénoy, il accomplit un travail remarquable : on leur doit la première carte géologique d'ensemble du territoire français et l'animation des recherches qui, longtemps après, aboutiront à la carte détaillée du pays. Pétri d'honneurs, arrivé à la tête de l'Académie des Sciences, Elie de Beaumont imposa en France une théorie unitaire qui, à écouter Arago, permit à la géologie de prendre enfin « rang parmi les sciences exactes » : la théorie du dodécaèdre pentagonal. Les familiers de l'ancien laboratoire du Collège de France, place Marcellin Berthelot, ont connu jadis le volumineux globe terrestre sur lequel Elie de Beaumont avait dessiné les alignements de ses «systèmes de montagnes» successifs. Ces directions auraient correspondu « aux arêtes d'un polyèdre issu tout naturellement de la contraction différentielle du globe», lors de stades tectoniques successifs [notion restée bien valable celle-là] durant sa longue histoire. Les meilleurs esprits se laissèrent prendre au jeu, en cherchant à tout prix à faire «coller» ce qu'ils observaient régionale-ment avec les dogmes du maître. D'aucuns arrivèrent même à en retrouver trace sur la Lune et jusque sur certaines planètes... Doté de l'apparente bonhomie de certaines personnalités intimement autocratiques, Elie de Beaumont a, dans ce domaine, stérilisé durablement les débuts de la tectonique en France. Il faudra le génie d'un autre grand ingénieur, Marcel Bertrand, pour plus tard redresser la barre, en introduisant le mobilisme avec la théorie des nappes de charriage, qui mettra cependant quelque trois quarts de siècles avant d'être unanimement acceptée. Il est vrai que Marcel Bertrand était le contraire d'un despote.
Ailleurs, Ellenberger exprime sa répulsion pour une théorie qui triompha à partir de 1940 : celle de la «tectonique par gravité », qui était fondée sur le principe de mouvements verticaux dominants, engendrant de gigantesques décollements superficiels sur les flancs des zones hautes. Cette conception minimisait à l'extrême le rôle des mouvements profonds tangentiels.
Il évoque aussi [ 1968b] la théorie géosynclinale qui, sous ses avatars successifs, eut ses heures de gloire : sous les formes diverses de son fondateur Dana (1875), d'Emile Haug dans son Traité, puis du grand tectonicien allemand Hans Stille (1913, 1941), enfin sous sa forme la plus élaborée, celle de Jean Aubouin, qui connut un succès foudroyant et exerça une grande influence sur toute une tranche d'âge. Ellenberger professe une tendresse critique pour cette notion, surtout sous sa forme adjective, qui possède une incontestable valeur. Mais il exprime sa méfiance de schémas rigides trop systématiques. Cette théorie s'effaça devant l'arrivée inopinée et triomphante de la Tectonique des Plaques.
Dans sa critique des théories mobilistes en cours, Ellenberger accorda un intérêt particulier à l'épirogenèse, notion due à l'américain Gilbert : gauchissements doux et amples expliquant la formation antiforme des massifs, celle synforme des bassins, ainsi que les grands boucliers. Il en a, après dépouillement de centaines de travaux, fourni une mise au point [ 1976a], en concluant au manque de modèles explicatifs convaincants, sinon par l'intervention probable de phénomènes autonomes à dominante verticale, s'opposant ainsi aux modèles à flux horizontaux de matière, tel celui qu'avait conçu Argand en 1924. Ainsi est-il tenté d'admettre que des transformations («décratonisation») de la croûte sialique ont pu permettre l'accomplissement, sur de longues durées, de tels soulèvements ou affaissements.
Il n'est pas indifférent de relever, dans ce presque ultime travail de géologie fondamentale de François Ellenberger, une affirmation intéressante quand il écrit que toutes les données de son enquête «lui ont en effet paru justifier le concept de «plaques» rigides épaisses où la croûte et une bonne partie du manteau supérieur sont autochtones l'un par rapport à l'autre ». Il conclut par le souhait que « le délice des sages emportements auquel nous convie M. Wegener» — comme l'écrivait jadis Argand — «délice retrouvé et ses attraits nouveaux ne dégénèrent pas en engouement collectif et que la doctrine mobiliste rénovée use à l'égard d'elle-même d'une incessante vigilance... ». Pour estimer in fine, comme plus tôt Goguel, que l'explication de l'épirogenèse «est la voie et la clef [qui] nous obligera à forger des modèles résolument nouveaux».
Si l'on peut déterminer le moment où François Ellenberger délaisse la géologie militante de terrain, il est par contre impossible de fixer un début à son attirance pour l'histoire de nos disciplines. Elle s'observe dès ses premiers travaux à caractère régional, Grésigne ou Montagne Noire. Elle se développe quand il entreprend de résoudre les mystères de la Vanoise, lors de sa thèse alpine. Mais c'est à partir de 1972 qu'elle explose par une série de publications, essentiellement consacrées à la personnalité de James Hutton (1726-1797) et aux convergences de ses propositions avec celles que le nîmois Louis Bourguet (1678-1742) avait exposées dans une « Théorie de la Terre » en 1729.
Dorénavant, Ellenberger axera ses pensées sur l'évolution des connaissances et des explications en géologie. Sa mise à la retraite en 1984 n'est guère plus qu'un événement second. Depuis lors il continue de poursuivre patiemment la lecture des anciens, ce qui vient de lui permettre d'écrire son Histoire de la Géologie [1988a, 1994a] d'une étonnante richesse de données négligées jusque-là. Entreprendre une telle Somme supposait des conditions exigeantes : posséder une large palette de connaissances géologiques, fruit d'une longue expérience; faire preuve d'une inlassable patience pour dévoiler la pensée intime de nos devanciers en les replaçant dans leur temps ; bien connaître les divers idiomes que ces derniers utilisèrent, afin de les analyser de première main. C'est seulement ainsi qu'ont pu être portés des jugements motivés sur les hommes et sur leurs œuvres.
Il vient de nous donner, dans la conclusion d'un récent article à l'Encyclopaedia Universalis [1995f], la philosophie acquise au terme de soixante années d'observations et de réflexion :
-
«La géologie actuelle est l'aboutissement d'un développement historique qu'il faut connaître pour comprendre l'articulation logique des innombrables spécialisations où elle a tendance à s'éparpiller [...]. La grandiose théorie unificatrice des plaques, avec ses immenses avancées, a peut-être un peu trop dévalorisé les méthodes éprouvées de la géologie traditionnelle; elles restent nécessaires, au côté des nouvelles voies très techniques. L'histoire nous tend un miroir : elle nous montre notamment le danger des systèmes si bien construits que l'on a tendance à s'y enfermer, en se contentant de les enrichir frileusement du dedans. Les progrès futurs sont en général inattendus, voire dérangeants (Hutton rompt le consensus neptunien, les nappes et la radioactivité brisent celui de la contraction, Wegener s'insurge contre les continents immuables, etc.). Les conduites humaines changent peu; il est bon d'étudier la logique des erreurs passées : elles peuvent éclairer les voies de notre science actuelle, en nous incitant à ne pas nous enliser, à poursuivre avec esprit critique, indépendance et audace la quête séculaire, jamais achevée».
Que conclure d'une matière aussi riche que celle de la vie exemplaire, originale et quelque peu surprenante de celui qui, en 1976, fonda le Comité français d'Histoire de la Géologie? Ma voix aura été celle d'un de ses frères géologues, qui a eu le privilège, sur le terrain, dans l'université ou encore à la Société géologique, de côtoyer, dans beaucoup de ses phases, la voie singulière de François Ellenberger.
Homme libre, toujours à la recherche de ses limites, tu as, dans ta longue carrière, assisté aux étonnantes évolutions de notre discipline. Tu as assumé les contradictions de l'âme humaine : à la fois sceptique et croyant, volontairement en marge mais aussi plein de zèle prosélytique, homme d'action sur le terrain et au cabinet homme de réflexion, à la fois indifférent et attentif, fondamentalement solitaire mais ayant inspiré quantité de jeunes esprits, heureux d'être reconnu mais incapable de rechercher des honneurs, tu as suscité autour de toi, suivant les cas : admiration, intérêt, curiosité, amusement souriant, parfois réactions violentes. Et, même dans ce dernier cas, le savant a toujours été respecté.
Tu es un de ces rares hommes que, le soir venant, l'on peut se réjouir d'avoir connu et apprécié durant plus d'un demi-siècle.
François Ellenberger, tu dois avoir aujourd'hui la certitude d'avoir réussi ta vie et marqué la géologie de ton pays, la France européenne.
Gabriel GOHAU
Comme le note Michel Durand-Delga, il n'est pas possible de savoir quand François Ellenberger commença de s'intéresser à l'histoire de la géologie. Et sans doute a-t-il raison de penser que ses premiers travaux contiennent en germe ce goût pour les idées de nos aînés.
Ce qui est patent c'est que sa thèse sur la Vanoise est précédée d'un long historique [1958a]1. Bien sûr, toute monographie commence par l'étude de ce qu'ont écrit les prédécesseurs. C'est l'exercice obligé du thésard. Cependant, selon le sujet et les dispositions de l'impétrant, celui-ci remontera plus ou moins loin dans le passé, et étendra plus ou moins l'investigation vers la périphérie de la région et des notions rencontrées. Or il est clair que François Ellenberger esquisse une étude historique sur le métamorphisme au dix-neuvième siècle, à laquelle on peut encore puiser lorsqu'on se hasarde à traiter de la question [G. Gohau, Evolution des idées sur le métamorphisme et la formation des granites, in B. Bonin, R. Dubois et G. Gohau, Le métamorphisme et la formation des granites, Nathan, 1997, p. 9-58].
Il en va de même pour son cours inaugural du 10 novembre 1962, dans la chaire de géologie des grandes régions du globe [1962d]. Certes, là encore, l'évocation du passé, sous la forme de l'histoire de la chaire et de ses titulaires, est de tradition. Mais précisément, la chaire n'a pas d'histoire puisqu'il s'agit d'une création. François Ellenberger profite cependant de ce qu'elle résulte du bourgeonnement de la chaire de géologie régionale et de géologie appliquée pour en faire l'historique, en évoquant la mémoire de ses deux précédents titulaires. C'est l'occasion de défendre courageusement Léon Bertrand, dont un résumé caricatural faisait «l'homme des prétendues et inexistantes nappes pyrénéennes», et de dire son affection émue pour son ami Louis Barrabé. Mais ces hommages rendus, il s'évade en cherchant un «parrain supplémentaire », qui n'eut aucun rapport avec la «vieille Sorbonne dont il ne fut jamais membre», Ami Boue, un des fondateurs de la géologie moderne qui eut la bonne idée de laisser à sa mort une Autobiographie posthume, où l'on trouve des «propos trop libres sur tels confrères pour être publiée de son vivant».
Pour ma part, c'est son article du Livre à la mémoire du Professeur Paul Fallot, publié sous la direction de Michel Durand-Delga, intitulé La Vanoise, un géanticlinal métamorphique, qui m'a fait prendre contact avec sa préoccupation historique [1963d]. Comme tout étudiant j'avais baigné, si j'ose dire, dans le géosynclinal tel que l'imaginait Haug : une vaste fosse au fond de laquelle se métamorphisaient les sédiments entassés par subsidence. Le métamorphisme prétectonique était encore le dogme de l'enseignement universitaire parisien. Or François Ellenberger, qui avait été contraint d'associer métamorphisme et géanticlinal, selon une sorte d'oxymore, nous montrait que le métamorphisme géosynclinal se rattachait à un courant « néowernériste » qu'il répudiait. Dans un historique très synthétique, il montre qu' Elie de Beaumont esquisse de façon «encore nébuleuse» la théorie géosynclinale, mais ajoute que cet «observateur minutieux à ses heures, avait pu localement démontrer [...] que le métamorphisme datait non de l'époque du dépôt, mais de celle de la déformation des roches, bien plus tardive», et qu' «en cela il était resté fidèle à l'esprit de Hutton » [p. 384].
Je n'ose dire, comme Kant, que cet article m'a tiré du sommeil dogmatique. Quand je relis ces lignes aujourd'hui, je suis surpris : dans mon esprit, ce papier était une sorte de proclamation pro-huttonienne, une déclaration de guerre au wernérisme, accusé d'avoir remis en selle la géognosie du maître de Freyberg, au début de ce siècle, par un retour du «pendule des idées». En fait, Gottlob Werner et James Hutton n'y sont cités qu'une fois chacun, et le rattachement du «métamorphisme de position» au second est implicite, dérivé de la citation rappelée ci-dessus. Faut-il croire que ces idées nouvelles pour moi, comme sans doute pour d'autres lecteurs, étaient si fortes qu'elles imprégnaient tout l'article? Dois-je plutôt penser que François Ellenberger m'a tellement transmis depuis — dans nos longues et multiples conversations téléphoniques des années d'écriture de son Histoire de la Géologie — que j'ai rétrospectivement chargé ce travail de plus de contenu historique qu'il n'en renfermait réellement, au moins explicitement? Je ne suis pas capable d'en décider.
Le thème du géosynclinal, en tout cas, sera repris dans une communication publiée par l'Académie des sciences [1970e]. Il y fait évidemment référence aux articles de Jean Aubouin sur l'histoire de la notion, parus en 1959 et 1961. Mais il les complète, notamment en reprenant les premières intuitions d'Elie de Beaumont, sans toutefois revenir sur le lien avec le métamorphisme. Il passe ensuite à Marcel Bertrand, un auteur qu'il affectionne, et dont il reparlera, et termine par quelques mots sur Hans Stille, le tectonicien de Gôttingen. Il complète les informations de Jean Aubouin qui avait déjà mis l'accent sur l'importance de cet auteur, mal connu du public français.
Suit une série de communications, également publiées par l'Académie des sciences. Hutton est l'un de ses sujets de préoccupation comme on a déjà dit. Il consacre un article aux «origines de [sa] pensée», en étudiant sa thèse de médecine [1972i]. Il rappelle que trente années séparent cette thèse, soutenue à l'âge de vingt-trois ans, des autres publications du célèbre géologue écossais. C'est dire qu'elle est la source directe unique dont nous disposons pour reconstruire le cheminement des idées huttoniennes. Or par bonheur, cette thèse se rapporte au sang et à la circulation du microcosme (entendons l'être humain), c'est-à-dire à un cycle dont le lien avec son «cycle géostrophique» vient à l'esprit du lecteur.
Le sang donne l'exemple «d'une matière qui se meut de soi-même et régénère son déclin journalier par l'action même de la cause de destruction». Ce qui, transposé trente-six ans plus tard au macrocosme du globe terrestre, devient : le système terrestre est assimilable «à un corps organisé constitué de telle sorte que l'usure, le délabrement inéluctable de la machine se trouvent naturellement réparés par l'effort de ces mêmes puissances génératrices auxquelles il doit sa formation ». Saisissante continuité. Si éclairante que François Ellenberger croit utile de la développer en trente-sept pages, sous le titre explicite : « la thèse de doctorat de James Hutton et la rénovation perpétuelle du monde», dans les Annales Ghébhard [1973c].
Entraîné par ces études, il publie dans la Revue de Synthèse un travail de réflexion, intitulé La métaphysique de Hutton et le drame écologique du XXe siècle [1972k], où ses connaissances sur Hutton le poussent à une comparaison avec la société contemporaine. Très pessimiste sur ce qu'il désigne comme « l'impasse où notre monde est précipité par la civilisation technologique parcellisée, aliénante », il cherche une aide dans le « message d'une profonde actualité» que lui offre le médecin écossais, dont il a lu toutes les œuvres, notamment ses Principes de la connaissance. Nous n'évoquons cet article philosophique qui sort du cadre des études historiques strictes que pour montrer que ses vues peuvent s'élever vers un domaine qui ne lui est pas aussi étranger qu'il le prétend parfois, pour se prémunir contre les spéculations des philosophes professionnels.
A la même époque il écrit plusieurs articles pour l'Encyclopaedia Universalis. Nous ne retiendrons que ceux sur Hutton et Werner [ 1970j et 1973b], les autres se rapportant à la géologie structurale. Tous deux seront mis à jour pour la réédition de 1995.
Puis vient un grand moment de ses découvertes personnelles : celle de l'importance de l'œuvre d'Henri Gautier. Toujours dans l'année 1972, il a suggéré, dans une autre note à l'Académie des sciences, De Bourguet à Hutton : une source possible des thèmes huttoniens, tout en insistant sur l'«originalité irréductible de leur mise en œuvre» [1972j ]. Comme le fera Hutton un demi-siècle plus tard, Louis Bourguet prend déjà le présent comme clé du passé. Mais il rejette énergiquement l'idée de circulation éternelle. En sorte que si Hutton, lors de son passage à Paris, en 1748, avant la soutenance de sa thèse, a puisé dans Bourguet c'est en faisant siennes tantôt les thèses de l'auteur, et tantôt celles que Bourguet combat, mais qu'il présente avec une «réelle éloquence»... qui les met à la portée de ses adversaires potentiels.
Or une lettre de Bourguet permet à F. Ellenberger d'identifier l'un des protagonistes des théories que combat l'érudit nîmois. Il s'agit d'un ingénieur des Ponts et Chaussées languedocien, nommé Henri Gautier ( 1660-1737), qui insère dans sa volumineuse Bibliothèque des Philosophes et des Sçavans... un essai contenant de Nouvelles conjectures sur le Globe de la terre, où l'on fait voir de quelle manière la terre se détruit journellement, pour pouvoir changer à l'avenir de figure.
A une époque où les théories de la terre se préoccupent essentiellement de la formation du globe, Gautier construit un système prenant en compte le cycle des phénomènes géologiques. L'érosion, le transport et le dépôt entraînent les terrains des montagnes vers les plaines et les mers. Ils y forment des lits ou « répandues ». Or les couches des montagnes actuelles, bouleversées, sont de même nature. Il faut donc que les dépôts aient été soulevés et transportés par de « grands mouvements de déplacement horizontal », note le tectonicien de la Vanoise, impressionné par la modernité de l'auteur [1975 b et 1975c].
Il n'oublie pas cependant que les crises cataclysmiques de Gautier alternent avec des périodes calmes, selon un schéma plus proche de celui d'Elie de Beaumont ou d'Alcide d'Orbigny que des thèses uniformitariennes. Or lui-même est plus favorable à ces dernières qu'aux idées catastrophistes. Il sait que l'abus du recours aux révolutions brusques justifie largement le radicalisme de Charles Lyell. En effet, quelques années plus tôt, la fameuse année 1972, si riche en travaux historiques, sous un titre ironiquement léniniste, il a communiqué dans un colloque, à Orsay, Quelques remarques historiques sur « la maladie infantile » de la stratigraphie, où il dénonçait le rêve des coupures absolues des fondateurs de la « stratigraphie globale », Elie de Beaumont et Alcide d'Orbigny [ 1972h]. Il doit aussi concéder que le modèle de globe creux, à croûte mince en équilibre dynamique, peut sembler bien «singulier» au lecteur moderne de Gautier.
Il développera cette thèse dans deux longs articles d'Histoire et Nature, qu'il entame, sous prétexte de présenter les antécédents historiques, par une histoire des idées sur la terre depuis les Grecs. Ce texte forme l'amorce du premier volume de son Histoire de la Géologie qui paraîtra dix ans plus tard. Pour mon compte, au moment où je commençais tout juste à travailler à ma thèse, je découvrais une source insoupçonnée de documents sur le Moyen Age dans le volume IX du Système du monde de Duhem, dont il extrayait notamment les renseignements sur les œuvres de Jean Buridan et d'Albert de Saxe. Suivie par la biographie d'Henri Gautier, cette histoire occupe le premier des articles, déjà plus de cinquante pages [1976b]. La suite, à l'effroi de la rédactrice de la revue, l'infortunée Georgette Legée, trop bienveillante pour contraindre l'auteur à réduire son texte, approchera les cent-cinquante pages [1978a].
Quel bonheur que nous possédions cette longue étude. Personne n'avait cherché à pénétrer l'œuvre de l'ingénieur languedocien. Aujourd'hui, les historiens du monde entier qui s'intéressent à la géologie française du début du dix-huitième siècle sont obligés de tenir compte du travail de notre ami, quelque jugement qu'ils soient amenés à porter au bout du compte sur la nouveauté et sur les archaïsmes de Gautier.
On a pu voir dans ce travail une forme du whiggisme qui préoccupe certains collègues anglo-saxons, soucieux d'éviter — à la façon dont le parti anglais Whig croyait au progrès social — d'écrire l'histoire des sciences comme un progrès continu. François Ellenberger s'en est défendu. Car il sait bien que Gautier mêle des nouveautés qui le mettent sur le chemin des orogenèses multiples avant Hutton et Deluc à un modèle cartésien de terre, avec croûte de moins de dix kilomètres flottant sur un «grand vuide semblable à celui d'un balon ou d'une vessie». Mais pour comprendre ce système, il faut se rappeler que la France du début du dix-huitième siècle n'a pas encore intégré la physique de Newton. Elle n'y parviendra que dans les années 1730, gâce aux efforts de Voltaire et de Maupertuis. De toute manière, François Ellenberger donne de multiples citations qui permettent au lecteur de se faire lui-même une idée de l'importance des travaux d'Henri Gautier. A la même époque, il s'est intéressé à François Rouelle, le chimiste, auteur d'un cours de géologie qui a inspiré le courant neptunien français du dernier tiers du dix-huitième siècle, notamment Jean-Claude Delamétherie [1974a].
Mais nous voilà en 1976 (les articles sur Gautier paraîtront en juin 76 et décembre 77). Le 15 juin se produit un événement qui a donné son essor à l'histoire de la géologie en France. François Ellenberger convoque, dans la salle du conseil de la Société géologique les collègues, amis et connaissances qui s'intéressent à l'histoire de la géologie. André Cailleux et Franck Bourdier qui publient déjà des articles et ouvrages dans ce domaine sont présents. Ainsi que René Taton, historien des sciences physiques et mathématiques, connu pour son Histoire des Sciences, publiée aux Presses universitaires de France, dans les années 50, et qui apportait la caution de l'Union internationale d'histoire et de philosophie des sciences, dont il présidait la division d'histoire des sciences. Après un exposé d'André Cailleux sur l'organisation internationale de l'histoire des sciences de la terre, et un compte rendu de François Ellenberger, seul membre français de l'INHIGEO (commission internationale d'histoire des sciences géologiques), présent à la réunion de Londres de ce comité, on y décide la création d'un comité français d'histoire de la géologie, qui sera en quelque sorte la section française de l'INHIGEO. François Ellenberger est élu président. Il le demeurera vingt ans. Jean Gaudant prend en charge le secrétariat : il l'est encore. Ils sont assistés de conseillers qui regroupent des personnalités du monde géologique, s'intéressant à son histoire, comme Pierre Hommeril, Théodore Monod, Jean Orcel, Henri Termier, Henri Tintant, ainsi que Franck Bourdier et André Cailleux, déjà nommés, et des personnalités venues des lettres ou de la philosophie, comme Jacques Roger et Suzanne Delorme.
Par la suite, François Ellenberger réservera au COFRHIGEO la plupart des travaux historiques qu'il conduira, notamment au cours de la préparation de l'Histoire de la Géologie, à laquelle il consacre bientôt l'essentiel de son temps. Mais en attendant, il se met aussi à la préparation de la dix-neuvième section, consacrée à l'histoire de la géologie, du Congrès géologique international du centenaire (1878, premier congrès, tenu à Paris) prévu à Paris, en 1980. Le thème retenu pour cette section est le «développement de la géologie dans les pays de langue française, de Descartes à Cuvier, dans ses relations d'échanges avec les autres pays».
Il organise, avec l'aide de Georgette Legée, une excursion de neuf jours, Aux sources de la géologie française, sur un itinéraire Paris-Auvergne-Marseille, avec quelque quatre-vingts points d'arrêt. En passant par Arcy-sur-Cure, la grotte étudiée par Pasumot, on arrive à Montbard, chez Buffon, puis à Volvic où Guettard, accompagné de Malesherbes, découvrit le volcanisme ancien de l'Auvergne. Mais l'essentiel est de faire connaître les travaux des naturalistes français méridionaux trop méconnus : Astruc, Gautier, bien sûr, de Sauvages, de Genssane, de Joubert, l'abbé Giraud Soulavie.
Les participants à cette excursion en ont gardé un souvenir ébloui. Pour mon compte, quoique l'ayant ratée, j'ai eu le privilège d'être invité à une répétition faite tout spécialement quelques années plus tard pour nos amis Wolfhart Langer et Hugh Torrens. Pour ceux qui n'ont pas eu cette chance, demeurent le précieux guide édité par Histoire et Nature, [1980f] et un recueil des principaux textes originaux et des planches illustrant les sites visités, cinquante pages serrées qui mettent à la disposition du public des œuvres peu accessibles. Une mine pour tout historien s'intéressant au dix-huitième siècle.
A cette occasion, il apporte des Précisions nouvelles sur la découverte des volcans en France... [ 1979c]. Il y évoque les auteurs qui ont vu, avant Etienne Guettard, des ponces et des scories produites par des «feux souterrains », et rend compte du mémoire d'un certain abbé Garmage qui semble avoir tiré profit de l'idée de Guettard pour proposer sa thèse, quoiqu'elle soit en retrait sur celle du compagnon de voyage de Malesherbes. Et comme Bourguet continue de l'intéresser, il tente de réhabiliter son orogenèse, ainsi que la stratigraphie de Woodward dans un article de la Revue d'Histoire des Sciences, sur Le dilemme des montagnes au dix-huitième siècle... [1977g]. Entre temps, le Dictionary of scientific Biography, dirigé par C. Gillispie — un homme que les historiens de la géologie connaissent pour son Genesis and Geology — lui demandera d'écrire la notice de Louis Bourguet pour son supplément [1978c].
Avançant dans le temps, il s'intéresse à Louis Cordier, l'élève et le successeur de Dolomieu au Muséum [1979e]. Puis, à l'occasion d'un exposé que j'avais fait au séminaire de Jacques Roger sur le « transformisme » de Jean-André Deluc, il me propose un travail en collaboration, qui m'entraîne à saisir l'importance du personnage. C'est à lui qu'on doit, dans cet article commun, publié par la Revue d'Histoire des Sciences, la mise en évidence du rôle de Deluc dans la naissance de la stratigraphie paléontologique. Ainsi que la dette de Cuvier à son prédécesseur genevois [1981c].
Il écrit une longue étude sur Les premières cartes géologiques en France [ 1982e], qu'il développe pour en faire un article d'Histoire et Nature où il étend le sujet à l'Europe [1983a]. Prenant en compte les projets (il évoque notamment ceux de Fontenelle, de Sauvages et de Boulanger) autant que les réalisations, il distingue trois types de cartes : les cartes minéralogiques, dont la plus célèbre est celle de Guettard, comme chacun sait ; cartes de géographie physique (Soulavie) ; enfin cartes géognostiques dérivées des concepts de l'école germano-suédoise. C'est dans cette dernière qu'il place la carte de Brongniart et Cuvier, première carte stratigraphique française, elle-même précédée des efforts de Georg Füchsel, et de William Smith.
En spécialiste de géologie structurale, François Ellenberger est attentif au fait que ces auteurs ont le souci de décrire le sous-sol dans son organisation verticale. C'est ce qui le pousse dans le même temps à recenser tous ceux qui, au milieu du dix-huitième siècle, parlent de « géographie souterraine », pour marquer leur souci de retrouver cette troisième dimension du bâti terrestre. Il profite du GRECO (Groupement de recherches coordonnées, CNRS) consacré à l'histoire du vocabulaire scientifique pour faire paraître une note sur le sujet [1983c].
La même publication contient, deux ans plus tard, une étude historique sur l'expression de «causes actuelles» [1985a]. Notre travail commun sur Deluc nous avait fait y trouver le terme dès 1790, donc bien avant l'usage que... n'en fait d'ailleurs quasiment pas Charles Lyell, à qui l'historiographie traditionnelle en attribue la paternité. La trouvaille était d'autant moins anodine qu'on prétendait depuis Charles Sainte-Claire Deville que l'expression était une mauvaise traduction de l'anglais actual causes, et qu'il s'agissait donc de causes réelles plutôt que de causes existant actuellement. A la s-uite de notre article et des quelques éléments que j'avais recueillis pour ma thèse, F. Ellenberger poursuivait l'investigation et rétablissait le chassé-croisé des traductions franco-anglaises et anglo-françaises. Quand en 1984 la Société géologique de France lui attribua son premier prix Wegmann, il la remercia par une allocution sur ce sujet, publiée par le Bulletin de la Société géologique de France [1987a].
Nous sommes alors tout près de la parution du volume 1 de l'Histoire de la Géologie. Nous passerons sur quelques publications qu'on trouvera dans les travaux du COFRHIGEO sur Etienne Guettard, Marcel Bertrand et André Cailleux, à qui il rend hommage [1987c] pour en venir à cette œuvre maîtresse [1988a]. Ce travail qui va des Anciens à Sténon pourrait passer pour une gageure. Car si l'on attend du prestigieux géologue de terrain qu'il domine mieux que le philosophe — son concurrent direct en histoire des sciences — les époques récentes que l'on ne peut aborder sans maîtriser le savoir contemporain, le second pourrait croire à sa supériorité, dès lors qu'il s'agit de remonter au temps où la spéculation l'emporte sur l'observation.
Mais précisément, F. Ellenberger ne se laisse pas prendre au piège des discussions philosophiques. Non qu'il ne puisse s'y intéresser (ses travaux sur la métaphysique de Hutton en apportent la preuve à qui voudrait le prendre au mot quand il dit n'avoir pas de goût pour la philosophie), mais parce qu'il s'est muni des deux outils nécessaires pour éviter l'erreur. Il a lu les auteurs originaux, d'une part. Il s'est appuyé pour cela sur la thèse restée inédite de Geneviève Bouillet sur La géologie dynamique chez les anciens grecs et latins d'après les textes, soutenue en 1976 [Thèse de l'Université de Paris, dirigée par A. Cailleux]. Etparelle, il est allé aux sources primaires. Il a pu, par exemple, retrouver dans Polybe les observations de Straton, successeur d'Aristote, qu'on ne connaît habituellement qu'à travers le récit déformé qu'en fit Strabon. Pour les sources arabes du Moyen Age, il a fait de même. C'est ainsi qu'il nous donne une traduction nouvelle du texte de l'Encyclopédie des Frères de la Pureté (dixième siècle) sur le cycle érosion-sédimentation, qu'on ne connaissait guère que par Duhem.
D'autre part, il prend les observations comme si elles provenaient de contemporains : «frères en recherche», dit-il pour qualifier sa «sympathie» à l'égard des «visions lacunaires» de ses prédécesseurs. Façon de dire que l'observateur soigneux voit la même chose qu'il soit contemporain d'Alexandre le Grand ou du président Albert Lebrun. Ou façon plutôt, de sélectionner les observations de ceux des Anciens qui n'ont pas soumis leur vision aux préjugés de leur époque. Sans doute a-t-il conscience de leurs insuffisances. Mais précisément, dans l'optique choisie, celles-ci proviennent des nécessaires lacunes de l'information. Il peut donc dégager une « logique de l'erreur» qui permet de comprendre que nos aînés ne pouvaient tout voir, sans pour autant leur dresser procès de leurs naïvetés.
Soucieux d'échapper au whiggisme qui menacerait, selon les historiens, les scientifiques qui se penchent sur le passé de leur discipline, il montre à l'occasion des pages sur Sténon qu'il n'hésite pas à marquer les ruptures quand elles s'imposent. Ayant retraduit le Prodromus pour en offrir un résumé analytique sans équivalent, il montre la modernité de Nicolas Sténon mieux que ne l'a encore fait aucun prédécesseur. Et si l'on craignait qu'il ne cédât à l'autre péché des scientifiques — écrire une histoire trop « internaliste» — il fait nettement apparaître la dette que Sténon, médecin et anatomiste avant de s'intéresser aux terrains de Toscane, doit à la médecine et à la chimie, lorsqu'il introduit en géologie les termes de « sedimentum» et de «stratum».
Un tome second devait suivre. On l'attendait pour l'année suivante... C'était ne pas mesurer la somme d'information que notre ami avait accumulée, et qu'il ne savait comment ramener aux dimensions exigées par l'éditeur. Il est toujours difficile de faire court : il y faut du temps. Il faut aussi sacrifier beaucoup des documents péniblement réunis. Le premier volume avait permis d'accroître le contenu en multipliant les passages en petits caractères, qui permettaient une lecture à deux vitesses. Il ne fallait cependant pas en abuser, car le lecteur moyen risquait de se croire dans un labyrinthe où il devrait franchir des obstacles en permanence pour retrouver la continuité de la version grand public. D'autant que la typographie ne facilitait pas forcément ces lectures croisées.
Cette fois, les tableaux permirent de donner des informations denses sans entraver la progression du lecteur pressé [1994a]. La réalisation technique améliorée rendait la lecture beaucoup plus agréable. Il n'empêche que l'œuvre à réaliser était colossale. En sorte qu'elle demanda six nouvelles années. Les partisans des discontinuités seront satisfaits de voir l'importance que l'auteur accorde à la «révolution créatrice» des années 1788-1825 qui dote la nouvelle science (le nom de géologie n'entre en usage que dans le dernier quart du dix-huitième siècle) d'une doctrine et d'un programme de recherche.
Trois concepts nouveaux en forment l'axe organisateur :
-
- la succession des faunes dans le temps (d'où l'usage des fossiles, inutiles jusque-là, pour dater les couches) ;
- l'immensité des durées géologiques;
- la transformation des sédiments au cours de l'orogenèse, qui ruine la doctrine neptu-nienne, selon laquelle les roches cristallines sont des dépôts «primitifs» dans un océan chaotique.
On ne s'étonnera pas de ne pas y voir l'actualisme. Ses recherches précédentes, comme on a vu, montraient son ancienneté. En fait il coexiste avec le catastrophisme depuis la nuit des temps.
La majeure partie du livre est consacrée à la préparation de cette révolution, soit aux années 1650-1800. Elle commence par les théories de la terre, auxquelles s'était arrêté le premier volume. Et traite avec maints détails tous ces auteurs du dix-huitième siècle dont nous savons l'intérêt que leur porte François Ellenberger. Mais l'ouvrage doit une partie de sa qualité exceptionnelle à une première partie de soixante pages qui nous fournit un magnifique inventaire thématique des concepts et des mots du vocabulaire géologique. On sent toute la culture de l'auteur, et la multitude des fiches qu'il a fallu amasser pour rédiger cette introduction sans précédent. Par exemple, beaucoup de lecteurs ignorent à quel point l'expression «révolution du globe» est polysémique. Combien ont noté que Cuvier et Lamarck s'en servent simultanément, le premier pour désigner ses catastrophes et le second ses séquences de phénomènes graduels?
Pendant qu'il rédige et corrige ce second volume, il continue d'écrire d'importantes monographies. Sur Johann Scheuchzer, le frère un peu oublié de Johann Jakob, avec qui on l'a parfois confondu [1990b]. Il parle aussi d'Ovide [1991a], et de Deux lointains précurseurs dans la géologie du Bassin Parisien, Saulmon et l'abbé Pluche [1992b], Il rappelle le souvenir d'Arduino [1992c], commémore brièvement Roderick Murchison [1992d]. Lors du colloque Buffon, en 1988, c'est à lui, tout naturellement, que Jacques Roger demande de brosser le tableau des «sciences de la terre avant Buffon» [1992a], Il le fait dans un raccourci saisissant de densité, où l'on sent toute l'érudition de l'ouvrage qu'il prépare. La même qualité se retrouve dans le tableau très condensé qu'il fournit, quand la direction de l'Encyclopaedia Universalis, lui commande une brève histoire des sciences de la terre pour sa réédition [1995f].
La conclusion de l'article dit bien la philosophie de toute son œuvre d'historien. Nous ne pouvons mieux faire que de la reprendre à notre compte. «Les conduites humaines changent peu ; il est bon d'étudier la logique des erreurs passées : elles peuvent éclairer les voies de notre science actuelle, en nous incitant à ne pas nous enliser, à poursuivre avec esprit critique, indépendance et audace la quête séculaire, jamais achevée». C'est ce parti-pris de traiter les anciens comme des contemporains qui fait sans doute la profonde originalité de l'œuvre d'historien de François Ellenberger.
Il n'est pas le premier à écrire une histoire de la géologie. Certes la concurrence des philosophes et des historiens de formation, forte dans le domaine des sciences biologiques, est à peu près nulle en géologie. Ce n'est pourtant pas que notre discipline manque de particularités. Sa dimension historique, la difficulté d'appréhender l'immensité du temps géologique auraient pu tenter certains philosophes des sciences. Cela n'a pas été le cas. En revanche, nous disposons de travaux réputés de géologues, essentiellement de langue anglaise, ayant abordé l'histoire de leur science.
Mais personne ne semble avoir eu le souci de tirer tout le bénéfice de sa formation de géologue de terrain pour essayer de retrouver les sites visités par nos prédécesseurs. A cet égard, l'excursion du Congrès géologique international de 1980 est un modèle unique. Il s'y est ajouté un scrupule que l'honnêteté de scientifique méticuleux a dicté à notre ami : retourner aux textes eux-mêmes. Ne jamais croire les commentateurs, même les plus sincères et les plus sérieux. Cela nous vaut des mises au point évoquées ci-dessus, à propos de Straton, et qu'on pourrait multiplier. Qui a lu Sténon, après avoir fait l'effort de traduire entièrement le Prodromus en français, comme il l'a fait? Qui a pénétré la pensée de ce grand novateur en reconstituant la logique de son ouvrage ? Qui a reconstruit son cristal de quartz à partir de la figure développée qu'il en donne ?
Un travail de cette qualité ne peut que susciter l'admiration. Le lecteur moyen des deux volumes de l'Histoire de la Géologie n'a pas forcément conscience de la précision de l'information qui lui est donnée. Il peut même être un peu dérouté par la densité de certaines pages. Mais celles-ci sont d'abord destinées aux spécialistes qui, eux, ne s'y tromperont pas. Ils sauront puiser dans cette extraordinaire documentation des renseignements de première main. C'est pourquoi on peut être assuré que l'ouvrage est destiné à demeurer longtemps dans les bibliothèques des historiens de la géologie, ou plutôt sur leur bureau, à portée immédiate de main.
BIBLIOGRAPHIE SCIENTIFIQUE
(Liste des publications arrêtée au 31 décembre 1996)
- 1937 - Recherches tectoniques sur le massif de la Grésigne. (Diplôme d'Etudes Supérieures, Paris). Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, LXXXI, p. 195-245.
- 1938a - Problèmes de tectonique et de morphologie tertiaires : Grésigne et Montagne Noire. Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse, LXXII, p. 327-364.
- 1938b - Polis éoliens sur les rochers de grès de Fontainebleau. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1938, p. 135-137.
- 1943 - Sur la tectonique de la bordure orientale de l'Aquitaine. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1943, p. 196-198.
- 1945 - Sur la signification de la craie à tubulures de Meudon. Bull. Soc. géol. Fr., (5), 15, p. 497-507.
- 1946a - Géologie de l'Oflag XVII A (en coll. avec V. HOST, M. FISCHER, A. GUILLEUX et P. PERAULT). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1946, p. 12-18.
- 1946b - Sur une coupe intéressante visible aux portes de Paris. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1946, p.62-63.
Cf. communication orale sur les contacts du calcaire de Meudon et de la craie à Bélemnitelles. en collaboration avec A. F. de LAPPARENT. C. R. somm. Soc. géol. Fr.. 1946, p. 94-95.
- 1946c - Observations nouvelles sur la craie jaune à tubulures de Meudon. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1946, p. 202-204.
- 1947a - Le problème lithologique de la craie durcie de Meudon. Bancs-limites et « contacts par racines»: lacune sous-marine ou emersion? Bull. Soc. géol. Fr., (5), 17, p. 255-274.
- 1947b - Observations à la communication de G. DEICHA : « Silicifications des failles aux environs de Biot, Alpes-Maritimes». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1947, p. 12-13.
- 1947c - Découverte de fossiles dans le Trias de la Vanoise. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1947, p. 312-314.
- 1947d - Le mystère de la mémoire. L'intemporel psychologique. Editions du Mont-Blanc, Genève, 275 p.
- 1948a - Métamorphisme, silicifications et pédogenèse en Bohême méridionale. (En coll. avec R. DEZAVELLES, M. FISHER, A. GUILLEUX, V. HOST, A. MOYSE et P. PERAULT). Ann. sci. Franche-Comté, Besançon, 3, 171 p.
- 1948b - Deux Céphalopodes de la Craie jaune de Meudon. (En coll. avec M. FISHER). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1948, p. 93-95.
- 1948c - Sur quelques roches vertes de la Vanoise. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1948, p. 148-150.
- 1948d - Quelques données sur la Vanoise médiane. Bull. Serv. Carte géol. Fr., C. R. des collaborateurs pour les campagnes 1946-47, XLVII, n° 225, p. 171-179.
- 1948e - Sur la série stratigraphique de la Vanoise. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1948, p. 325-327.
- 1948f- Observations à la communication de R. ABRARD : «La lacune entre la craie et le calcaire pisolithique à Meudon». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1948, p. 315.
- 1948g - Sur une nouvelle méthode rapide de détermination des feldspaths acides (en coll. avec L. VISSE). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1948, p.346-347.
- 1949a - Sur quelques caractéristiques du métamorphisme alpin dans la Vanoise. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1949, p.249-250.
- 1949b - Sur la série stratigraphique et la structure de la Vanoise. Feuilles de Moutiers et Modane au 1/50 000. Bull. Serv. Carte géol. Fr., C. R. des collaborateurs pour la campagne de 1948, XLVII, n° 226, p. 83-118.
- 1949c - Niveaux paléontologiques dans le Trias de la Vanoise (Savoie). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1949, p. 347-349.
- 1950a - Sur les affinités briançonnaises du Trias à faciès radical des Préalpes médianes suisses. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1950, p.54-57.
- 1950b - Subsidence et transgressions dans la Vanoise (zone du Briançonnais au Nord de l'Arc). C. R. Acad. Sci., Paris, 230, p. 1409-1411.
- 1950c - Horizons paléontologiques du Trias à faciès radical des Préalpes médianes vaudoises (coupes de la Grande-Eau et de Saint-Triphon). C. R. Acad. Sci., Paris, 231, p. 1326-1328.
- 1950d - Sur les gypses de la Vanoise. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1950, p. 265-267.
- 1950e - Sur la succession et le style des phases tectoniques dans la Vanoise (zone du Briançonnais entre Arc et Isère). C. R. Acad. Sci., Paris, 231, p. 1524-1526.
- 1951 a - Le Crétacé supérieur briançonnais au nord de l'Arc et la nappe des schistes lustrés. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1951, p. 10-12.
- 1951b - Le géosynclinal briançonnais archaïque et les renversements de subsidence (Reliefumkehrung) dans la préorogenèse alpine. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1951, p. 133-136.
- 1951c - Polis éoliens rubéfiés sur le littoral languedocien. C. R. somm. Soc. géol. Fr.,
- 1951, p. 291-292.
- 1952a - Sur les rapports de la zone houillère et de la zone Vanoise - Mont Pourri avec le massif du Ruitor. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1952, p. 29-31.
- 1952b - La série mésozoïque de la couverture du massif d'Ambin (en coll. avec J. GOGUEL). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1952, p. 262-264.
- 1952c - Sur l'âge des marbres en plaquettes du Briançonnais et des marbres chloriteux de la Vanoise (en coll. avec M. LEMOINE et J. SIGAL). C. R. somm. Soc. géol. Fr.,
- 1952, p. 205-207.
- 1952d - Sur l'âge du métamorphisme dans la Vanoise. C. R. somm. Soc. géol. Fr 1952 p. 318-321.
- 1952e - Note préliminaire sur la faune et un niveau insectifère des lentilles de grès et schistes noirs des gypses de la Vanoise (Trias supérieur). (En coll. avec P. ELLEN-BERGER, D. LAURENTIAUX et J. RICOUR). Bull. Soc. géol. Fr., (6), 2, p. 269-274.
- 1953a - La série du Barrhorn et les rétrocharriages penniques. C. R. Acad. Sci., Paris, 236, p.218-220.
- 1953b - Sur l'extension des faciès briançonnais en Suisse, dans les Préalpes médianes et les Pennides. Eclogae geol. Helv., 45, p. 285-286.
- 1953c - La coupe du Roc du Bourget (Maurienne) et l'âge du Dogger à Mytilus dans la Vanoise. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1953, p. 87-89.
- 1954a - Migmatites d'âge permien dans la zone houillère briançonnaise (Alpes occidentales). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1954, p.64-67.
- 1954b - Réunion extraordinaire de la Société géologique de France en Maurienne et Tarentaise, 4-12 septembre 1954 : compte-rendu rédigé en collaboration avec R.BARBIER, J.-P. BLOCH, J. DEBELMAS et J. FABRE. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1954, p.435-505.
- 1954c - Observations à la communication de B. GÈZE : «Sur la tectonique des Causses du Quercy ». Bull. Soc. géol. Fr., (6), 4, p.465-466.
- 1955a - Bauxites métamorphiques dans le Jurassique de la Vanoise (Savoie). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1955, p. 29-32.
- 1955b - Les faciès prépiémontais et le problème du passage de la zone du Briançonnais aux schistes lustrés piémontais (en coll. avec M. LEMOINE). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1955, p. 146-148.
- 1955c - Linéations et grande tectonique. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1955, p. 174-177.
- 1956a - Quelques précisions sur la série du Stormberg au Basutoland (Afrique du Sud) (en coll. avec P. ELLENBERGER). C. R. Acad. Sci., Paris, 242, p. 799-801.
- 1956b - Le gisement de Dinosauriens de Maphutseng (Basutoland, Afrique du Sud). (En coll. avec P. ELLENBERGER). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1956, p.99-101.
- 1957a - Le stilpnomélane, minéral de métamorphisme régional dans la Vanoise. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1957, p. 63-65.
- 1957b - On a new Cynodont from the Molteno beds and the origin of the Tritylodontids (en coll. avec A. W. CROMPTON). Ann. South African Mus., 44, p. 1-14. Capetown.
- 1957c - Observations à la communication de M. LEMOINE : «Calcschistes piémontais et terrains à faciès briançonnais dans la haute vallée de l'Ubaye (Basses-Alpes)». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1957, p.45.
- 1957d - Observations à la communication de M. LANTEAUME : «Nouvelles données sur le flysch à Helminthoïdes de la Ligurie occidentale (Italie)». Bull. Soc. géol. Fr., (6), 7, p. 123.
- 1958a-Etude géologique du pays de Vanoise. (Thèse Sciences, Paris, 28 juin 1954). Mém. Serv. Carte géol. Fr., 562 p., 41 pi. h.t., dépliants.
- 1958b - Principaux types de pistes de Vertébrés dans les couches du Stormberg au Basutoland (Afrique du Sud) (Note préliminaire). (En coll. avec P. ELLENBER-GER). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1958, p.65-67.
- 1958c - Le problème des «gneiss du Sapey» : nouvelles observations dans la zone du Grand Saint-Bernard. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1958, p.45-47.
- 1958d - Sur quelques fossiles triasiques du Pennique frontal valaisan. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1958, p. 168-170.
- 1958e - Observations à la communication de J. AUBOUIN : «Essai sur l'évolution paléogéographique et le développement tecto-orogénique d'un système synclinal : le secteur grec des Dinarides (Hellénides)». Bull. Soc. géol. Fr., (6), 8, p. 750.
- 1959a - Quelques pistes de Vertébrés du Permien inférieur de Lodève (en coll. avec P. ELLENBERGER). C. R. Acad. Sci., Paris, 248, p.437-439.
- 1959b - Sur la terminaison nord-orientale du chaînon de Saint-Chinian (Hérault). C. R. Acad. Sci., Paris, 248, p.712-715.
- 1960a - Attribution du prix Viquesnel. Remerciements. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1960, p. 132-133.
- 1960b - Observations à la communication d'A. COMBES : «Présence d'une série mol-lassique tertiaire autour des collines de Boutenac (Aude)». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1960, p. 152-153.
- 1960c - Observations à la communication de M. LEMOINE : «Découverte d'une microfaune du Crétacé supérieur au Col du Longet (sources de l'Ubaye, Basses-Alpes) ; conséquences tectoniques et paléogéographiques». C. R. somm. Soc. géol. Fr.,
- 1960, p. 235.
- 1960d - Sur une nouvelle dalle à pistes de Vertébrés, découverte au Basutoland (Afrique du Sud). (En coll. avec P. ELLENBERGER). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1960, p. 236-238.
- 1960e - Sur une paragenèse éphémère à lawsonite et glaucophane dans le métamorphisme alpin en Haute-Maurienne (Savoie). Bull. Soc. géol. Fr., (7), 2, p. 190-194.
- 1960f - Observations à la communication de G. GUITARD : «Linéations, schistosité et phases de plissement durant l'orogenèse hercynienne dans les terrains anciens des Pyrénées orientales, leurs relations avec le métamorphisme et la granitisation». Bull. Soc. géol. Fr., (7), 2, p. 887.
- 1961 a - Observations à la communication de M. MATTAUER et L. THALER : « Découverte d'œufs et d'os de Dinosaures dans le Crétacé terminal des environs de Montpellier (Hérault) ». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1961, p. 8-9.
- 1961b - Age pliocène probable des limons jaunes à galets du Narbonnais occidental (« mollasses de Thézan », etc..) et jeux de failles tardifs. C. R. somm. Soc. géol. Fr..
- 1961, p. 183-184.
- 1961c - Observations à la communication de D. CURRY : «Sur la découverte de Num-mulites variolarius (Lamarck) dans le Lutétien des bassins de Paris et du Hampshire». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1961, p. 248.
- 196ld - Observations à la communication de P. BORDET : «Sur l'interprétation géologique de l'Himalaya». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1961, p.261.
- 1961e - Observations à la communication de J. AUBOUIN : «Propos sur les géosynclinaux». Bull. Soc. géol. Fr., (7), 3, p. 708.
- 1962a - Sur l'âge et la nature du métamorphisme hercynien dans la région de Lamalou-les-Bains (zone axiale de la Montagne Noire, Hérault) (en coll. avec P. COLLOMB et Y. FUCHS). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1962, p. 70-71.
- 1962b - Rapport sur l'attribution du prix de la Fondation Pierre Pruvost à M. Jean Fabre. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1962, p. 168-169.
- 1962c - Observations à la communication de P.-Ch. de GRACIANSKI : «Données stratigraphiques et tectoniques nouvelles sur la Montagne de Tauch». Bull. Soc. géol. Fr.,(D, 4, p.526.
- 1962d - Cours inaugural, 10 novembre 1962. Chaire de Géologie des grandes régions du Globe (Géologie structurale). Faculté des Sciences, Paris, Impr. Louis-Jean, Gap, 15 p.
- 1963a - Rabotage basai ou troncature basale ? Réflexions sur les charriages cisaillants. C. R. Acad. Sci., Paris, 257, p. 468-471.
- 1963b - Trias à faciès briançonnais de la Vanoise et des Alpes occidentales. In : « Colloque sur le Trias de la France et des régions limitrophes », Montpellier, 1961, Mém. BRGM, 15, p. 215-231.
- 1963c - Problèmes paléogéographiques et structuraux dans les zones internes des Alpes occidentales entre Savoie et Méditerranée (en coll. avec R. BARBIER, J.-P. BLOCH, J. DEBELMAS, J. FABRE, R. FEYS, M. GIDON, J. GOGUEL, Y. GUBLER, M. LANTEAUME, M. LATREILLE et M. LEMOINE). In : M. DU-RAND-DELGA (réd.) : L'évolution paléogéographique et structurale des domaines méditerranéens et alpins d'Europe ; Livre à la mémoire du Professeur Paul Fallot, II, Mém. h.s. Soc. géol. Fr., Paris, 1960-63, p. 331-377.
- 1963d - La Vanoise, un géanticlinal métamorphique. In : M. DURAND-DELGA (réd.); L'évolution paléogéographique et structurale des domaines méditerranéens et alpins d'Europe ; Livre à la mémoire du Professeur Paul Fallot, II, Mém. h.s. Soc. géol. Fr., Paris, 1960-63, p. 383-393.
- 1963e - La nouvelle chaire de Géologie à la Faculté des Sciences de Paris : Géologie des grandes régions du Globe (Géologie structurale). Rev. gén. Sci., 70, p. 7-8.
- 1963f - Observations à la communication de J. SARFATI : «Données nouvelles sur la série continue, Jurassique supérieur - Crétacé inférieur dans les Corbières orientales (Note préliminaire)». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1963, p.236-237.
- 1963g - Deux nouvelles dalles à pistes de Vertébrés fossiles découvertes au Basutoland (Afrique du Sud). (En coll. avec P. ELLENBERGER, J. FABRE et C. MENDREZ). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1963, p. 3 15-3 17.
- 1963h -Observations à la communication de J. GOGUEL : «L'interprétation de l'arc des Alpes occidentales». Bull. Soc. géol. Fr., (7), 5, p. 32-33.
- 1963i - Observations à la communication de J. AZÉMA, M. DURAND-DELGA et A. FOUCAULT : «Le problème structural de la Pinède de Durban-Corbières Languedoc (Aude). Bull. Soc. géol. Fr. (7), 5, p. 882.
- 1964a - Un nouveau lambeau avancé de la nappe des Corbières orientales sur le plateau de Poursan (Aude). Structures de troncature basale et réactions du substratum (en coll. avec S.-C. DUJON et J.-C. PLAZIAT). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1964, p. 46-48.
- 1964b - Sur une zone de failles néogènes prolongeant la flexure cévenole dans le pays narbonnais interne (données nouvelles sur les limons jaunâtres à galets ; le sondage d'Ornaisons). (En coll. avec F. HOULEZ). C. R. Acad. ScL, Paris, 258, p. 3526-3529.
- 1964c - Observations à la communication de J. RICOUR et J. SIGAL : Compte-rendu de la réunion du Comité du Mésozoïque méditerranéen (mai 1964). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1964, p. 197.
- 1964d - Les notions de troncature basale et de troncature sommitale en tectonique tangentielle. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1964, p. 280-282.
- 1964e - Découverte d'Ammonites et observations stratigraphiques dans les «Schistes lustrés» du Val Grana (Alpes cottiennes). (En coll. avec A. MICHARD et C. STURANI). C. R. Acad. ScL, Paris, 259, p. 3047-3050.
- 1964f - Observations à la communication d'A. MICHARD et C. STURANI : «La zone piémontaise dans les Alpes cottiennes du Cuneese, nouveaux résultats et nouvelles questions». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1964, p.383-384.
- 1964g - Observations à la communication de J. AUBOUIN : «Réflexions sur le faciès «ammonitico rosso»». Bull. Soc. géol. Fr., (7), 6, p.500.
- 1965a - Observations à la communication de M. MATTAUER et F. PROUST : «Sur l'autochtonie du massif de la Pinède de Durban-Corbières (Aude)». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1965, p. 32.
- 1965b - Sur la présence de pistes de Vertébrés dans le Lotharingien marin de la région de Sévérac-le-Château (Aveyron). (En coll. avec Y. FUCHS). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1965, p. 39-40.
- 1965c - Observations à la communication de J.-P. MANGIN : «La nomenclature stratigraphique et les étages du Paléogène». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1965, p. 171.
- 1965d - Observations à la communication de G. MENNESSIER : «Sur la structure des chaînons provençaux situés au SE du confluent du Verdon et de la Durance (Basse Provence). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1965, p. 305.
- 1965e - Observations à la communication de M. SEGURET et F. PROUST : « L'évolution tectonique post-hercynienne de la bordure mésozoïque des Cévennes méridionales entre Aies et Ganges. Bull. Soc. géol. Fr., (7), 7, p. 91.
- 1965f - Observations à la communication d'A. BLONDEAU, C. CAVELIER, L. FEU-GUEUR et Ch. POMEROL : «Stratigraphie du Paléogène du bassin de Paris en relation avec les bassins avoisinants». Bull. Soc. géol. Fr., (7), 7, p. 220.
- 1965g - Le «style pennique» : rhéomorphisme ou cisaillements? Application au Grand Paradis. C. R. Acad. ScL, Paris, 260, p. 4008-401 1.
- 1965h - L'arc de Saint-Chinian (Hérault) et la tectonique languedocienne. C. R. Acad. ScL, Paris, 260, p.6939-6942.
- 1965i - Age relatif et signification de la linéation régionale dans la Montagne Noire (massif du Caroux et ses enveloppes, Hérault). (En coll. avec P. COLLOMB). C. R. Acad. Sri., Paris, 261, p. 195-198.
- 1965j - Richesses géologiques de la Vanoise. Le Monde, n" 6014, 28 août 1965.
- 1966a - Le gisement de Dinosauriens triasiques de Maphutseng (Basutoland) et l'origine des Sauropodes (en coll. avec L. GINSBURG). C. R. Acad. ScL, Paris, (D), 262, p. 444-447.
- 1966b - La grille des linéations : un phénomène tectonique régional autonome. Signification tectonique de la linéation régionale (en coll. avec P. COLLOMB). C. R. Acad. ScL, Paris, (D), 262, p. 1832-1835.
- 1966c - Signification tectonique de la linéation régionale (en coll. avec P. COLLOMB). C. R. Acad. ScL, Paris, (D), 262, p. 1921-1924.
- 1966d - Le Permien du Pays de Vanoise. In : Symposium sul Verrucano, Società toscana Scienze naturali, Pisa, p. 170-211.
- 1966e - Observations à la communication de M. MATTAUER et M. SEGURET : « Sur le style des déformations tertiaires de la zone axiale hercynienne des Pyrénées». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1966, p. 12.
- 1966f - Observations à la communication de J.-P. H. CARON, G. GUIEU et C. TEMPIER : «Quelques aspects de la tectonique tangentielle en Basse-Provence occidentale». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1966, p. 45.
- 1966g - Observations au compte-rendu de la Réunion extraordinaire de la Société géologique de France dans les Alpes autrichiennes. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1966, p. 448 et suiv.
- 1967a - Paléotopographie et podzols résiduels au sommet des sables de Fontainebleau (en coll. avec R. FEYS et J. TRICHET). C. R. Acad. ScL, Paris, (D), 264, p. 689-692.
- 1967b - Les interférences de l'érosion et de la tectonique tangentielle tertiaire dans le Bas-Languedoc (principalement dans l'arc de Saint-Chinian); notes sur les charriages cisaillants. Rev. Géogr. phys. Géol. dyn., (2), 9, p. 87-140.
- 1967c - Sur les jeux des failles pliocenes et quaternaires dans l'arrière-pays narbonnais (en coll. avec M. GOTTIS). Rev. Géogr. phys. Géol. dyn., (2), 9, p. 153-159.
- 1967d - L'arc de Saint-Chinian et la tectonique languedocienne de charriages cisaillants. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1967, p. 34-36.
- 1967e - Tectonique «pennique» à découvert : le grand pli couché de Vanoise septentrionale (Savoie) et ses structures de détail surimposées (en coll. avec P. SALIOT). C. R. Acad. ScL, Paris, (D), 264, p. 1569-1572.
- 1967f - Rapport sur l'attribution du Prix de la Fondation Pierre Pruvost à M. Gérard GUITARD. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1967, p. 196-198.
- 1967g - The appearance and evolution of Dinosaurs in the Trias and Lias ; a comparison between South African upper Karroo and Western Europe based on Vertebrate footprints (en coll. avec P. ELLENBERGER et L. GINSBURG). Actes 2ème Symposium du Gondwana, Mar del Plata, octobre 1967, Unesco.
- 1967h - Polymétamorphisme et «effets de couverture» dans la zone axiale de la Montagne-Noire (Espinouse et Caroux, Hérault). (En coll. avec S. BOGDANOFF et P. COLLOMB). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1967, p. 223-224.
- 1967i - Sur l'enveloppe sédimentaire de la zone axiale de la Montagne-Noire (monts St. Gervais, Hérault). (En coll. avec L. LATOUCHE). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1967, p. 225-227.
- 1967j - Replis de micaschistes et tectonique d'infrastructure au sein du massif gneissique du Caroux (zone axiale de la Montagne-Noire). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1967, p. 227-228.
- 1967k - La schistosité régionale, structure d'arrêt de la déformation tectonique (en coll. avec P. COLLOMB). C. R. Acad. Set, Paris, (D), 264, p. 2970-2973.
- 19671 - Réponse à la communication de F. ARTHAUD, M. MATTAUER et F. PROUST : «A propos des nappes de style pennique de la zone axiale de la Montagne-Noire, observations à une note récente de F. ELLENBERGER». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1967, p. 328-329.
- 1967m - Géologie du Parc national de la Vanoise (en coll. avec L. MORET et P. GIDON). In : Le Parc national de la Vanoise, Imprimeries réunies, Chambéry, p. 33-46.
- 1968a - Observations à la communication d'A. CAIRE, A. COUTELLE et D. OBERT : «Tectonique des extrémités de la chaîne des Babors». Bull. Soc. géol. Fr., (7), 10, p. 677-678.
- 1968b - Introduction à la géologie structurale de l'Europe. Première partie : les fondements historiques et méthodologiques de la géologie structurale. Cours Université d'Orsay, XXII + 119 p.
- 1969a - Observations à la communication de P. ANDREIEFF, Ph. BOUYSSE, J.-J. CHATEAUNEUF, A. L'HOMER et G. SCOLARI : «La couverture sédimentaire meuble du plateau continental externe de la Bretagne méridionale (Nord du golfe de Gascogne, France)». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1969, p. 158.
- 1969b - Observations au compte-rendu de la réunion extraordinaire de la Société géologique de France. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1969, p. 375-376 et 386-387.
- 1969c - Observations à la communication de J. SOUGY : « Grandes lignes structurales de la chaîne des Mauritanides et de son avant-pays (socle précambrien et sa couverture infracambrienne et paléozoïque), Afrique de l'Ouest». Bull. Soc. géol. Fr., (7), 11, p. 148.
- 1969d - Observations à la communication de M. WATERLOT : «Grands faits stratigra-phiques et paléogéographiques du Carbonifère anté-stéphanien des Pyrénées centrales espagnoles». Bull. Soc. géol. Fr., (7), 11, p.510.
- 1970a - Les Dinosaures du Trias et du Lias en France et en Afrique du Sud d'après les pistes qu'ils ont laissées. (En coll. avec P. ELLENBERGER et L. GINSBURG). Bull. Soc. géol. Fr., (7), 12, p. 151-159.
- 1970b - Observations à la communication de J. DERCOURT : «L'expansion océanique actuelle et fossile; ses implications géotectoniques». Bull. Soc. géol. Fr, (7), 12, p. 3 15-3 16.
- 1970c - Observations à la communication de J.-H. BRUNN, P.-Ch. de GRACIANSKI M GUTNIC, T. JUTEAU, R. LEFÈVRE, J. MARCOUX, O. MONOD et A. POISSON : «Structures majeures et corrélations stratigraphiques dans les Taurides occidentales». Bull. Soc. géol. Fr., (7), 12, p.556.
- 1970d - Observations à la communication de J.-P. CADET : «Esquisse géologique de la Bosnie-Herzégovine méridionale et du Monténégro occidental ». Bull. Soc. géol. Fr.,0), 12, p. 984.
- 1970e - Quelques remarques historiques sur le concept de géosynclinal. C. R. Acad. Sri., Paris, (D), 271, p. 469-472.
- 1970f- Europe (Géologie). Encycl. Universalis, Paris, 6, p. 765-770.
- 1970g - France (Géologie) (Bas-Languedoc). Encycl. Universalis, Paris, 7, p. 256-257.
- 1970h - Germano-Polonaise (Plaine). Encycl. Universalis, Paris, 7, p. 704-705.
- 1970i - Hercyniens (Massifs). Encycl. Universalis, Paris, 8, p. 357-360.
- 1970j - Hutton (James) 1726-1797. Encycl. Universalis, Paris, 8, p. 618-619. Rééd. 1995, 11, p. 757-759.
- 1971a - Observations à la communication de G. BOILLOT, P. A. DUPEUBLE, M. LAMBLOY, L. D'OZOUVILLE et J.-C. SIBUET : «Les prolongements occidentaux de la chaîne pyrénéenne sur la marge continentale nord-espagnole entre 4° et 9° de longitude ouest». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1971, p. 14.
- 1971b - Observations à la communication de P.-F. BUROLLET et E. F. GUILLAUME : «Réflexions sur les mécanismes tectoniques continus». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1971, p. 18.
- 1971c - Originalité de la chaîne Scandinave; relations fonctionnelles entre socle et Calédonides. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1971, p. 136-137.
- 1971d - Sur le caractère second des relations entre la mégatectonique et les petites structures. Quelques exemples norvégiens. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1971, p. 148-149.
- 1972a - Allocution présidentielle. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1972, p.6-11.
- 1972b - Observations à la communication de J. MERCIER et P. VERGELY : «Les mélanges colorés («Coloured-Mélanges») de la zone d'Almopias (Macédoine, Grèce)». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1972, p.73.
- 1972c - Observations à la communication de B. PURSER : «Dolomitisation synsédimen-taire dans le Bathonien de Dijon ». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1972, p. 85.
- 1972d - Observations à la communication de P. ROGNON et F. GASSE : « Néotectonique des dépôts lacustres de l'Holocène inférieur du graben de Dobi (Afar, Ethiopie). C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1972, p.212.
- 1972e - La métaphysique de James Hutton et le drame écologique contemporain. 24ème Congrès géologique international, Montréal, Abstracts, p. 488.
- 1972f - Propos liminaires : quelques remarques sur l'originalité du bâti Scandinave occidental ; relations fonctionnelles entre socle et Calédonides. Sri. de la Terre, 17, p.7-16.
- 1972g - Sur F absence fréquente de toute relation claire entre événements microtectoniques et mégatectoniques. Quelques exemples norvégiens. Sci. de la Terre, 17, p. 235-256.
- 1972h - Quelques remarques historiques sur la «maladie infantile» de la stratigraphie. In : « Colloque sur les méthodes et tendances de la stratigraphie », Orsay, septembre 1970, Mém. BRGM, 77, ( 1 ), p. 27-30.
- 1972i - Les origines de la pensée huttonienne : Hutton étudiant et docteur en médecine. C. R. Acad. Sci., Paris, 275, Vie académique, p. 69-72.
- 1972j - De Bourguet à Hutton, une source possible des thèmes huttoniens : originalité irréductible de leur mise en œuvre. C. R. Acad. Sci., Paris, 275, Vie académique, p. 93-96.
- 1972k - La métaphysique de James Hutton ( 1726-1797) et le drame écologique du XXème siècle. Rev. Synthèse, (III), n° 67-68, p. 267-283.
- 19721 - Scandinavie. Encycl. Universalis, Paris, 14, p. 703-705.
- 1973a - Allocution du Président sortant. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1973, p. 11-12 et 78-81.
- 1973b - Werner (Abraham, Gottlob), 1749-1817. Encycl. Universalis, Paris, 16, p. 983-984. Rééd. 1995, 23, p. 845-846.
- 1973c - La thèse de doctorat de James Hutton et la rénovation perpétuelle du monde. Ann. Guébhard, 49, p. 497-533.
- 1974a - L'enseignement géologique de François Rouelle (1703-1770). 5° reun. cient. I.U.G.S., Intern. Comm. Hist. Geol. Sci., Madrid, p.209-221.
- 1974b - Sur le rajeunissement de l'illite des pélites saxoniennes du bassin de Lodève (en coll. avec H. BELLON et R. MAURY). C. R. Acad. Sci., Paris, (D), 278, p. 413-415.
- 1974c - Les «schistes x» de la Montagne Noire (Caroux, Espinouse). (En coll. avec N. SANTARELLI). 2ème réun. ann. Sci. Terre, Nancy, p. 161.
- 1974d - Les «schistes x» de la Montagne Noire orientale : distinction d'unités lithostratigraphiques et conséquences tectoniques. (En coll. avec N. SANTARELLI). C. R. Acad. Sci., Paris, (D), 278, p. 2409-2412.
- 1974e - Observations à la communication de J. LUCAS : «Quelques considérations sur les argiles du Trias à faciès germanique». Bull. Soc. géol. Fr., (7), 16, p.678.
- 1974f - Introduction à la Géologie de la France (en coll. avec J. DEBELMAS). In : J. DEBELMAS, Géologie de la France, vol. I, Doin, Paris, p. 8-40.
- 1975a - Rapport sur l'attribution du Prix Prestwich à M. Marcel LEMOINE. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1975, p. 126-127.
- 1975b-Un précurseur méconnu de James Hutton : l'ingénieur Henri Gautier (1660-1737). C. R. Acad. Sci., Paris, 280, Vie académique, p. 165-168.
- 1975c - La structure du globe terrestre et la genèse des montagnes selon l'ingénieur Henri Gautier. C. R. Acad. Sci., Paris, 280, Vie académique, p. 189-192.
- 1975d - La chaîne calédonienne Scandinave et les modèles alpins. 3ème réun. ann. Sci. Terre, Montpellier, p. 141.
- 1976a - Epirogenèse et décratonisation. Bull. BRGM, Paris, (2), section I, n° 4, p. 357-382.
- 1976b - A l'aube de la Géologie moderne : Henri Gautier (1660-1737). Première partie : les antécédents historiques et la vie d'Henri Gautier. Histoire et Nature, 1, p. 3-58.
- 1977a - Tectonique comparée des Calédonides Scandinaves et des Mauritanides ouest africaines (en coll. avec J. SOUGY, R.C.P. 375 et L.A. 132). Sème réun. ann. Sci. Terre, Rennes, p. 216.
- 1977b - Evolution paléogéographique comparée des Calédonides Scandinaves et des Mauritanides ouest-africaines (en coll. avec J. SOUGY, R.C.P. 375 et L.A. 132). 5ème réun. ann. Sci. Terre, Rennes, p. 217.
- 1977c - Une géotraverse dans les Calédonides Scandinaves - Partie I : Externides ; leur signification géodynamique (en coll. avec A. E. PROST, J.-C. GUEZOU, R. POINT, J.-M. QUENARDEL, N. SANTARELLI et A. HENRY). Sème réun. ann. Sci. Terre, Rennes, p. 395.
- 1977d - Une géotraverse dans les Calédonides Scandinaves - Partie II : Internides et événements dévoniens (en coll. avec A. E. PROST, J.-C. GUEZOU, R. POINT, J.-M. QUENARDEL, N. SANTARELLI et A. HENRY). 5ème réun. ann. Sci. Terre, Rennes, p. 396.
- 1977e - Une transversale dans les Calédonides Scandinaves centrales : du socle baltique à la côte atlantique (en coll. avec A. E. PROST, J.-C. GUEZOU, R. POINT, J.-M. QUENARDEL, N. SANTARELLI et A. HENRY). Rev. Géogr. phys. Géol. dyn., (2), 19, p. 481-502.
- 1977f - Références bibliographiques sur les Calédonides Scandinaves (en coll avec A. E. PROST, J.-C. GUEZOU, R. POINT, J.-M. QUENARDEL, N. SANTARELLI et A. HENRY). Rev. Géogr. phys. Géol. dyn., (2), 19, p. 515-522.
- 1977g - Le dilemme des montagnes au XVIIIème siècle : vers une réhabilitation des diluvianistes. Trav. Comité fr. Hist. Géol., (1), n° 6, 6p. ; Rev. Hist. Sci., 31 (1978), p.43-52.
- 1978a- A l'aube de la géologie moderne : Henri Gautier (1660-1737). Deuxième partie : la théorie de la Terre d'Henri Gautier. (Documents sur la naissance de la science de la Terre en langue française). Histoire et Nature, 9-10, p. 1-149.
- 1978b - Précisions nouvelles sur la découverte du volcanisme en France : Guettard, ses prédécesseurs, ses émules clermontois. Trav. Comité fr. Hist. Géol., (1), n° 11, 6 p.
- 1978c - Bourguet Louis. Dictionary scient. Biography, Scribner's sons, New York, XV (suppl. 1), p. 52-59.
- 1978d - The first International Geological Congress, Paris, 1878. Episodes, Ottawa, 1978, 2, p. 20-24.
- 1978e - Déluges et plaques : propos d'un mandarin impertinent. C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1978, p. 171-172.
- 1979a - Roy Porter: The making of geology. Earth sciences in Britain, 1660-1815. (Analyse d'ouvrage). Rev. Hist. Sci., 32, p. 177-182.
- 1979b - Les enseignements géologiques des rochers de la Lauze à Pralognan (Vanoise). (En coll. avec J.-F. RAOULT). Trav. scient. Parc national de la Vanoise, 10, p. 37-67.
- 1979c - Précisions nouvelles sur la découverte du volcanisme en France : Guettard, ses émules clermontois. Histoire et Nature, 12, p. 33-42.
- 1979d- Origine et histoire du terme Horizon en géologie et en paléontologie. Un exemple d'éclatement sémantique. Trav. Comitéfr. Hist. Géol, (1), n° 16, 10 p; Documents pour l'histoire du vocabulaire scientifique, n° 1 (1980), C.N.R.S., p. 69-90.
- 1979e-Louis Cordier, initiateur de la pétrographie moderne. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (1), n°20, 13p.
- 1980a - Postulat sur la durée ou sur la force? In : Table ronde sur «temps long - temps court» dans l'histoire de la géologie. Trav. Comité fr. Hist. Géol. n° 23, 11 p.
- 1980b - Le Paléozoïque au sud du Massif Central : Montagne Noire et Massif de Mouthoumet (avec la participation de F. BOYER). In.: C. LORENZ (Coord.). Géologie des pays européens, France - Belgique - Luxembourg, Dunod, Paris, et Bull. Centre rech. expl. Prod. Elf-Aquitaine, Mém. 3, Pau, p. 204-211.
- 1980c - La zone alpine du Bas Languedoc. In : C. LORENZ (Coord.). Géologie des pays européens France - Belgique - Luxembourg, Dunod, Paris, et Bull. Centre rech. expl. Prod. Elf-Aquitaine, Mém. 3, Pau, p. 224-230.
- 1980d - Origine et histoire du terme « horizon » en géologie et paléontologie. Un exemple d'éclatement sémantique. Documents pour l'histoire du vocabulaire scientifique, n°l, C.N.R.S.,p.21-33.
- 1980e - Les anciennes carrières souterraines de Paris (en coll. avec J. MARVY et M. VIRE). Bull. Inf. Géol. Bass. Paris, vol. h.s., Excursion B-32 du 26è Congrès géologique international, 12 p.
- 1980f- «Aux sources de la géologie française». Guide de voyage à l'usage de l'historien des Sciences de la Terre. Excursion 138 A, 26ème Congrès géologique international, Paris, juillet 1980. Histoire et Nature, 15, p. 1-29.
- 1980g - De l'influence de l'environnement sur les concepts : l'exemple des théories géodynamiques au XVIIIème siècle en France. Rev. Hist. Sci., 33, p. 33-68.
- 1980h - Hercynian Europe (en coll. avec G. TAMAIN). Episodes, 1, sp. issue, 26th intern, geol. Congr., Paris, p. 22-27.
- 1980i - Coup d'oeil rétrospectif sur le dernier demi-siècle écoulé. In.: Livre jubilaire du cent cinquantenaire 1830-1980. Soc. géol. Fr., Paris, Mém. h.s., 10, p. 25-35.
- 1980j - Jean-André De Luc (1727-1817) et l'aurore de la stratigraphie paléontologique (en coll. avec G. GOHAU). Trav. Comité fr. Hist. Géol, (1), n° 32, 9p.
- 1981a - Une théorie de la connaissance méconnue : la métaphysique de James Hutton (1726-1797). Centre interdisciplinaire d'Etude de l'Evolution des Idées, des Sciences et Techniques, Orsay. Actes des séminaires et tables rondes de l'année universitaire 1979-1980, fasc. I, communications, p. 5-29.
- 1981b - Un exemple d'éclatement sémantique : origine et histoire du terme «horizon». C. R. somm. Soc. géol. Fr., 1981, p. 10-13.
- 1981c - A l'aurore de la stratigraphie paléontologique. Jean-André De Luc, son influence surCuvier. (En coll. avec G. GOHAU). Rev. Hist. Sci., 34, p.317-357.
- 1981d - Le problème des grès de Fontainebleau : premiers travaux méconnus. Du danger des cribles conceptuels dans la vision des faits. Trav. Comité fr Hist Géol ( 1 ) n°36, 18p.
- 1982a - Coupures ou continuité : un vieux débat toujours actuel. 9ème réun. ann. Sci. Terre, Paris, p. 231.
- 1982b - La coupure Crétacé - Tertiaire : un événement biostratigraphique singulier encadré de multiples coupures d'origine géodynamique. (En coll. avec J.-C. PLA-ZIAT). 9ème réun. ann. Sci. Terre, Paris, p. 514.
- 1982c - Le problème des grès de Fontainebleau; quelques données nouvelles. Cahiers Univ. Paris-Sud (XI), n° 3, p. 163-179, pi. dépl.
- 1982d - Marcel Bertrand et « l'orogenèse programmée ». Geol. Rundschau, 71, p. 463-474 + Erratum, Ibid, 71, p. 757.
- 1982e - Les premières cartes géologiques en France : projets et réalisations. Trav. Comité fr. Hist. Géol. (1), n°45, 35 p.
- 1982f - A propos de la limite Crétacé - Tertiaire : la réconciliation moderne des conceptions continue et discontinue en stratigraphie et en tectonique (en coll. avec J.-C. PLAZIAT). Bull. Soc.géol. Fr., (7), 24, p. 831-841.
- 1982g - Esquisse d'une trajectoire de la géologie francophone jusqu'en 1832. Histoire et Nature, 19-20, p. 5-20.
- 1982h - Early French geological maps : trends and purposes. In : E. DUDICH (éd.). Contributions to the history of geological mapping. Proc. 10th INHIGEO Symposium, Akadémiai Kiadô, Budapest, p. 73-82.
- 1983a - Recherches et réflexions sur la naissance de la cartographie géologique en Europe et plus particulièrement en France. Histoire et Nature, 22-23, p. 3-54.
- 1983b-La dispute des lignites du Soissonnais. Trav. Comité fr. Hist. Géol.,(2), l,p. 1-22; Bull. Inf. Géol. Bass. Paris, 20, (4) (1983), Paris, p. 27-34.
- 1983c - Documents pour une histoire du vocabulaire de la géologie : Le terme de « géographie souterraine ». Documents pour l'histoire du vocabulaire scientifique, n°4, C.N.R.S.,p. 35-42.
- 1984a - Quelques idées anciennes sur la constitution interne du globe terrestre. Trav. Comité fr. Hist. Géol. (2), 2, p. 1-19.
- 1984b - L'histoire des idées sur les chaînes de montagnes de Hutton à Wegener: présentation d'un ouvrage récent, avec commentaire critique. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (2), 2, p. 63-88.
- 1984c - Le problème des grès de Fontainebleau : bref coup d'oeil historique. Bull. Inf. Géol Bass. Paris, 21, (2), Paris, p. 5-10. Contribution à l'étude géologique de la forêt de Fontainebleau : structure fine des bandes gréseuses et moulages de racines. Ibid, p. 11-21, p. 105-109, pi. dépl.
- 1984d - Louis Cordier ( 1777-1861 ), initiateur de l'étude microscopique des laves : percée sans lendemain ou innovation décisive? Earth Sci. Hist., 3, p.44-53.
- 1984e - Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille Bédarieux. (En coll. avec S. BOGDANOFF et M. DOUNOT). BRGM.
- 1985a - Documents pour l'histoire du vocabulaire de la géologie : l'expression «causes actuelles»; un curieux cas de fausse accusation d'anglicisme. Documents pour l'histoire du vocabulaire scientifique, n° 7, C.N.R.S., p. 67-75.
- 1985b - Le problème des grès de Fontainebleau. Premiers travaux méconnus ; remarques épistémologiques. Cahiers des Naturalistes, Bull. N.P., n.s., 41, p. 35-46.
- 1985c - Analyse d'ouvrage : D. C. Ward et A. V. Carozzi, Geology emerging. A catalog illustrating the History of Geology (1500-1850) from a collection in the library of the University of Illinois at Urbana-Champaign. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (2), 3, p.85-87.
- 1986a - Les premiers travaux géologiques en Provence. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (2), 4, p. 23-31.
- 1986b - Brève évocation de Jean-Etienne Guettard (1715-1786), à l'occasion du bicentenaire de sa mort. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (2), 4, p. 85-90.
- 1986c - Notes de lecture : Jean-Claude [lire Claude-Jean] Allègre, De la Pierre à l'Etoile (Paris, Fayard, 1985). Trav. Comité fr. Hist. Géol, (2), 4, p. 95-100.
- 1987a - Les causes actuelles en géologie. Origine de cette expression : la légende et la réalité. Bull. Soc. géol. Fr., (8), 3, p. 199-206.
- 1987b - Un centenaire à commémorer : la découverte des charriages de Provence par Marcel Bertrand. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 1, p. 49-56.
- 1987c - Hommage à André Cailleux (1907-1986). Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 1, p.101-113.
- 1987d - Jan van Gorp (Goropius Becanus), 1518-1572 : un pionnier méconnu de l'étude des fossiles au XVIème siècle. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 1, p. 9-27 ; In : G. GIGLIA, C. MACCAGNI, N. MORELLO (éd.) : Rocks, Fossils and History, Festina Lente, Firenze (1995), p. 27-43.
- 1987e - Carte géologique de la France à 1/50 000, feuille Capendu. (En coll. avec P. FREYTET, J.-C. PLAZIAT, G. BESSIERES, G.-M. BERGER et J.-P. MARECHAL). BRGM.
- 1988a - Histoire de la Géologie. T. 1. Des Anciens à la première moitié du XVIIe siècle, Technique et Documentation Lavoisier, Paris, 352 p.
- 1988b - Remarques additionnelles sur le livre de Rachel Laudan «from Mineralogy to Geology : the foundation of a science : 1650-1830». Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 2, p.61-65.
- 1988c - Un remarquable texte arabe médiéval sur le cycle érosion - sédimentation, dans une traduction nouvelle. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 2, p. 75-80.
- 1989a - La première coupe historique du stratotype d'Etampes dressée par Lavoisier en 1767. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 3, p. 7-20.
- 1989b - Les méconnus : eighteenth century French pioneers of geomorphology. In : K.J. TINKER (ed.) : History of Geomorphology, Unwin Hyman, Boston, p. 11-36.
- 1989c - Etude du terme « Révolution ». Documents pour l'histoire du vocabulaire scientifique, n° 9, C.N.R.S., p. 69-90.
- 1989d - Historia de la Geologia, vol. 1. De la Antigüedad al siglo XV. M.E.C., Editorial Labor s.a., Barcelona, 282 p.
- 1990a - Jacques Roger, humaniste. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 4, p. 43-45.
- 1990b -Johann Scheuchzer, pionnier de la tectonique alpine. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 4, p. 85-115.
- 1991a - Ovide et la géologie. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 5, p. 17-27.
- 1991b - La paléontologie britannique naissante et ses dilemmes. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 5, p. 29-60.
- 1991c - Recherches d'amateur sur la Phyllotaxie. La mathématique végétale. Centre interdisciplinaire d'Etude de l'Evolution des Idées, des Sciences et Techniques, Orsay, 64 + 4 p., 27 pi. (151 fig. ).
- 1992a - Les sciences de la Terre avant Buffon : bref coup d'œil historique. In Buffon 88, Vrin, Paris, p. 327-342.
- 1992b - Deux lointains précurseurs dans la géologie du Bassin Parisien. Bull. Inf. Géol. Bass. Paris, 29, (2), p. 5-7.
- 1992c - Giovanni Arduino (1714-1795) : le génial vénitien. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 6, p.93-108.
- 1992d - Commémoration du bicentenaire de la naissance de Roderick Impey Murchison (1792-1871). Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 6, p. 119-120.
- 1992e - (Attribution de la Sue Tyler Friedman Medal). Reply, Geoscientist, vol. 2, n° 4, p. 31-32.
- 1993a - En souvenir de Georgette Legée. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 7, p. 31-34.
- 1993b- Observations sur la communication de C. LORENZ. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 7, p.45-47.
- 1993c - La méthode en géologie vue par ses premiers acteurs et ses leçons toujours actuelles. Trav. Comité fr. Hist. Géol., (3), 7, p. 75-104.
- 1993d - Adresse présidentielle. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 7, p. 113-118.
- 1993e - Analyse d'ouvrage : Ezio Vaccari : Giovanni Arduino (1714-1795). Il contributo di uno scienziato veneto al dibattito settecentesco sulle scienze della Terra. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 7, p. 125-132.
- 1994a - Histoire de la Géologie, T. 2. La grande éclosion et ses prémices 1660-1810, Technique et Documentation Lavoisier, Paris, 383 p.
- 1994b - Adresse présidentielle. Trav. Comité fr. Hist. Géol., (3), 8, p. 111-115.
- 1995a - (Presentation of the History of Geology Division Award). Response. Geol. Soc. Amer., GSA Today, march 1995, p. 58.
- 1995b - Introduction. In : Essais sur l'histoire de la géologie en hommage à Eugène Wegmann (1896-1982). Mém. Soc. géol. Fr., 168, Paris, p. 1-11.
- 1995c - Johann Scheuchzer ( 1684-1738), pionnier de la tectonique alpine. /;; : Essais sur l'histoire de la géologie en hommage à Eugène Wegmann (1896-1982). Mém. Soc. géol. Fr., 168, Paris, p. 39-53.
- 1995d - Quelques souvenirs personnels sur Raymond Ruyer. In.: L. VAX et J.-J. WUNENBURGER (éd.) : Raymond Ruyer : de la science à la théologie, Editions Kimé, Paris, p.323-333.
- 1995e - Epéirogenèse. Encycl. Universalis, Paris, 8, p. 525-528.
- 1995f - Géologie. A. Histoire des sciences de la Terre. Encycl. Universalis, Paris, 10, p.321-325.
- 1996a - History of Geology, vol. I. From Ancient times to the first half of the XVII Century. A.A. Balkema, Rotterdam, Brookfield, 299p.
- 1996b - Le présent, clef du passé. Trav. Comité Fr. Hist. Géol. (3), 10 (à paraître).
- 1996c - Les leçons toujours actuelles de l'histoire de la géologie. Trav. Comité fr. Hist. Géol, (3), 10 (à paraître).
- 1997 - Histoire d'un cheminement. In G. GOHAU et J. GAUDANT (éd.) : De la Géologie à son Histoire, Editions du CTHS, Paris (à paraître).
- A paraître - History of Geology, vol. II.
Bernard GÈZE
A l'ami François Ellenberger
qui a réussi la prouesse de compliquer
encore plus que moi l'interprétation
structurale de la Montagne Noire.
Peu de jours après la publication de Présidents à gratter où je racontais mes souvenirs personnels sur deux douzaines de présidents de la Société géologique de France, tous aujourd'hui disparus [Travaux du Comité français d'Histoire de la Géologie , 3ème série, t. V, 1991, p. 99-115], je recevais des lettres de confrères me félicitant et, parfois, regrettant que je n'aie pas fait preuve de plus de virulence dans ma façon d'«égratigner» certains de ces personnages.
Par contre, au même moment, le bureau dudit Comité recevait deux lettres de confrères indignés, trouvant mon texte inadmissible et signifiant fermement leur démission. Regrettant, comme moi cette réaction d'amis imperméables à l'humour cum grano sali, François Ellenberger me suggéra d'égratigner quelques autres présidents encore bien vivants...dont lui et moi ! Voici donc la prose requise.
Le nom même de notre cher président (qui fut tardivement président de la Société géologique en 1972, alors qu'il m'avait fait élire à cette charge en 1954) évoque à la fois la belle Hélène et le berger Paris, dont chacun sait depuis Homère qu'ils furent causes de la guerre de Troie, bien que Jean Giraudoux ait exprimé le contraire en 1935, en déclarant La guerre de Troie n'aura pas lieu (pièce en deux actes). Pour nous, il s'agit ici d'une autre guerre : celle entre trois géologues (souvent un plus grand nombre) qui arpentaient la Montagne Noire et d'autres contrées du Midi de la France.
De atrae montanae bello fut le titre d'une magnifique œuvre écrite — en vers de mirliton ! — par un «Anonyme du XXème siècle » dans les années 50 si j'ai bonne mémoire. Envoyée depuis l'Ecole normale supérieure de Paris, où se trouvait un Agrégé préparateur du nom de François Ellenberger, elle provoqua une réponse ejusdem farinae postée à Montpellier. Tout aussi anonyme et de surcroît apocryphe, elle aurait dû évidemment avoir eu pour auteur Maurice Mattauer (Président de la Société géologique en 1977) ! Enfin, vint de l'Institut Agronomique la lettre suivante :
-
« Cher confrère, ennemi occasionnel et ami permanent,
Vous savez probablement déjà que la bibliographie négrimontaine vient de s'enrichir d'une œuvre d'une haute inspiration géologico-folklorique intitulée fort noblement De atrae montanae bello.
Malgré un certain relent de latinus culinaris (ou coquinaris), variété normalensis , ce titre convient parfaitement à l'admirable poème composé en vers et contre tous par l'auteur «Anonyme du XXème siècle» que nous connaissons depuis longtemps pour sa grande bravoure et pour sa haute taille (sans parler de ses idées sympathiquement farfelues).
Mais ce chant impérissable ayant agité mes petites cellules grises, a remis dans ma mémoire vacillante une courte page semi-confidentielle datant de quelques lustres et qui gisait sous plusieurs mètres cubes de paperasses oubliées. La conclusion de cet essai fort modeste présentant une incontestable analogie avec celle de l'œuvre épique qui nous pique (gentiment), j'ai pensé à vous la soumettre en vous la dédiant, ô vous tous, confrères atteints de mélanorophilie, schwarzbergite, tchernagorisme et autres négromonties incurables, bien que non atrabilaires. »
Autre anonyme du XXème siècle
Suivait un passage expliquant que les visions structurales de toutes les couleurs aboutissaient à un beau noir, comme le Chaos avant l'invention de la lumière par Dieu le Père, mais que les géologues avaient enfin déclaré que tout était bien, puisque l'immortalité était acquise à leurs noms par leur nouvelle réalisation du Chaos.
Hélas ! trois fois hélas ! (un hélas pour chacun des «Anonymes » afin de ne pas faire de jaloux), une telle conclusion s'est montrée incroyablement naïve : la plupart des travaux actuels oublient délibérément de mentionner des publications datant de près d'un demi-siècle, autant dire du Déluge ! Il est tellement plus simple (et plus payant !) de repartir à zéro... Sic transit gloria mundi.
Que ces considérations ne nous empêchent pas, au contraire, de remonter encore un peu dans le passé. C'était en 1937 ;je venais d'achever la rédaction d'un Diplôme d'Etudes supérieures sur l'hydrologie et la morphologie de la bordure sud-ouest du Massif Central, c'est-à-dire des Causses du Quercy méridional, dôme de la Grésigne compris, lorsque parut au bulletin de la Société d'Histoire naturelle de Toulouse une superbe étude géologique de ce même dôme. L'auteur était un certain François Ellenberger, aussi inconnu que moi auparavant. J'étais un peu vexé de cette concomitance de travaux, mais enfin nos points de vues n'étaient pas vraiment inconciliables.
L'année suivante, je commençais des levers pour la révision de la feuille géologique à 1/80 000 de Castres et j'étais tout content d'avoir découvert une monumentale lacune dans la première édition. Des sédiments tertiaires affleuraient à l'Est de Mazamet sur quinze kilomètres de plus que ce qui était figuré et les gneiss de la Montagne Noire les dominaient suivant une limite faillée. Parut alors dans le bulletin de la même société toulousaine une excellente description de la «faille de Mazamet» avec interprétation du «pli de fond» chevauchant le Tertiaire. Et elle était encore signée François Ellenberger. Vous avouerez qu'il y avait de l'abus !
Le risque de conflagration s'évanouit heureusement lorsque nous fîmes enfin connaissance, mais il ne faut pas croire que tout était fini entre nous. En 1940, François Ellenberger eut la malchance d'être fait prisonnier et interné dans un « Oflag » en Bohême autrichienne (ou Waldviertel), où il dispensa un prodigieux enseignement universitaire, tandis que j'avais la chance de pouvoir gagner la zone non occupée par nos «cousins germains». Jean Goguel me mit alors en demeure de réviser les feuilles géologiques à 1/80 000 de Cahors et Montauban qui couvrent la région de la Grésigne, où un troisième Diplôme d'Etudes supérieures venait d'être rédigé par le jeune Michel Durand-Delga (devenu président de la Société géologique en 1975). A la libération, nous fûmes donc trois à nous chamailler sur le même terrain. Nous consacrâmes trois journées homériques à essayer de nous mettre d'accord, M.D.-D. et moi à bicyclette, F.E. à pied car son vélo n'avait pas suivi en chemin de fer. Le plus fort est que ce «pedestrian», fonçant en ligne droite, tel un sanglier à travers les broussailles, arrivait souvent sur les sites litigieux avant ses confrères, condamnés aux méandres routiers. Inutile de dire qu'en dépit d'une atmosphère de franche amitié, chacun repartit en maintenant fermement ses «positions préparées à l'avance » (comme auraient pu dire les combattants de cette guerre des trois).
Nous avons vu que, dans la Montagne Noire, les trois ne furent pas toujours les mêmes. Après avoir démontré que la plus grande partie des terrains avaient eu la curieuse idée de se disposer à l'envers, je m'étais évertué à trouver quand même un résidu autochtone dans le Sud-Ouest (Monts du Minervois) et dans le Nord-Est (Monts de Saint-Gervais). Maurice Mattauer et ses complices pour le premier cas, ainsi d'ailleurs que François Boyer, brillant poulain de Pierre Routhier (Président de la Société géologique en 1964), Ellenberger et la cohorte de ses élèves pour le second, me prouvèrent que j'avais été trop modeste dans mes visions tangentielles ou que je n'étais pas assez tombé sur la tête (tête plongeante de nappes, bien entendu !).
Il n'y a pas de raison de poursuivre l'historique des querelles ultérieures qui mirent en jeu une foule de protagonistes, les uns fort sérieux et d'ailleurs sympathiques, les autres dont il est charitable d'oublier les noms. Je me bornerai à rappeler une autre guerre des trois sur un terrain tout proche, mais à laquelle je n'ai pas pris part : ce fut, dans les Corbières orientales, le heurt entre Ellenberger, Mattauer et Durand-Delga. La durée de la conflagration et sa violence furent telles que, pour limiter les risques d'incendie généralisé, la Société géologique dut user de son éteignoir officiel en refusant toute nouvelle publication sur le sujet (1963).
Sans doute désireux de contempler d'autres horizons, nos héros (les trois mousquetaires de la Grésigne, ou les trois de la Montagne Noire, ou les trois des Corbières (ce qui traditionnellement fait quatre !) papillonnèrent de plus en plus pour s'assurer que la terre était bien ronde. Et l'on vit Ellenberger, après sa thèse sur la Vanoise, charrier les Alpes Scandinaves ou suivre à la piste les dinosaures d'Afrique australe et Durand-Delga tourner, après son maître Fallot, tout autour de la Méditerranée occidentale. Quant à Gèze, il se mit à jouer au pédologue au Liban, au volcanologue aux Antilles et au Sahara — après le Cameroun — puis un peu dans tout le Pacifique, et aussi à l'hydrogéologue et au karstologue jusqu'à Cuba.
Aujourd'hui, la question se pose de savoir si, à quatre fois vingt ans dépassés, Gèze et Ellenberger ont quatre fois plus d'enthousiasme qu'à la belle époque où se dessinait leur vocation. On pourrait en effet en douter lorsqu'on constate que tous deux se penchent davantage sur le passé que sur l'avenir. Le pire est le cas de Gèze qui, se croyant tout jeune, revient à ses premières amours spéléologiques. Du moins Ellenberger s'occupe-t-il 55 de l'histoire de la géologie en général et réussit-il à nous prouver une fois encore que, s'il s'agit d'une science terre à terre, sa pratique constitue bien le plus beau métier du monde !
Quod erat demonstrandum , ou en bon français C.Q.F.D.
Post-scriptum : Les mots en italique figurent dans les pages roses du Petit Larousse illustré (réclame gratuite !). Ils ont seulement pour but de rappeler ce qui fut pendant plus d'un millénaire la vraie langue internationale, déplorablement abandonnée aujourd'hui pour un idiome insulaire de valeur contestable. Seule exception : De atrae montanae bello (Sur la guerre de la Montagne Noire) ne figure pas dans les pages roses en question. Ce titre s'inspire manifestement des Commentarii de bello gallico (Commentaires sur la guerre des Gaules), ouvrage classique de César. Il laisse supposer que le premier «Anonyme» cité acceptait qu'on le traite de Jules. Sans commentaires.
Acte premier
(La scène se passe au point de ralliement des mousquetaires de la Grésigne, une semaine après leur retour dans leurs pénates. L'absence d'une bicyclette avait joué un rôle aussi essentiel que celle des personnages clés dans l'Artésienne et En attendant Godot),
Extrait de la lettre du chef de gare de Vindrac (Tarn), adressée à M. Ellenberger à Bourges (Cher) :
«Nos recherches concernant votre vélo ont enfin donné un résultat : votre vélo est retrouvé et nous le tenons à votre disposition ».
Acte deux
Extraits de De atrae montanae bello par un « Anonyme du XXème siècle » (F.E.) :
(Dans cet acte, les unités de temps et de lieu ne sont respectées que très globalement (une décennie dans la Montagne Noire). Quant à l'unité d'action, à votre place je n'en parlerais pas!)
Prologue
Oh ! que le vent du Nord est triste à Coulouma,
[Localité célèbre par ses fossiles].
Lorsqu'il hurle le glas du fixisme/nappisme3 aux abois !
[Rayer la mention inutile (note de l'auteur, F.E.)].
O ! vous, monts désolés, mornes châtaigneraies,
Fourrés de chênes verts, gorges, autant de plaies
Qui balafrent à nu tes versants nébuleux,
Montagne Noire, erreur du drame fastidieux
Où fut enfin formé tout le bâti varisque,
Ce filandreux roman dont tu es l'astérisque !
Venez, écoutez tous, que je conte l'histoire,
La tragique saga de la Montagne Noire !
Scène 1
En ces temps bienheureux, la manie tectonique
N'infestait pas encor, exaspérant moustique,
Les calmes réunions des amants de la Terre,
Savants sans prétentions, respectueux du mystère.
Mais l'eau avait coulé au pont de Poussarou,
Après Thoral le sage vint un type un peu fou
Par l'œuvre de Bernard, ermite de l'enfer,
Le haut devint le bas, synclinaux à l'envers,
Le plus vieux sur le neuf, inversion structurale.
Le vrai admis de tous n'est plus qu'erreur fatale !
Gèze, sous la risée profane des moqueurs,
Guidait, âme d'airain, les nappes de son cœur
Dans leur essor joyeux au-dessus de la plaine
Vers le vieux môle axial, dur noyau de la chaîne.
Scène 2
Tels deux aigles planant bien au-dessus des cîmes,
Je lus les noms secrets gravés sur fond d'abîme,
Sur fond d'horreur et de chaos, de vacuité,
En lettre d'obsession : SCHISTOSITÉ ! POLARITÉ !
Le schiste m'a dit : les nappes viennent du Nord !
Mattauer m'a dit : les nappes viennent du Nord !
Je dirai plus, dit Proust, elles vont au Midi !
C'est matière de foi, elles vont au Midi !
— J'écoutais, médusé, ces propos péremptoires,
Trente fois convaincu, n'arrêtant pas de croire.
Scène 3
Ellen dit : mon Collomb il me faut dix-mille axes
De linéation, cette passion me désaxe !
Ainsi parla le grand Ellen (grand par la taille)
Echevelé bavard aux discours pleins de failles
(Il en a trop cafté, là-bas, à Saint-Chinian)
Epilogue
Je vois déjà le Jaur rouler leurs ossements
Tous mêlés, du duel absurde inhumain restant
Frère Aubouin chantera tout bas leur oraison,
Plantant sur leur tombeau du bicouple à foison.
L'impassible montagne étendra le silence
Sur leurs piètres écrits, oubliés de la France !
Quel héros gravira donc l'invaincue falaise
De tes secrets, ô Mélanorogenèse ?
Acte trois
Réponse à l'Ane-Onime
Extraits d'un texte anonyme longtemps attribué par erreur à Maurice Mattauer
Jules, hobereau de Lagrasse
Jaloux des Montpelliérains,
Fignolait d'abstruses crasses
Pour embêter ses voisins.
— Adoncques, perché sur la butte,
Il croit entendre au Sud-Est
De lointains échos de luttes
Propos moqueurs, pleins de zest.
A ce bruit l'Ellen exulte :
« Là-bas autour de Durban,
«Tous mes confrères incultes
« S'entre-égorgent vaillamment ».
Se voyant roi des Corbières
Ellen se mit en chemin
Pour les mettre tous en bière.
Mais il resta sur sa faim !
Les prétendus adversaires
Réconciliés sur son dos,
Sous les vieux pins tutélaires
Trinquaient, buvaient sec (sans eau),
Scandant : «Ellen est un cuistre !
«Du Midi nous l'expulsons ! »
D.-D., Proust et Mattauère
(sans oublier P. Viallard)
S'étaient unis dans la guerre
Aux parisiens ramenards.
François ELLENBERGER
Trop de gens ne voient dans l'Histoire des Sciences — et de la Géologie en l'occurrence — qu'une sorte de divertissement érudit et marginal, où l'on trouve quelque plaisir à se gausser des erreurs et sottises crédules de nos devanciers. La Science actuelle, avec ses multiples triomphes, n'a-t-elle pas mieux à faire, dans sa marche assurée, que de perdre son temps à fouiller dans ces décombres d'une science périmée?
Mais attention ! N'est-ce pas aller un peu vite en besogne ? Notre génération aurait-elle donc reçu le privilège unique de ne jamais commettre aucune erreur dans ses démarches ? Or, c'est précisément ce que croyaient aussi les précédentes. D'une époque à l'autre, le contexte évolue, les savoirs s'enrichissent, mais les conduites humaines, elles, changent peu en profondeur. Il est donc licite d'appliquer à la marche elle-même de notre science le principe d'actualisme, dont l'éloge n'est plus à faire.
A tort, sa paternité est attribuée à Charles Lyell (l'idée est très antérieure ; peu importe ici). Du moins, c'était un homme de grand talent, et un fort habile tacticien dans la promotion de sa doctrine. Ce n'est donc pas sans raisons qu'en tête de son célèbre ouvrage, les Principles of Geology (1830-1833), il commence par résumer les opinions de ses devanciers, proches et lointains, afin de mettre en lumière les causes qui, selon lui, ont retardé les progrès de la Géologie. Alors qu'il se pose en novateur et grand réformateur, c'est d'abord vers l'histoire qu'il se tourne, pour mieux faire la leçon à ses contemporains, comme pour leur signifier : « Voilà les fautes à ne plus commettre ! ».
Ch. Lyell, Principles of Geology. Being an attempt to explain the former changes of the earth's surface, by reference to causes now on operation, London, 3 vol., 1830-1833 - réimpression fac-similé University of Chicago Press, 1990.
A mon tour de me faire moraliste. Recherchons ensemble les principales fautes de méthode commises de bonne foi par nos prédécesseurs. Et l'historien lui-même doit être modeste dans sa croisade moralisante, car d'autres pièges le guettent dans sa propre activité, comme le regretté Reijer Hooykaas nous l'exposa brillamment en 1980 .
Insuffisamment dénoncé, le flou dans le vocabulaire est source d'insidieux malentendus, y compris pour les historiens. Ainsi le terme célèbre de «révolution de la surface du globe ».
Autre mal déjà nettement plus sérieux : les conflits entre terrain et laboratoire, et la primauté accordée à ce dernier; mal récemment hypertrophié, mais non sans manifestations précoces. La querelle sur le basalte à l'époque de Gottlob Werner en est un exemple connu.
Un autre cas intéressant, moins connu, de l'utilisation fallacieuse du quantitatif remonte à Woodward, à la fin du dix-septième siècle. Sa grandiose théorie, on le sait, admet la formation quasi-simultanée de toutes les couches terrestres par la décantation, par ordre de gravité, des eaux du Déluge. Les coquilles fossiles préexistaient à la mise en suspension générale des matières au début du grand événement et ont survécu à cette « dissolution ». De bonne foi, il croit avoir démontré ces vues par la mise en œuvre de mesures minutieuses de densité : elles attestent que, dans la pile des strates superposées, le poids spécifique des fossiles décroît de bas en haut parallèlement à celui des roches encaissantes (An Essay toward a Natural History of the Earth..., 1695 (réimpr. fac-similé Arno Press, New York, 1978), p. 30 ; cf. le tome II de mon Histoire de la Géologie, p. 122-123).
Bien entendu, d'autres interventions précoces du quantitatif ont été bénéfiques : ainsi les essais d'estimation de l'âge de la Terre par Halley, Henri Gautier et Buffon (usant de méthodes fort différentes).
Or, un autre facteur entre ici en jeu : c'est l'actualisme abusif— affaire très sérieuse. Cela revient à projeter inconditionnellement tout l'état de choses actuel sur tout le passé. Déjà Lyell succomba à ce vertige, se condamnant à évacuer l'orogenèse de son système. Comme Hooykaas l'a montré, le principe d'uniformité n'est qu'un postulat, indémontrable en soi.
Tournons-nous vers des maladies encore plus graves, endémiques, récurrentes, universelles. La Géologie, je le répète, est une science d'archives, elle présuppose un vaste inventaire des faits déjà décrits, dans leur immense majorité, par d'autres que soi. Or, l'historien découvre chez un grand nombre d'auteurs de tous les temps une consternante ignorance de la bibliographie ; j'y vois une cause majeure de retards et de stagnation. Les exemples sont innombrables.
En contrepartie, d'autres auteurs ont été très scrupuleux en matière de bibliographie : tels Etienne Guettard et Nicolas Desmarest. (Oserais-je dire que lors de mes tout-débuts dans la recherche, en 1936-1937, j'ai été formé à l'idée qu'en abordant un sujet, il fallait lire absolument tout ce qui avait déjà été publié ?).
Ici, nous sommes tous fautifs ! Déchargeons-nous de notre culpabilité sur les autres. A notre joie mauvaise, nous surprenons en flagrant délit Charles Lyell, le donneur de leçons : son fameux inventaire historique est inexact et incomplet. En France, nous voyons Cuvier et Constant Prévost, dans les années 1820, engagés dans une bataille stérile sur la question du retour de la mer sur les continents : comment peuvent-ils ignorer qu'un mémoire de Lavoisier avait paru en 1792, posant admirablement les bases des idées modernes sur les transgressions et régressions? En ce temps béni de rapides et enthousiastes développements de notre science, les auteurs tournaient le dos au passé, pour eux définitivement périmé et dépassé. Du moins, alors, on se lisait beaucoup les uns les autres à travers toute l'Europe : circonstance atténuante que je n'accorderai certes pas à notre génération. Et la chose est très grave, car le savoir acquis se perd, la connaissance n'est plus cumulative, l'ignorance triomphe.
Corollaire ou non de cette impardonnable paresse à lire, on découvre dans l'histoire de notre science de singuliers cas de retard dans l'exploitation de novations techniques majeures. Dans les années 1815-1830, des pionniers mettent au point la taille des lames minces de roches, ainsi que le microscope polarisant. Pourquoi a-t-on attendu 1850 pour que Sorby redécouvre cette irremplaçable méthode d'étude?
Mais poursuivons notre chasse endiablée. Voici maintenant un très gros gibier, une affaire qui pose des problèmes de fond, touchant à la nature même de notre discipline : c'est celle de la démarche deductive ou inductive, descendante ou ascendante de notre stratégie scientifique. Le noble effort de l'homme pour comprendre le monde engendre volontiers une grande ambition : celle de découvrir le principe de base d'où tout le reste découlera logiquement, nécessairement. Sur cette pierre angulaire, nous édifierons un système cohérent, bien articulé, une grandiose théorie globale, ayant réponse à tout. Le succès en a été souvent remarquable dans la science moderne (Newton !).
Mais une longue fréquentation des textes démontre abondamment que ces genres de théories déductives (fort souvent également «unicausales») ont été un échec dans notre discipline. Ainsi en fut-il du grand et beau système neptunien de l'école de Werner, d'une logique impeccable, où toute la formation des couches de la Terre se ramenait à la simple précipitation au sein d'un océan primordial. — De même pour les visions mathématico-tectoniques d'Elie de Beaumont, avec son fameux « réseau pentagonal ». — Et l'exemple prototype de cette démarche fallacieuse fut donné dès 1644 par Descartes, reconstruisant dans son imagination tout le scénario de la formation du globe terrestre : génial, certes; hélas ! faux d'un bout à l'autre !
Une telle façon de raisonner «de haut en bas», accompagne volontiers le succès d'une théorie globale, d'abord issue des faits et féconde, puis ossifiée en système totalitaire, ayant d'avance réponse à tout. L'homme de science se fait théologien intégriste, vivant sous la loi du Credo, au point d'exiger que les humbles données de la nature s'y conforment, sous peine d'être systématiquement ignorées.
Et j'avoue ici en passant ma consternation devant des ouvrages didactiques scolaires, ou devant des guides destinés à l'initiation du public. Par exemple, toute la vision de paysages géologiques alpins y est d'emblée et d'avance replacée dans le cadre dogmatique de la Théorie sacrée des plaques, assénée en guise d'introduction (« Collision Afrique-Europe», etc.). En pleine magnificence de la libre Nature alpine, le catéchisme est premier, le réel subordonné au virtuel.
Ce genre-là de pédagogie serve me révulse ; c'est la négation de tout ce que je me suis efforcé de faire durant ma vie : former des observateurs perspicaces et des esprits libres. Il eût fallu faire exactement l'inverse et dire :
-
«Nous voici devant des structures réelles, que nos yeux vont apprendre avec moi à découvrir, à déchiffrer, à lire au flanc de la montagne ; là est la seule réalité, toujours incomplètement connue, toujours neuve, source vivifiante unique. Voyons ensuite si cela confirme ou non les théories du moment ! Car les théories sont faites pour être impitoyablement et sans cesse mises à l'épreuve ; c'est ce qu'elles n'expliquent pas ou mal qui est le plus intéressant, puisque là sont les progrès futurs, petits et grands ».
A ce mauvais cartésianisme « impérialiste » s'oppose la démarche inductive de Francis Bacon. Elle n'a cessé d'être prônée et mise en œuvre par les pionniers de la Géologie. Entre autres, Nicolas Desmarest en 1757, dans l'Encyclopédie, en a fait un exposé magistral, qui garde toute sa valeur.
Voir aussi, entre autres, ce qu'écrit brièvement Playfair, dans ses Illustrations of the Huttonian Theory of the Earth, 1802 (rééd. Dover, New York, 1956), p. 525-528.
Opérer autrement, c'est en fin de compte méconnaître la nature même de la Géologie : oublie-t-on son objet premier, sa spécificité irremplaçable dans tout le vaste cortège des activités de l'esprit humain ? La Géologie est la science qui, au-delà de la recherche des mécanismes dynamiques, au-delà des applications pratiques, des technologies élaborées mises en œuvre, a pour but final, essentiel, de nous faire connaître l'histoire de la surface de la terre, en ressuscitant à nos yeux les visages successifs de ses paysages minéraux et biologiques. Cette contemplation, récompense suprême, sera celle d'une multiplicité infinie, et pourtant une, et harmonieuse. Pour nous aussi, à qui est offert l'abîme du Temps, c'est «l'heure de s'émerveiller» (pour reprendre les mots de l'astrophysicien Hubert Reeves). Combien je plains ceux qui ne l'ont jamais connue ! Aucun modèle réducteur ne peut s'y substituer, aucun système abstrait, si ingénieusement construit soit-il.
A l'amont de tout ce qui précède, sur un plan encore plus général, je discerne ce piège trop méconnu : le consensus. Du moins les consensus aveugles. Je me méfie toujours de l'adhésion spontanée, massive, inconditionnelle des communautés humaines à telles ou telles certitudes évidentes, reçues de tous une fois pour toutes, paradigme pris pour socle nécessaire et assuré de tout le reste : «vérité» de départ jamais vérifiée, jamais mise en doute. (Bien entendu, je ne parle pas ici des consensus sur des acquis mûrement éprouvés au creuset du débat scientifique contradictoire, verdict final d'un procès impartial et sans pitié (nous sommes tous d'accord, je pense, que la Terre est ronde, et qu'elle se meut).
Méfiez-vous des consensus ! Au dix-septième siècle, tout le monde s'accordait sur le rôle du Déluge, maximalisé bien au-delà de la lettre biblique, et une large majorité croyait encore à la génération spontanée des fossiles dans le sol. — Jusque vers les années 1770, tout le monde ou presque croyait à la brièveté des temps géologiques et à la fixité du monde vivant. — Au dix-neuvième siècle, qui donc aurait pu mettre en doute le dogme du refroidissement et de la contraction corrélative du globe? — Vérité, de l'avis de tous, scientifiquement démontrée; Lord Kelvin (ce n'était pas le premier venu) en fut un défenseur sûr de soi et acharné. — Et aujourd'hui ?
Le consensus, qu'il soit général et de longue survie, ou mode passagère, tyrannique comme toutes les modes, est un cocon sécurisant, où aime à se blottir notre frilosité, notre peur de la liberté : la nôtre et, par ricochet, celle d'autrui.
-
« Non ! les braves gens n'aiment pas que
L'on suive une autre route qu'eux »,
Plaisante si l'on veut dans le domaine vestimentaire, la mode sévit trop souvent dans les sciences, y exerçant de sérieux dommages. Elle éteint l'esprit critique, elle se justifie par elle-même, elle refuse tout argument qui la mettrait en question.
En ce qui me concerne, j'ai jadis dû lutter pied à pied contre mes collègues français (ainsi que hollandais), inféodés jusqu'aux moelles à la mode de la mise en place générale des nappes de charriage par décollement et écoulement par gravité. La mode rend sourd et aveugle à tout ce qui n'est pas elle. Dès avant 1900, le fait des charriages cisaillants en pente ascendante avait été définitivement établi en Ecosse par les études rigoureuses de Peach et Horne : « Connais pas ! ». Les riches relevés en mine, non moins irréfutables, accumulés dans les archives du bassin houiller franco-belge : « Connais pas ! ».
Que dire aussi des modes successives en matière de pétrogenèse granitique ! Etc., ad libitum, ad aeternum.
Associée ou non au consensus béat, voici maintenant une maladie pernicieuse, universelle, de la raison, incrustée au profond de tout humain : c'est de désigner d'emblée la cause de n'importe quoi, de n'importe quel phénomène; c'est inné, c'est spontané, chez le plus frustre des Primitifs, tout comme chez l'homme de raison et de science. Cette tendance irrésistible peut nous faire sourire, lorsque sa grosse naïveté est plaisante à nos yeux instruits. Mais les ravages de ce vice invétéré de l'esprit peuvent être terribles : combien de centaines de milliers d'innocents ont péri, dans la brousse africaine, tout comme dans nos pays «civilisés», pour le malheur d'avoir été désignés comme «cause» de tel ou tel fléau, ou d'un simple drame personnel !
Aussi, je répétais à mes étudiants : «Dites-vous bien que tout le monde a toujours tout su sur tout ! Mais la Science a commencé avec celui qui le premier a dit, en pleine responsabilité : Je ne sais pas ! ».
Par contraste, la recherche rationnelle obstinée des vraies causes est l'un des plus nobles buts que l'humanité puisse se fixer, comme Virgile le disait voici vingt siècles (Géorgiques, II, 489) : « Felix quipotuit rerum cognoscere causas ! », vers que l'on peut traduire : «Bienheureux l'homme qui a pu parvenir à la connaissance des raisons profondes des choses» (en l'occurrence, les éclipses, tremblements de terre, marées et autres énigmes du monde physique); cet heureux mortel se rira de la peur du Destin et de l'Achéron (Virgile parle en disciple de la foi épicurienne).
J'aime à souligner ce pluriel de causas, «les causes ». L'ignorant naïf comme l'ignorant «savant» n'ont, le plus souvent qu'une seule cause à l'esprit; envisager plusieurs hypothèses, ce serait renoncer à la certitude, ce serait s'engager dans le champ périlleux du doute critique.
Une seule cause, bien carrée, bien affirmée, voilà ce qu'il faut à la plupart.
Plus de deux mille ans plus tard, la cause de l'extinction des infortunés Dinosaures, n'est-ce pas? c'est le Bolide (ou bien c'est le volcanisme du Deccan, selon votre religion propre, que je respecte infiniment). Inclinons-nous : Aristote a dit !
«Poumon»: «Génération (spontanée)!... Submersion (diluvienne)!... Révolutions (du globe)!... Contraction!... Sélection!... Subduction, Subduction, vous dis-je!... Autopersuasion..., Ronron».
Le doux poète Virgile n'était pas seul en son temps à admettre une pluralité de causes à découvrir : marque distinctive claire de l'esprit scientifique véritable. L'Antiquité classique ne séparait pas Sagesse et Science. J'aime relire les Questions naturelles de Sénèque. Avec une grande probité intellectuelle, il n'hésite pas à exposer simultanément plusieurs hypothèses concurrentes, à confronter et mettre à l'épreuve (ainsi sur les séismes)
Eugène Wegmann a très bien analysé la fécondité des explications «bicausales» (voire pluricausales) par rapport aux théories unicausales, en prenant pour exemple le problème du retrait apparent de la mer en Scandinavie. Lire son article : Evolution des idées sur le déplacement des rivages. Origine en Fennoscandie, Mémoires de la Société vaudoise des Sciences naturelles, vol. 14, 1967 (notamment p. 132, 177, 179-180).
Mais tout allait être balayé par la lame de fond des nouvelles superstitions. Quoi de plus fragile que l'esprit scientifique? Il est sans cesse menacé, même de l'intérieur. Strabon, Lucrèce, Sénèque savaient hésiter lucidement, savaient avouer leur ignorance : mais c'est la compilation fourre-tout de Pline qui fut le séculaire «best-seller», qui eut un succès durable, léguant au Moyen-Age son ramassis de certitudes péremptoires, fallacieuses.
Notre science moderne, dans ses vertigineux développements, est-elle guérie de cette hantise de désigner la Cause à tout prix? Hélas non ! Je me contenterai d'un exemple un peu ancien. Vous avez bien évidemment tous lu dans mon second bouquin ce que je dis sur l'Axe de la Terre et tous les effets physiques variés qu'on a voulu attribuer à son basculement allégué (à commencer par les changements passés du climat) : intelligentes démarches logiques, qui auraient été à coup sûr fécondes, si seulement le postulat du basculement avait été fondé. Les astronomes tranchèrent par la négative, reléguant au grenier toutes les ingénieuses hypothèses annexes sur la cause du basculement lui-même.
A la source de nombre de ces errements séculaires, on trouve souvent une confusion entre concomitance et relation causale. Mettons que nous sommes en avril ; le ciel nocturne se dégage, la pleine lune trône là-haut, ironique; au matin, le jardinier enrage : ses jeunes légumes sont gelés, roussis : c'est évidemment la Lune ! De même en Science : je vous laisse le choix des exemples, anciens ou récents.
Songeons par exemple au problème de la limite Crétacé - Tertiaire dans sa vraie, énorme complexité : comment trouver la nature de l'accolade qui embrasse tout cela à la fois ? Va, si on y tient, pour le bolide tueur ! Mais, étant hélas ! de nature incorrigiblement sceptique, je ne puis arriver à croire, par exemple, que cet intrus cosmique soit aussi la cause des régressions marines complexes marquant justement cette période.
Dans les années 1790, De Luc avait été très frappé par la brutale modification simultanée des faunes fossiles et de la lithologie lorsqu'on passe de la craie aux sables et argiles tertiaires sus-jacents. Il l'expliquait par on ne sait trop quelles émanations venues de l'intérieur du globe. (A adjoindre, SVP, à la riche collection des hypothèses déjà émises sur l'horrible drame frappant le zoo dinosaurien).
Laissons de côté cette pauvre Lune et revenons sur terre. Tout n'y est pas gai. J'ai commencé cet exposé en me drapant dans la bannière de l'actualisme historiographique : or parfois celui-ci est en échec. Notre génération diffère de toutes les précédentes par un fait sociologique sans équivalent passé. Elle connaît un accroissement démesuré à la fois de ses effectifs et de ses technologies. Il en est résulté un émiettement et une spécialisation outrancière, par nature préjudiciables aux visions d'ensemble. Notre Géologie tant aimée, science de synthèse, y survivra-t-elle ? Le coût excessif des moyens matériels mis en œuvre provoque une âpre compétition à court terme pour l'obtention des crédits, et un strict encadrement de la recherche. Les chercheurs-nés y étouffent, les âmes fières ont envie de s'écrier, avec Constant Prévost présentant la toute jeune Société géologique de France au roi Louis-Philippe : « Sire, pour être prospères, les sciences ont besoin de liberté ! ».
Face à cette aberration, je ferai miens ces mots récents de Pierre Laszlo (un chimiste) qui dénonce :
-
«.. L'inanité de toute gestion de la recherche par secteurs en lopins hyperspécialisés. Il importe au contraire (continue-t-il) d'encourager le nomadisme scientifique, qui assure les grandes percées. La logique de la découverte n'est pas dans l'immobilisme d'un découpage territorial ; la recherche vit dans le dynamisme d'un constant réaménagement des frontières, d'ailleurs arbitraires, entre les sous-disciplines ». (Pour la Science, n° 220, février 1996, p. 10).
D'illustres devanciers furent éminemment pluridisciplinaires : tels Louis Agassiz, pionnier majeur à la fois dans l'étude des Poissons fossiles et dans la mise en évidence de «l'Age glaciaire». Et que dire de Darwin? Tout près de nous, comment ne pas évoquer un Jean Goguel, un Bernard Gèze?
Oui, travaillons d'arrache-pied à nos tâches du moment, mais soyons incorrigiblement curieux de voir au-delà, avides de goûter un peu à d'autres coupes, possédés de la passion de connaître ! Soyons de plus persuadés que d'aller rendre visite à nos devanciers, par la grâce des lectures, nous donnera des bonheurs inattendus. Conscients de la valeur éphémère de nos propres écrits, cette communion à travers les âges sera consolatrice : la véritable beauté, impérissable, des nobles architectures est que, dans leur savante maçonnerie, œuvre d'amour élevée pierre à pierre, c'est l'âme même des hommes qui nous parle, au-delà des mots, au-delà de tout langage. Soyons comme eux des conquérants hardis de terres nouvelles, pour rien, pour répondre à un appel venu des profondeurs.
Peu d'hommes, sans doute, de tous temps, acceptent de contempler face à face la béance de l'Inconnu, avec sérénité et même exaltation muette, caressés par le souffle ténu d'une promesse, d'une attente. Pour ceux-là, trouver, vraiment, enfin, don rare accordé au terme d'un long cheminement, sera une illumination, une joie incomparable («imméritée», écrivait Pierre Termier). En ce sens-là, la science la plus haute devient sœur de la mystique la plus haute, celle qui transcende toutes les religions et croyances formulées.
Certaines de ses vues me sont allées droit au cœur. Ainsi, quand il évoque l'intime relation traditionnelle entre l'Homme et la Terre, affirmée par beaucoup de civilisations indigènes (Navajo, Crée, mythes grecs archaïques, etc.) : elle implique l'existence d'un appel profond universel chez les humains pour une connexion rétablie avec la Terre. L'auteur a lui-même pu constater la réalité de cette «faim de géologie» en conduisant sur le terrain -pour lui véritable second métier largement bénévole - des groupes de profanes avides. Mais la science, à force de se spécialiser de façon réductrice et hiérarchisée, s'est totalement fragmentée en îlots de conformisme, séparés par des océans interdisciplinaires d'ignorance.
Eldridge Moore se penche sur la démarche profonde de la Géologie. Bien sûr, elle est basée sur des processus rationnels, déduction et induction ; mais ces derniers sont eux-mêmes sous la dépendance d'une créativité, d'une intuition d'essence non logique ni rationnelle. En cela la vision du scientifique rejoint celle de l'artiste. Elle pourrait même être assimilée (avec Mather) à une révélation religieuse.
Hugh TORRENS
Je dois à mon grand regret donner le «coup de grâce» à ces festivités! C'est bien difficile de le faire pour un Anglais — un perfide d'Albion ! — à cause des problèmes linguistiques. Nous, Anglais, avons comme vous des difficultés avec le franglais, mais nous devons en outre combattre les faux amis. Or, même l'histoire de la géologie est confrontée aux faux amis, comme l'a démontré notre ami François Ellenberger à propos de la querelle de vocabulaire entre actualisme et uniformitarianism, entre ancien (français) et ancient (anglais) et entre les significations différentes données au mot horizon dans nos deux langues.
Nous sommes cernés par l'histoire. Hier, pour arriver ici, ma femme et moi avons pris l'Eurostar (encore du franglais !) qui emprunte le tunnel transmanche. L'histoire de cette entreprise est édifiante : le premier Anglais qui a fait l'étude de la géologie sous-marine de la Manche était Edward Cecil Hartsinck Day ( 1833-1895). Né en Angleterre, il est mort il y a exactement un siècle en Algérie, après avoir passé une trentaine d'années aux Etats-Unis comme géologue, docimasiste et enseignant. Day illustre ainsi parfaitement la dimension internationale de l'histoire de la géologie.
Au cours de l'histoire se sont produites des querelles innombrables entre Français et Anglais à propos de la paternité de découvertes et inventions. Un texte édifiant extrait du Journal de Pharmacie de juin 1816 vient en apporter la preuve :
-
«Les Anglais joignent au talent de s'approprier les découvertes d'autrui la hardiesse de s'en prétendre les inventeurs et l'adresse de le faire croire à ceux mêmes qu'ils ont dépouillés. C'est ainsi qu'ils ont enlevé à Pascal la presse hydraulique, à Dalenne la pompe à feu, à Lebon son thermolampe, à Montalembert ses affûts de marine, à Guyton de Morveau ses moyens de désinfection. On pourrait citer plus de deux cents plagiats pareils dans les sciences et dans les arts. Ils ont poussé l'assurance jusqu'à faire jouer sur leur théâtre deux pièces de Molière, qu'ils ont données non comme traductions, mais comme ouvrages originaux ».
« La découverte à laquelle ils paraissent tenir le plus dans ce siècle est celle de la vaccine, et cette découverte est trop honorable pour ne pas la restituer à son auteur».
En 1779, le grand-père du fondateur de la Société géologique de Londres prit son quatrième brevet pour la «Samaritan Water», un médicament totalement charlatanesque. Les énormes bénéfices dégagés par cette activité «pharmaceutique » fournirent ensuite les subsides dont vécut George Greenough qui fut en 1807 le premier président de notre Geological Society.
Bien que n'ayant pas la possibilité de brandir un verre de «Samaritan Water» (devenue introuvable aujourd'hui!), je porte maintenant un «toast» (toujours du franglais!) à François Ellenberger avec tous nos remerciements pour sa gentillesse, son amitié et surtout son exemple. Nous sommes ici nombreux à nous sentir un peu ses élèves car il mérite d'être respecté comme un maître.

Illustration de couverture : Philippe RABAGNAC