COMITÉ FRANÇAIS D'HISTOIRE DE LA GÉOLOGIE (COFRHIGEO) (séance du 12 décembre 2007)
|
Résumé.
La « nouvelle tectonique », remplaçant celle des « soulèvements », est inaugurée par le génie inventif de Marcel Bertrand, découvrant les « nappes de recouvrement » dans la chaîne alpine (chap. 1). Élevé dans un milieu familial riche en personnalités intellectuelles, il est admis à Polytechnique (chap. 2) et se retrouve ingénieur des mines à Vesoul (chap. 3). Converti à la géologie, il va s'initier à la cartographie du Jura (chap. 4), tout en assurant ses responsabilités à Paris (Carte géologique, École des mines, Société géologique, plus tard Académie des sciences) (chap. 5). Résolvant brillamment le problème de Glaris, dans les Alpes suisses (chap. 6), il cartographie la zone de contact Schistes lustrés-Briançonnais dans les Alpes occidentales (chap. 7) et marque son passage en Andalousie puis en Algérie (chap. 8). Son oeuvre préférée concerne la Provence occidentale (chap. 9), où il découvre les charriages du Beausset, de la Sainte-Baume, d'Allauch et de l'Étoile, finalement réunis dans sa « grande nappe de recouvrement de Basse-Provence », dont l'essentiel reste admis, un siècle après. S'inspirant de son ami Edouard Suess, Marcel Bertrand aborde, de 1890 à 1900, avec une fortune variable, les grands problèmes de la géologie (chap. 10), établissant en particulier la succession cyclique des phénomènes tectoniques, magmatiques et sédimentaires dans les grandes chaînes. Avant d'évoquer la nuit intellectuelle qui précède son décès en 1907 (chap. 11), on essaye de percer la riche personnalité d'un homme exceptionnel, aimé de ses contemporains et de ses émules.
Mots-clés : Tectonique - nappes de charriage - cartographie géologique - Jura - Alpes - nappe de Glaris - Provence - dynamique terrestre - cycle orogénique.
Abstract.
The "new tectonics" which replaced the tectonics of "uplifts" began by way of the inventive genius of Marcel Bertrand, in his discovery of "nappes" in the Alps (chap. 1). With an exceptional family background and outstanding intellectual qualities (chap. 2), the young mining engineer was posted at Vesoul (chap. 3). Converted there to geology, he established himself through mapping work in the Jura (chap. 4), leading to the positions he held in Paris (Geological Survey, School of Mines, Geological Society, and finally the Academy of Sciences) (chap. 5). Following his brilliant resolution of the Glaris problem in the Swiss Alps (chap. 6), he mapped the contact zones of the Briançon schistes lustrés of the western Alps and traced his passage into Andalusia and then Algeria (chap. 8). His favourite work concerned western Provence (chap. 9), where he discovered the major overthrusts ("charriages" and "klippen") of Le Beausset, Sainte-Baume, Allauch, and l'Étoile, all synthesized in his "great overthrust of lower Provence", which remains largely accepted a century later. Inspired by his friend Eduard Suess, between 1890 and 1900, Marcel Bertrand addressed the great geological problems of his time with varying success (chap. 10). Among his main achievements was the establishment of the basic stages in the cycle of tectonic, magmatic and sedimentary phenomena of the great mountain chains. In advance of noting the intellectual darkness of the period preceding his death in 1907 (chap. 11), an effort is made to gain perspective on the rich personality of this exceptional man, beloved by his colleagues.
Key words: Tectonics - "nappes" - geological mapping - Jura - Alpes - Glaris "nappe" - Provence - earth dynamics - orogenic cycle.
|
-
I. Introduction
(L'aura de Marcel Bertrand)
II. La jeunesse de Marcel Bertrand
III. Marcel Bertrand, ingénieur des mines à Vesoul
IV. Travaux de jeunesse de Marcel Bertrand dans le Jura
-
A. La structure du Jura
B. L'incursion de Marcel Bertrand dans la stratigraphie du Jurassique
V. Marcel Bertrand à Paris (1878-1900)
-
A. Géologue au Service de la Carte géologique
B. Professeur à l'École des mines
C. À l'Académie des sciences
D. À la Société géologique
E. Aux Réunions extraordinaires de la Société géologique
F. La vie personnelle de Marcel Bertrand à Paris avant 1900
-
A. Les prémices du problème de Glaris
B. La genèse de l'hypothèse de Marcel Bertrand
C. Les hésitations de 1888 à 1900
D. La lente conversion d'Albert Heim
E. Marcel Bertrand dans l'Oberland bernois avec Henri Golliez
F. Les « phénomènes de recouvrement » de la Suisse : commentaires (Le problème des Préalpes romandes)
-
A. Les premiers travaux
B. Les conditions de travail dans les Alpes
C. Résultats et interprétations de Marcel Bertrand
-
A. La « Mission d'Andalousie »
B. Marcel Bertrand en Algérie
IX. Marcel Bertrand en Provence
X. La pensée de Marcel Bertrand sur les grands problèmes de la géologie
XI. Marcel Bertrand, l'homme et le calvaire de la fin de sa vie
- 1847 (2 juillet) : Naissance à Paris 1867 : Admission à l'École polytechnique 1869-1872 : Élève ingénieur des mines 1870 : Lieutenant d'artillerie, siège de Paris 1873 : Ingénieur ordinaire au Corps des mines
- 1873-1877 : Affectation au sous-arrondissement minéralogique de Vesoul
- 1878-1885 : Attaché au Service de la carte géologique détaillée de la France, Paris
- 1879-1889 : Société géologique de France : vice-secrétaire (1879-1880), secrétaire (18811882), vice-président (1883, 1886, 1889), président (1890)
- 1878-1886 : Travaux dans le Jura
- 1881-1900 : Travaux en Provence
- 1884 : Conférences sur les Alpes de Glaris, et sur la Sainte-Baume
- 1885-1907 : Professeur de géologie à l'École des mines de Paris (1885, il supplée Béguyer de Chancourtois ; 1902-1907, Cayeux le supplée)
- 1885 (février-mars) : « Mission d'Andalousie » ; Réunion extraordinaire de la Société géologique de France dans le Jura (M. B., président)
- 1886 : Mariage avec Mathilde Mascart
- 1887 : Conférences sur « La chaîne des Alpes » et sur le Beausset
- 1888 : Ingénieur en chef des mines
- 1889 : Premier lauréat du Prix Fontannes (SGF) ; début des travaux dans les Alpes
- 1890 : Président de la Société géologique de France ; prix Vaillant (Académie des sciences)
- 1891 : Réunion extraordinaire de la Société géologique de France en Provence, dirigée par M. B.
- 1892 : Voyage en Écosse (chevauchement du Moine)
- 1893 : Prix Petit d'Ormoy (Académie des sciences)
- 1894 : Congrès géologique international de Zurich, conférence invitée
- 1896 : Élection à l'Académie des sciences ; Algérie, Réunion extraordinaire de la Société géologique de France
- 1897 : Alpes bernoises, avec H. Golliez ; Congrès géologique international de Saint-Pétersbourg (M.B., vice-président)
- 1900 : Décès de Joseph Bertrand, son père, et accident mortel de sa fille aînée, Jeanne
- 1902-1907 : Période de troubles mentaux et abandon de la géologie
- 1907 (13 février) : Décès de Marcel Bertrand, à Paris
- 1908 : Impression posthume du Mémoire sur les refoulements... (écrit et présenté à l'Académie des sciences en 1890)
- 1927-1931 : Édition, par Emmanuel de Margerie, des Oeuvres géologiques (3 tomes) de Marcel Bertrand, à la suite du voeu du Congrès géologique international de Bruxelles (1922)
Marcel Bertrand a été l'un des plus grands tectoniciens des chaînes de montagne. Il est de ces rares savants qui, ayant joui de leur vivant d'une immense notoriété, ont eu le privilège de voir, un siècle après, leur message scientifique essentiel rester valable. Il est l'un des très rares géologues auxquels, dans des pays variés et durablement, le qualificatif de « génial » a été appliqué. Si, avant lui, quelques phénomènes de chevauchement avaient été observés, cela ne dépassait pas le cadre local, sans réel essai d'explication générale. Marcel Bertrand fut donc celui qui, à partir de cas signalés dans les Alpes suisses et dans l'Ardenne, affirma que l'explication principale des structures dans les chaînes de montagnes était à rechercher dans les « grands refoulements horizontaux », origine des « nappes de recouvrement », cela s'étant produit à l'échelle mondiale et dans tous les cycles orogéniques, du Calédonien à l'Alpin. Nous verrons aussi que, dans d'autres domaines de la géologie, Marcel Bertrand, à l'instar de son ami et mentor Eduard Suess, fit preuve d'une perspicacité aussi considérable que sur le plan proprement tectonique.
La « nouvelle tectonique », - terme employé par Emile Haug -, qui apparaît avec Bertrand et que Suess propagea mondialement par son Das Antlitz der Erde, correspond à une véritable révolution conceptuelle dans la compréhension des chaînes de montagne. Leur connaissance peut se décomposer en trois stades essentiels.
Après les balbutiements des origines (Palassou dans les Pyrénées, Horace Benedict de Saussure dans les Alpes), la première tentative est celle des « systèmes de soulèvements », se succédant dans le temps suivant des règles géométriques strictes. Ces idées de Léonce Élie de Beaumont généralisent et amplifient les leçons de son maître prussien Leopold von Buch. Mettons de côté la funeste théorie qu'Élie de Beaumont en tira, avec son « dodécaèdre pentagonal ». L'influence de cette tectonique essentiellement verticaliste, et de bas en haut, perdura même quand la plupart des propositions du grand maître se furent effondrées : Charles Lory dans les Alpes, Henri Magnan dans les Pyrénées, considérèrent que ces chaînes - modèles à leur époque -montraient la juxtaposition de grandes bandes longitudinales, séparées par de grandes fractures sub-verticales, dont le jeu renouvelé expliquait les différences entre les sédiments encadrants.
Le système d'Élie de Beaumont étant ruiné (la succession dans le temps des mouvements orogéniques demeurant cependant un considérable acquis), ce fut à Eduard Suess d'affirmer que - outre les « affaissements » dont résultait à ses yeux la naissance des océans - les poussées tangentielles avaient joué un rôle essentiel. À partir de cette proposition théorique, exposée dans Die Enstehung der Alpen (1875), Marcel Bertrand trouva une explication des successions anormales, déjà indiquées par Jules Gosselet dans le bassin houiller franco-belge et par Albert Heim dans les Alpes de Glaris : tout particulièrement le grand géologue zurichois avait souligné en 1878, dans son Mechanismus der Gebirgsbildung, les conditions de plasticité des roches soumises au plissement. On doit regretter que Bertrand, insatisfait, ait soustrait à l'impression, que l'Académie des sciences avait décidée, son Mémoire sur les refoulements qui ont plissé l'écorce terrestre et sur le rôle des déplacements horizontaux, présenté en 1890, et qui ne fut imprimé qu'en 1908, après la mort de l'auteur. L'ouvrage avait alors vieilli, du fait du succès qu'entre temps, la théorie des charriages avait obtenu, mais on y trouve des « intuitions quasi-prophétiques » (Pierre Termier, 1908).
Eduard Suess et Marcel Bertrand, étroitement liés par la pensée, ont donc été, le premier par ses écrits, le second par ses remarques de terrain, les fondateurs de cette « nouvelle tectonique », qui a pris son essor au tournant des XIXe et XXe siècles. Il paraîtra singulier que le mot de « tectonique » n'ait été employé que très exceptionnellement par Suess et par Bertrand.
Le mobilisme trouva une nouvelle expression dans la « dérive des continents », idée géniale qu'Alfred Wegener développa de 1912 à sa mort en 1929. Les chaînes plissées de type alpin résulteraient de l'affrontement des continents (matériel Si-Al) flottant sur le matériel lourd (Si-Ma) des fonds océaniques. Il y avait dans cette proposition un changement dans l'échelle des déplacements horizontaux, passant de l'ordre de la centaine à celle de milliers de kilomètres. La théorie de Wegener ne remplaçait cependant pas celle de Marcel Bertrand, mais s'ajoutait à celle-ci. L'illustration en fut donnée par Émile Argand qui, adepte éminent de la théorie des charriages par la définition (avec Lugeon) de l'empilement des nappes internes des Alpes penniques, utilisa les idées de Wegener pour expliquer génialement la naissance des Alpes et celle de l'Himalaya.
À quelques exceptions près - celle d'Emile Argand en particulier - la plupart des géophysiciens et des géologues s'opposèrent aux idées wegeneriennes, ou voulurent les ignorer, comme on le sait. Une même désaffection atteignit, de 1925 à 1950, la notion de « nappes de charriage », la chaîne des Alpes en conservant presque seule - quoique parfois avec réticences - l'exclusivité ! Ce fut après la Seconde Guerre mondiale que la cartographie détaillée et l'étude structurale des chaînes de montagnes, en particulier péri-méditerranéennes, prouvèrent que la théorie des charriages n'était pas une idée hallucinante mais correspondait bien aux réalités. On retrouvait ainsi l'esprit des propositions de Marcel Bertrand.
S'imposèrent alors, à partir des années 1960-1970, les propositions que firent océanographes et géophysiciens anglo-saxons de la « New Global Tectonics », donnant une explication à la naissance des chaînes plissées avec leurs empilements structuraux, qui sont devenus une banalité que personne ne songe plus à discuter.
À la différence des idées d'Élie de Beaumont, presque toutes écroulées avant même la mort de leur auteur, les déplacements horizontaux se révélèrent, dans les chaînes alpines comme dans les chaînes primaires, tant en Europe qu'en Amérique du Nord, tellement nombreux que le nom des nouveaux découvreurs estompa quelque peu celui de l'inspirateur initial, Marcel Bertrand. Toutefois, spécialement en Provence où se situe son oeuvre essentielle de terrain, son souvenir a été célébré à plusieurs reprises. Longtemps après sa mort, Maurice Lugeon (in Suzanne Fabre-Taxy et Gueirard, 1950) disait, parlant de celui « qu'on pourrait appeler le Confucius de la tectonique » : « Certainement, si j'en juge par la correspondance que je possède [celle-ci semble avoir disparu] il était sur le chemin de l'hypothèse de la dérive des continents. »
De nombreux géologues - et des plus grands - se sont interrogés sur l'apport de Marcel Bertrand dans ce qui fut la « nouvelle tectonique » au début du XXe siècle. Déjà Edouard Suess (1904), dans un texte Sur la nature des charriages avait proclamé : « C'est aux géologues français et suisses, avant tout à M. Marcel Bertrand, que la Science doit les premières observations exactes sur le grand phénomène désigné sous le nom de charriage. »
Au lendemain de la disparition de Marcel Bertrand, Lucien Cayeux, président de la Société géologique de France, ouvre - tout à fait inhabituellement - la séance, le 18 février 1907, par une allocution émue, célébrant les qualités du disparu : « Dès 1887, il montrait l'existence et la généralité des phénomènes de recouvrement dans les grands mouvements orogéniques. M. Marcel Bertrand engageait ainsi la synthèse des chaînes de montagne dans une voie absolument nouvelle, et d'une fécondité qui paraît unique dans les annales de la géologie. [...] La théorie des phénomènes de chevauchement [...] est une de ces conceptions, réduites aux limites de l'observation, et qui ont le privilège de hâter la marche de la science sans l'égarer ». Et Cayeux - qui avait en 1891 admiré Bertrand, lors de la Réunion extraordinaire de la Société, dévoilant les structures du Beausset et de la Sainte-Baume - de parler des « admirables découvertes que ses vues géniales leur [à ses élèves et nombreux disciples] ont inspirées », concluant : « Quand la postérité, qui met toutes choses au point, portera son jugement sur notre époque, je suis persuadé qu'elle marquera la place de M. Marcel Bertrand à la suite des savants illustres qui incarnent les progrès de la science orogénique au siècle dernier, L. de Buch, Élie de Beaumont et M. Suess. » Cayeux a été bon juge.
De Suisse, du vivant de Bertrand, le premier découvreur des célèbres nappes des Préalpes, Hans Schardt, reconnut en 1893 que « le savant qui nous a surtout fait voir avec évidence l'existence de ce phénomène [celui du « charriage des masses sédimentaires, la formation des nappes de recouvrement »], dont on ne parlait pas encore à peine il y a dix ans, c'est M. Marcel Bertrand, et l'on peut bien dire qu'en le démontrant M. Bertrand s'est acquis un mérite égal à celui de Charpentier lorsqu'il établit la théorie de la période glaciaire. »
En Grande-Bretagne, le long hommage que Sir Archibald Geikie (1908), président de la Geological Society, consacra à Marcel Bertrand, célèbre l'homme et son oeuvre : « The new light which he threw on the fascinating questions of mountain-building placed him in the forefront of the geologists of his day ». Et de pleurer « the loss of one of the masters of tectonic geology, who has left the mark of his genius deeply impressed on the history of that department of our science. » De même, en 1935, dans ses Tectonic Essays..., Sir Edward Bailey - autre éminent géologue britannique - commentant l'apport de Marcel Bertrand dans tous les chapitres de son livre consacré aux Alpes et à la Provence, donne son avis : « Bertrand was a man of moods, and, in questions Alpine, enthusiasm and caution sometimes led him to and fro », reconnaissant toutefois qu'en 1884, dans la remise en question du « double-pli » de Glaris, Marcel Bertrand possédait une expérience qui, bientôt, atteignit « le génie ». Et Bailey conclut : « Admittedly, he was one of the greatest geologic leaders the world has even known: among his contemporaries, he ranked side with Suess, Charles Lapworth and Törnebohm. »
Au début du XXe siècle, on assiste à une longue passe d'armes entre Hans Schardt, Lugeon, Emile Haug et leurs affidés pour savoir lequel d'entre eux a eu le principal mérite dans la découverte des nappes, spécialement celles des Préalpes. En 1905, Frédéric Jaccard se hérisse devant l'affirmation de Gustav Steinmann - récemment converti à la doctrine des nappes - et qui parle de la « Schardtsch Ueberfaltung Theorie ». Jaccard réplique que « si nous voulons [...] rechercher l'auteur de la théorie des nappes de recouvrement, c'est à M. Marcel Bertrand que nous devons penser. Nous dirons donc la théorie de Marcel Bertrand et non la théorie schardtienne ! ». On comprendra que Frédéric Jaccard était à Lausanne avec Lugeon, ce qui l'amenait à sous-estimer l'incontestable priorité de Schardt dans l'explication des Préalpes !
Dans ces années d'ardentes polémiques entre « nappistes » et « anti-nappistes » attardés, ou entre les divers découvreurs de nappes, Marcel Bertrand resta silencieux : la maladie le tenait éloigné de tels débats, dont d'ailleurs le principe lui répugnait. Après sa disparition, un hommage tout particulier lui fut rendu par Otto Wilckens, rédacteur à la Geologische Rundschau et qui, auteur d'une thèse sur les Grisons sous la direction de Gustav Steinmann, était bien placé pour apprécier la rapide transformation dans l'interprétation des Alpes. C'est à Goethe - qui, dans sa jeunesse, avait tâté à la géologie des pays rhénans, en disciple de Werner - qu'il emprunte d'abord une strophe de Faust :
« Noch staart das Land von fremden Zentnermassen ; [Ce pays est rempli de lourds blocs étrangers ;]
Wer gibt Erklärung solcher Schleudermacht ? [Qui nous expliquera la force de ces jets ?]
Der Philosoph, er weiss es nicht zu fassen [Le philosophe, ici ne sait que faire]
Da liegt der Fels, man muss ihn liegen lassen [Puisque le bloc est là, qu'on le laisse par terre !]
Zu schanden haben wir uns schon gedacht... [Nous n'en avons que trop débattu sans profit.] »
(Goethe, Faust, acte 4, Hochgebirge) (traduction de J. Maleplate, 1984)
Ces mots de Méphistophélès - commente Wilckens - caractérisent incomparablement l'état dans lequel se trouvait encore la géologie des Alpes, il y a peu d'années encore. La montagne semblait donc être un chaos, soudant ensemble des morceaux d'origine diverse. Comme il en est autrement aujourd'hui !
« Nun haben wir's an einem andern Zipfel [C'est ainsi qu'en ces lieux tout a changé d'aspect]
Was ehmals Grund war, ist nun Gipfel [Ce qui jadis fut plaine est devenu sommet] » (Faust, idem)
Wilckens a retrouvé, sous la plume de Goethe, Méphisto cherchant à persuader le Dr. Faust de la réalité des révolutions du « foyer central », faisant craquer « la croûte » ! Revenant aux Alpes, il écrit : « si elles apparaissent aujourd'hui [nous sommes en 1909] aux géologues dans une vive lumière, nous le devons à la théorie des Nappes [à laquelle] s'attachent les noms de Schardt et de Lugeon ; mais le devoir de gratitude ordonne de ne pas oublier de tresser une couronne du souvenir à un homme, sans les travaux duquel ce grand progrès de notre science n'aurait pas été atteint : Marcel Bertrand. »
Le résultat, enfin acquis, de la confrontation inégale entre l'illustre Albert Heim, maître de la géologie germanique des Alpes, et Marcel Bertrand, ingénieur tard venu à la géologie, sur le problème de Glaris, a - Heim ayant rendu les armes ! - beaucoup impressionné en pays allemands. Et Wilckens poursuit : « En 1884 paraît un bref article de Bertrand qui dans les temps récents est si souvent cité pour caractériser sa perspicacité [...], brillante confrontation qui a prouvé [...] l'unité du charriage de Glaris ». Ainsi « on trouve la cinglante démonstration que dans la science, il y a quelque chose de plus que l'érudition [il évoque ainsi Heim !], c'est le Génie ». Revenant sur l'origine de l'idée de nappes, Wilckens conclut : « Il est finalement juste de parler d'une théorie de Bertrand-Schardt-Lugeon pour la structure des Alpes. Mais sans Marcel Bertrand cette théorie ne serait pas née. Schardt et Lugeon se sont juchés sur ses épaules, Suess ayant - comme Bertrand l'a souligné - montré la voie. »
De la part d'un géologue d'Outre-Rhin, dans l'atmosphère lourde qui régnait entre les deux guerres franco-allemandes, cet hommage « gemütlich » méritait d'être rappelé.
Bien qu'il soit galvaudé et difficile à définir, le mot de « génie », qui fut souvent prononcé à propos de Marcel Bertrand, trouve sa justification. Bertrand a souvent vu, à partir de documents d'une qualité remarquable (les schémas de Heim sur Glaris) ou à l'issue de très longues vérifications de terrain (Le Beausset), ce que les autres n'avaient pas vu, et qui nous apparaît aujourd'hui, où les mentalités ont changé, si évident. Bertrand a su, à partir de ces exemples locaux, généraliser en une théorie cohérente ses « nappes de recouvrement », prévoyant - ce qui très vite arriva - que toutes les grandes chaînes, qu'elles soient de l'époque primaire ou des temps tertiaires, montreraient de tels phénomènes. Et nous verrons également que la pensée de cet homme exceptionnel, comme François Ellenberger (1982) l'a bien souligné, a su décomposer les stades - chaque fois analogues - des grands cycles orogéniques.
Dans les pages qui vont suivre, écrites à l'occasion du centième anniversaire de la mort de Marcel Bertrand, ont été abordés certains aspects (ascendance, jeunesse, vie du jeune ingénieur des mines, initiation à la géologie dans le Jura) que les remarquables notices de Pierre Termier (1908) - son disciple le plus proche - ainsi que, quatre-vingts ans plus tard, de Rudolph Trümpy et Marcel Lemoine - bien placés pour juger de son oeuvre dans les Alpes -avaient traité rapidement. De même, la lecture de la plupart des quelque cent cinquante publications que Marcel Bertrand a écrites (liste in Termier, 1908) pendant ses vingt-deux ans de réelle activité géologique, a été facile grâce au recueil des Oeuvres géologiques de Marcel Bertrand (trois tomes, 1927 à 1931). L'initiative d'un tel recueil - cas exceptionnel en géologie -résulte d'un voeu du Congrès géologique international de Bruxelles (1922), sur une suggestion de Maurice Lugeon, la réalisation étant assurée par un vieil ami de Marcel Bertrand, Emmanuel de Margerie.
Dons intellectuels exceptionnels. Milieu social choisi où pensée et culture étaient à l'honneur. Il est vain, chez Marcel Bertrand, de chercher à distinguer la part de l'inné et celle de l'acquis ! Dans la formation de sa personnalité, il paraît certain que l'influence affective de son père a été prépondérante : ce puissant personnage, d'une grande culture et « d'une perspicacité légendaire » - selon Pierre Termier -, académicien à 34 ans, succéda à Élie de Beaumont comme Secrétaire perpétuel quai Conti et à Jean-Baptiste Dumas à l'Académie française. Joseph Bertrand s'intéressait au passé, en étant un véritable historiographe de nombreuses et diverses gloires scientifiques et en s'intéressant à sa propre famille. Il a laissé un texte manuscrit (Mss 2719, Bibl. Inst. France) relatant sa jeunesse, et on en trouve la trace dans les discours prononcés après sa mort par Marcellin Berthelot (1901) - qui lui succéda - et par Jules Lemaître (1901) - qui lui répondit - à l'Académie française, ainsi que dans l'éloge historique que fit Gaston Darboux (1901) à l'Académie des sciences : on peut s'y reporter avec fruit. En outre, une nièce de Joseph Bertrand - cousine germaine donc de Marcel -, Madame Forestier ( ?-1939) y ajouta la tradition familiale, dans un opuscule resté manuscrit (« Famille de science au XIXe siècle », Ms 7239, Arch. Acad. Sci. Paris). Fils aîné, Marcel Bertrand a dû être nourri de cette histoire familiale exceptionnelle où l'on peut suivre les faits et gestes de deux grands-oncles, de deux oncles et d'un père, presque tous polytechniciens et en tout cas tous membres de l'Institut de France. Il était tout naturel pour Marcel de chercher à faire comme eux !
Les dictionnaires biographiques de cette époque portent de longs textes concernant les trois générations de cette famille. Le mieux informé est le répertoire bio-bibliographique relatif à la Bretagne de R. Kerviller (Tome III, 1889).
L'histoire connue débute alors que l'Empire napoléonien va s'effondrer. Trois jeunes amis, frais émoulus du collège (futur lycée) de Rennes, partent à la conquête de Paris. Aux vacances d'été, ils regagnent pédestrement leur Bretagne, ne se doutant pas que leurs destins vont être intimement liés. Le plus âgé, Alexandre (I) Bertrand, né le 6 floréal an III (25 mars 1795) à Rennes, rue de la Monnaie, et sa jeune soeur Virginie, sont deux des six enfants d'un commerçant établi 20 places des Lices, à la limite de la vieille ville. Les archives municipales révèlent que leur père, Louis-Alexandre Bertrand, avait épousé Françoise Goupil, et il serait venu - selon Mme Forestier - du Cotentin. Tout indique que cette famille était rigidement républicaine et ennemie de la religion.
Le deuxième des trois amis, François Roulin (1796-1874), fils d'un ingénieur des ponts-et-chaussées, est également né à Rennes, alors que le troisième, Jean Duhamel (1797-1872) vient de Saint-Malo. Marcel Bertrand connaîtra bien Duhamel et Roulin, devenus entre temps ses grands-oncles et tous deux académiciens.
Jean Duhamel (Arch. Acad. Sci. Paris, dossier acad.) finira professeur de physique à la faculté des sciences de Paris et à Polytechnique. Il est élu à l'Académie des sciences en 1840 et la présidera en 1862. La petite histoire révèle qu'il fut reçu deux fois à Polytechnique : en 1813, à 16 ans, son rang d'entrée ne lui convint pas ; il recommença l'année suivante et fut second de la promotion, ce qu'il accepta ! L'École, turbulente, est fermée en 1816. Duhamel, audacieux, enlève puis épouse Virginie-Aimée Bertrand - soeur de son ami Alexandre -, part à Paris à l'École de droit, dont il est exclu pour raisons politiques. Il tire cependant son épingle du jeu et, ami d'Auguste Comte, devient directeur des études du collège Sainte-Barbe. Sur le conseil du banquier Isaac Pereire - famille avec laquelle il sera très lié -, Duhamel fonde, 130 rue de Vaugirard, une école préparatoire au concours d'entrée à Polytechnique. Une fois « arrivé », Duhamel et sa « sévère » et anti-cléricale épouse Virginie donnent d'impressionnants dîners où ils rencontrent « toutes les notabilités du temps ». Nous retrouverons Duhamel plus loin. Sachons cependant que le testament de sa veuve (Ms 2032-pièce 134, Bibl. Inst. France), énumérant les nombreux legs à sa famille, atteste la grande fortune amassée, sans doute sur les conseils de Pereire, par les Duhamel.
Quant au doux François Roulin (Arch. Acad. Sci. Paris, dossier acad.), il renonce à concourir à Polytechnique, du fait des événements, se contenant de faire sa médecine. Il va épouser l'une des quatre filles d'un homme politique connu de Rennes, Joseph Blin (1764-1834), qui sera - on le verra - l'un des arrière-grands-pères de Marcel Bertrand. Avec les conseils de Humboldt et en compagnie de l'agronome Boussingault, le couple Roulin quitte Paris, appelé par Bolivar en « Nouvelle-Grenade » (Colombie). Les promesses non tenues entraînent huit ans de vie difficile, que Roulin meuble de son mieux en naturaliste averti : il décrivit ainsi un tapir des Andes, inconnu avant lui, ce qui l'aidera à entrer à l'Institut ! Rentré à Paris, et sans doute sur l'idée d'Alexandre Bertrand - devenu entre temps son beau-frère - il devient journaliste scientifique au Globe, ainsi qu'au journal Le Temps qui publie des comptes-rendus des réunions de l'Académie des sciences. Réunies en un volume, ces chroniques attirent l'attention des secrétaires perpétuels Arago et Flourens qui vont décider en 1835 la création officielle des Comptes Rendus de l'Académie des Sciences : Roulin va, pendant trente ans, en assurer la parution, soutenu par sa grande réputation de naturaliste et d'érudit. Poussé par Nodier et par Mérimée, il avait été nommé sous-bibliothécaire à l'Arsenal, avant d'être en 1836 bibliothécaire à l'Institut, jusqu'à y devenir bibliothécaire en chef. Introduit dans tous les milieux parisiens, ce causeur aimable et lettré, linguiste et dessinateur, est reçu chez Cuvier et chez Adrien de Jussieu. Récompensé de son action, il est élu en 1865 comme « membre libre » de l'Académie des sciences. Nous le retrouverons plus loin, et c'est chez lui, quai Conti, qu'un jour, amené par son père, le jeune Marcel Bertrand aurait été conduit à interroger Mérimée !
Alexandre Bertrand (1795-1831) est le plus âgé des trois camarades rennais. Après des études - médiocres, paraît-il - au collège de Rennes, il est admis à Polytechnique en 1814, en démissionne après les Cent-Jours, et passe à Paris sa thèse de médecine en 1819. La même année, il épouse Caroline Blin, soeur de « Manette » (Mme Roulin). Ainsi - sa propre soeur Virginie ayant épousé Duhamel -, les trois amis (Bertrand, Duhamel et Roulin) sont devenus beaux-frères et ils resteront très liés leur vie durant. Alexandre est donc établi à Paris et y devient un praticien recherché. Habitant rue Saint-André-des-Arts, il s'installera en 1830 chez Duhamel, rue de Vaugirard. Alexandre est un personnage très répandu. Il s'intéresse au magnétisme chez le vivant, ouvre des cours sur le sujet, écrit plusieurs ouvrages (Traité du somnambulisme ; De l'extase ; Du magnétisme animal,...). Parallèlement, il est l'un des fondateurs du journal « de référence » qu'est Le Globe où, dès 1825, journaliste scientifique, il commente les séances des académies : ce qui, selon G. Darboux (1901), lui attire de grandes difficultés avec Cuvier, ennemi de la diffusion de la science aux masses ignorantes ! On peut ainsi considérer Alexandre Bertrand comme le créateur en France de la presse scientifique. Il était promis à l'Institut, si un sort malheureux n'allait l'atteindre : le 22 janvier 1831, il décède des suites d'une chute sur la glace. Il avait 34 ans, et sa famille va se disperser.
Ayant longtemps fréquenté les milieux académiques, Alexandre Bertrand avait écrit en 1826 un ouvrage in-8° de près de 500 pages (Lettres sur les révolutions du globe) où, en fonction des idées et des découvertes de l'époque, il traite de sujets divers, allant des groupes fossiles les plus variés (influence de Cuvier et de Geoffroy-Saint-Hilaire) à la constitution du globe (influence de Louis Cordier) et aux phénomènes naturels - éruptions et séismes - dont le public est toujours friand. Aux dix-neuf Lettres font suite des extraits d'articles choisis chez certains savants, comme Élie de Beaumont - évidemment ! -, Alexandre Brongniart, Louis Agassiz, Deshayes, Charles Lyell. À la 6e édition (1863), parue trente ans après la mort de l'auteur, seront jointes des notes rédigées d'après les savants du moment, les frères Henri Sainte-Claire-Deville et Charles Sainte-Claire-Deville, Achille Delesse, etc. Préfaçant cette édition, Joseph Bertrand, en fils respectueux, vante « la clarté, la pureté » d'un ouvrage qui est destiné aux « ignorants de bonne volonté » : ouvrage qui, de nos jours, apparaît comme une sorte de « recueil factice », que le petit-fils de l'auteur dut feuilleter sans enthousiasme.
Épouse d'Alexandre Bertrand, Caroline Blin - qui sera l'une des grands-mères de Marcel - et sa soeur Manette (Mme Roulin) ont joué un rôle important dans la famille Bertrand. Pour celle-ci, s'allier à la famille Blin (cf. Kerviller, 1886-1908, t. IV) était flatteur. Jacques-Bonaventure Blin (1726-1811), « noble homme » - appellation régionale non nobiliaire ! -chirurgien-démonstrateur royal puis médecin des épidémies, eut de Françoise Forestier de Villeneuve, trois fils dont une rue de Rennes porte le nom. L'un des deux premiers, tous deux médecins, suivit un parcours fréquent à l'époque : « révolutionnaire fougueux en 1789, impérialiste ardent en 1808, royaliste exalté en 1816 ». Le troisième, Joseph Blin (1764-1834), homme estimable, chef d'un bataillon de volontaires à la frontière en 1792, eut un rôle politique important : membre du Comité de Salut public, il fut, avec le maire Leperdit, l'un des principaux protecteurs de la population de Rennes que le « proconsul » Carrier terrorisait avant d'aller s'illustrer par les noyades de Nantes... Député d'Ille-et-Vilaine au Conseil des Cinq-Cents (ans 6 à 8), il était resté avec les siens - à la différence des Bertrand - fidèle à la religion catholique. Président de la « Fédération bretonne » en 1815, Joseph Blin, destitué à la Seconde Restauration de son poste de directeur des Postes, se retira dans sa campagne du Cheneverd, laissant l'image d'un homme politique intègre. Il restera un « héros » dans l'esprit de ses descendants.
Devenue veuve d'Alexandre Bertrand, Caroline Blin se replie à Rennes avec ses deux filles et son fils aîné Alexandre (II), laissant son second fils, Joseph - le futur père de Marcel - à Paris, chez les Duhamel.
Alexandre (II) (1820-1902) fait ses études à Rennes. Normalien en 1840, il est en 18481849 à l'École française d'Athènes. Devenu un helléniste et un archéologue connu, il remplace en 1881 Littré dans son fauteuil à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ses innombrables travaux traitent surtout d'archéologie grecque, gauloise, celtique, et d'anthropologie. Fondant en 1862 le Musée archéologique de Saint-Germain-en-Laye - où il va s'installer en famille, au château, en 1867 - il en sera le conservateur pendant 35 ans. À la fin de sa vie, Alexandre est pris par le virus de la politique (« les Bleus de Bretagne ») et la polémique. Avec son oncle Roulin, Alexandre (II) Bertrand dut influer sur le côté littéraire de Marcel Bertrand.
Louise Bertrand, l'une des soeurs d'Alexandre (II), épousa en 1848 Charles Hermite (1822-1901) qui fut un très grand mathématicien. D'abord athée, Hermite deviendra un catholique fervent et rejoindra le camp anti-dreyfusard, ce qui le différenciera des Bertrand. Il avait été élu à l'Académie des sciences la même année (1856) que son beau-frère Joseph Bertrand, avec lequel il se fâchera sans rémission, ce qui ne l'empêchera pas de considérer Marcel comme son neveu préféré. Marcel savait être « diplomate » !
Joseph Bertrand (1822-1900) fut donc confié par sa mère, repartie à Rennes, aux Duhamel, couple sans enfant, vivant rue de Vaugirard où leur institution se trouvait. Selon un texte inédit (Ms 2719-5, Bibl. Inst. France), Joseph écrit qu'enfant souffreteux, ses parents - ne pensant pas qu'il vivrait longtemps - avaient jugé inutile de l'instruire. Son père l'aurait amené en voiture, lors de ses visites à ses patients, en lui parlant en latin ! À la maison, quand il n'est pas alité, c'est en enregistrant mentalement les mots, lors des leçons données à son frère aîné, que Joseph apprend tout seul à lire.
Quand l'oncle Duhamel le prend en charge, l'enfant est installé au fond de la salle où, presque deux fois plus âgés que lui, les adolescents se préparent au concours pour Polytechnique. Joseph enregistre si bien les choses que Duhamel l'envoie en 1833 au collège (futur lycée) Saint-Louis. Stupéfait de son niveau intellectuel, il obtient que son neveu suive librement les cours de l'École polytechnique. Joseph, en même temps, fréquente ceux du Collège de France et du Jardin des Plantes. À titre d'essai, on lui fait subir - à onze ans ! - un examen, qu'il réussit, comparable à celui de l'entrée à Polytechnique. Cependant, vu son âge, il doit suivre les cours de la préparation « réglementaire ». En dehors des questions scientifiques, il se montre d'une ignorance crasse dans les autres matières, et il passera sa vie - a-t-il écrit - à tenter de pallier ses insuffisances. C'est donc en 1839, à 17 ans, qu'il entre à l'École, évidemment premier de la promotion. À la sortie, il passe à l'École des mines, dont il sort ingénieur en 1842, pour aussitôt démissionner car, également docteur ès-sciences, il va devenir professeur de mathématiques au lycée Saint-Louis (1844 à 1848).
Le 12 mai 1842, Joseph Bertrand est l'une des victimes du terrible accident survenu lors de l'inauguration du chemin de fer de rive gauche Paris-Versailles, qui fit 46 morts parmi lesquels le célèbre explorateur Dumont d'Urville et sa famille, brûlés vifs dans des wagons fermés à clé. L'accident résulta de la rupture d'essieu de la locomotive avant, entraînant le catapultage des wagons poussés à vive allure (40 km/h) par l'autre machine ! Joseph et Alexandre Bertrand étaient allés déjeuner (Forestier, s.d.) à Ville-d'Avray chez une famille Aclocque, avant d'assister aux Grandes Eaux à Versailles. Ils prirent le train de retour à cinq heures (du soir), quand, à hauteur de la route des Gardes, à Meudon, se produisit la catastrophe.
Les frères Bertrand et leur ami Michel Aclocque, agiles, peuvent sauter par la fenêtre. Ce dernier, malgré la fracture d'une jambe, ramène ses amis à Ville-d'Avray, Joseph portant sur son dos Alexandre, une jambe brisée. Ils sont transformés en véritables charbonniers ! On s'aperçoit alors que Joseph a le nez cassé et qu'il est défiguré. Il en conservera un aspect sarcastique. On le décrira comme « très probablement l'académicien le moins séduisant de tout l'Institut... trapu, tassé, boutonné, avec une grosse moustache, de gros sourcils et des yeux d'une vivacité étrange ». Ailleurs, on évoque « sa face large, écrasée, que l'on croirait empruntée au Musée Dupuytren » (musée des horreurs anatomiques !). Plus charitable, Berthelot (1901) voit « l'empreinte de sa race » bretonne, « dans l'aspect rond et brachycéphale de sa tête ».
Son nouveau visage ne compromet pas le mariage en 1844 avec Céline Aclocque, dont le frère - celui de l'accident de Meudon - camarade de Polytechnique, deviendra ingénieur des ponts-et-chaussées et laissera (Berthelot, 1901) sa trace dans l'industrie. L'on sait peu de choses sur Céline Aclocque, sinon qu'après la mort de son mari, elle négociera (Mss 2719-28, Bibl. Inst. France), femme de tête, avec l'éditeur Hachette pour les oeuvres de son mari disparu. Selon sa nièce (Mme Forestier), elle descendait du valet de chambre de Louis XVI, suivant et assistant celui-ci au Temple, avant d'émigrer, ses biens étant saisis et sa trace disparue. Céline Aclocque mourra en 1907, peu de temps après son fils aîné Marcel.
La jeune famille, qui habite alors rue des Francs-Bourgeois, va avoir six enfants, de 1845 à 1857. Le deuxième, Marcel, est l'aîné des garçons. En 1848, Joseph s'intéresse aux événements et participe à des réunions publiques. Il doit s'y montrer suffisamment convaincant pour être choisi par ses auditeurs comme « capitaine de la Garde nationale » : sans doute en souvenir du fait que, sortant d'une école militaire, il doit être apte au commandement, il doit donc diriger l'entraînement de sa compagnie. « Un jour, place de l'Odéon, pendant une pause, il aperçoit son fils Marcel dans les bras de sa bonne ; il se met à jouer avec l'enfant. Roulement de tambour, fin de la pause, et la bonne disparue. Il commande [alors] les soldats avec son fils dans les bras ». On doit avoir dans cette citation la première mention publique, à l'âge d'un an (Marcel est né en 1847), de notre futur géologue !
Joseph Bertrand (Arch. Acad. Sci. Paris, dossier acad.) entame alors sa course aux honneurs. Après le lycée Saint-Louis, il enseigne successivement à l'École normale, au lycée Napoléon [Henri IV], à l'École polytechnique où il sera professeur d'analyse en 1856, devenant le collègue de son oncle Duhamel qui enseignait depuis 1851 dans une autre chaire d'analyse. Plus tard, Joseph Bertrand suppléera Biot - qu'il remplacera en 1862 - au Collège de France dans une chaire de physique mathématique. À en croire un commentateur resté anonyme - l'un de ses futurs confrères à l'Académie française (Ms 3746, Bibl. Inst. France) - « quoique mathématicien hors ligne, il a la démonstration confuse et l'enseignement assez obscur » ! Ce qui ne l'avait pas empêché d'être élu à 34 ans à l'Académie des sciences, à sa seconde tentative. Le commentateur inconnu poursuit ainsi : « Bertrand me paraît un homme doux, spirituel, aimable, un peu désorienté chez nous [à l'Académie française] mais prenant part aux discussions avec bon sens et modération. Il est assez assidu aux séances et [cela apparaît capital !] témoigne à ses confrères une déférence qui lui est rendue et qu'il mérite. » Cela montre la manière dont un scientifique mal dégrossi est tenu parmi les « Immortels ».
La maison des Bertrand, rue de Rivoli, devient (Berthelot, 1901) un centre de réunions pour la jeunesse des deux sexes. « Vers 1860 [Marcel avait 15 ans et devait ne pas être loin] on rencontrait dans son salon à la fois les familles des savants réputés [...] mais ce que l'on agitait surtout chez Bertrand, c'étaient les questions de sciences, de lettres et d'art à l'ordre du jour : la politique était alors écartée des conversations collectives. Bertrand n'en eut jamais le goût, pas plus que des discussions religieuses ou philosophiques proprement dites. Il ne s'était jamais déclaré ni royaliste, ni républicain, ni impérialiste, étant peu favorable d'ailleurs à la démocratie. » Devenu membre de l'Académie française, Joseph Bertrand était reçu chez la célèbre princesse Mathilde, cousine de l'ex-empereur Napoléon III. Les enfants Bertrand étaient à bonne école.
En 1870, Paris est assiégé par les Prussiens. Comme Joseph enseigne à Polytechnique, il participe à la garde du bastion près de la porte de Bicêtre où est installée la batterie de l'École. Pendant ce temps, la Commune prend le pouvoir en ville. En mai 1871, l'immeuble où se trouve l'appartement des Bertrand, rue de Rivoli, est incendié : bibliothèque et manuscrits du mathématicien brûlent. De son côté, leur villa de Sèvres, occupée par l'ennemi, est pillée, les meubles brûlés (l'hiver était glacial !). L'École polytechnique émigre en 1871 à Tours.
À Sèvres, « une sorte de confrérie animée » de voisinage se réunissait chez l'un ou chez l'autre, en particulier chez les Bertrand. Outre le chimiste Berthelot, on trouvait Ernest Renan, l'industriel Charles Laboulaye, l'éditeur Hetzel qui publiait les romans de Jules Verne avec lequel Bertrand était lié.
La tourmente passée, le couple Bertrand achète un grand chalet à Viroflay. Ils reçoivent là, comme à Sèvres auparavant. L'écrivain Jules Claretie, le médiéviste Gaston Boissier se joignent aux réunions. À Paris, la famille Bertrand est maintenant installée rue de Tournon. Joseph Bertrand a, depuis la perte de ses documents, abandonné la mathématique militante et son goût pour l'histoire des sciences se développe. La famille tient toujours salon. En 1878, Joseph Bertrand renonce à son cours à Polytechnique et, en 1885, il remplace par tradition sous la Coupole son prédécesseur Jean-Baptiste Dumas : une seule voix des vingt-sept votants -celle de Victor Hugo ! - lui échappe. Mais l'âge vient : en 1889, Joseph renonce à sortir et s'affaiblit. L'affection unissant père et fils permet d'assurer que Marcel Bertrand est assidu auprès de Joseph, qui va disparaître le 3 avril 1900. Sa nièce, Mme Forestier, a noté : « Joseph n'est pas croyant, mais il est enterré à Saint-Sulpice avec toute la pompe religieuse... ».
En 1860, Marcel n'est plus un enfant. Fils aîné et manifestement préféré, il est celui sur lequel reposent les espoirs du père, qui retrouve en lui ses propres capacités intellectuelles. Mais alors qu'il n'avait pas réellement suivi d'études, il se doit de faire suivre à Marcel un parcours où science et culture s'ajoutent, probablement dans un lycée parisien. Joseph enseignant de 1854 à 1856 au lycée Napoléon (futur lycée Henri IV), il y a peut-être amené Marcel, à moins que celui-ci - comme son père au même âge - n'ait fréquenté le lycée Saint-Louis.
Parmi leurs petits-neveux, avant 1870, les vieux académiciens Duhamel et Roulin, tous deux sans descendance - qui avaient une prédilection pour Joseph, le père - reportent celle-ci sur Marcel, l'espoir de la famille tout entière. Ce dernier devait faire les visites coutumières et rencontrer chez ses grands-oncles des personnalités de l'époque : on le sait pour Mérimée, qu'il vit chez Roulin. Au château de Saint-Germain, devenu résidence de son oncle Alexandre, il fut nécessairement en contact avec le monde archéologique : on sait que Maspero et Renan en étaient des familiers.
Les documents concernant cette période de la vie de Marcel manquent. Berthelot (1901) fait cependant allusion à une lettre de Joseph Bertrand où celui-ci parle de son fils Marcel, traversant le Saint-Gothard en 1861 (il avait 14 ans) et ne voyant dans la nature qu'un sujet de vers latins !
Naturellement, l'adolescent est orienté sur Polytechnique. Sa facilité - pour lui, « apprendre est un jeu », a écrit Termier (1908) - entraînant un certain dilettantisme, fait qu'il n'y est admis, en 1867, « que » troisième, ce qui dut décevoir son père. Il en sortira en 1869, quatrième sur une promotion de 124 élèves. On possède une photo du jeune polytechnicien en tenue militaire, bicorne sur la tête (Fig. 1). Sa notice réglementaire indique ses caractéristiques physiques : cheveux châtains, front et nez « ordinaires » ( !), yeux châtains [sic], bouche moyenne, menton rond, visage ovale ; taille, 1 m 64. Grade : sergent-fourrier !

Fig. 1. Marcel Bertrand, élève à l'École polytechnique. © École polytechnique
Son rang de sortie lui permet de choisir - comme papa ! - l'École des mines. Nous savons grâce à Pierre Termier (1908) - qui recueillit les confidences de son maître - que « de 1869 à 1872, il avait suivi sans enthousiasme aucun et même avec un dédain mal dissimulé, les cours de l'École [...], trouvant terriblement ennuyeuse la géologie de Béguyer de Chancourtois, s'endormant à la leçon solennelle et interminable qu'Élie de Beaumont, suppléé par Chancourtois pour tout le reste du cours, venait faire sur le "refroidissement du globe", et n'ayant d'ailleurs, pour les applications de la science à l'industrie, qu'une indifférence courtoise et glacée ». Cela explique que, sur cinq élèves-ingénieurs de sa promotion (décret impérial du 11/9/1869), il n'ait été que quatrième.
En 1870, avec ses camarades, Marcel participe à la défense de Paris assiégée, comme lieutenant d'artillerie. On peut supposer que les stages traditionnels de fin d'études n'aient pas eu lieu, par suite de l'occupation du pays par les troupes allemandes. Le voilà donc converti « d'élève ingénieur » en « ingénieur ordinaire » au Corps des mines (décret du 21/6/1873). Il a 27 ans, n'a pas de projet bien clair et suit le mouvement, devant quitter Paris et ses charmes.
Nous retrouvons ainsi le jeune « ingénieur ordinaire » affecté au sous-arrondissement minéralogique de la Haute-Saône, département qui touche l'Alsace annexée à l'Empire allemand. Avait-il guidé ce choix afin d'être relié directement à Paris, en une demi-journée du nouveau chemin de fer ? En tout cas, le voici dans une minuscule préfecture de quelque 7 000 habitants, au milieu des plateaux du bas Jura.
Des ingénieurs fort connus avaient auparavant occupé ce poste. L'un d'eux, Charles-Edmond Thirria (1796-1868) avait utilisé son long séjour pour lever une carte géologique du département au 380 000e, coloriée à la main, avec une planche de coupes, que complétera une Statistique (1833) qui fit date. Elle constituait une excellente base pour connaître le département, donnant maints détails sur les exploitations avec leur historique, essentiellement sur les mines de houille stéphanienne de Ronchamp et de Champagney. L'ouvrage donnait également le détail des recherches - à l'époque de Gensanne - sur les filons métallifères (Cu, Pb, Fe) abandonnés de Plancher-les-Mines et de Château-Lambert, liés à des « porphyres » que l'on sait maintenant correspondre à un volcanisme sous-marin spilito-kératophyrique du Dévono-Dinantien sud-vosgien.
Thirria occupa le poste de Vesoul de 1825 à 1840, obtenant de le conserver et d'y résider tout en devenant ingénieur en chef de tout l'arrondissement minéralogique. Il le quittera pour occuper à Paris le poste de Secrétaire général du Conseil des mines, mais regagnera Vesoul, où il s'était marié, pour y devenir un temps conseiller général.
Pionnier de la géologie du Jura, comme Thurmann, Thirria avait découvert la gerbe des failles, grossièrement parallèles et de direction SW-NE, qui brisent les plateaux jurassiques, en reliant le sud des Vosges au Massif Central via le petit massif de la Serre, en particulier la « grande faille » (parmi les quatorze qu'il distinguait) de l'Ognon. Marcel Bertrand pourra ainsi s'initier au style tectonique de la région et à la succession des formations : au-dessus du socle vosgien et de sa couverture détritique du Houiller et du Trias germanique, Thirria avait distingué un « Liassique » sous le « Jurassique », abondamment daté et subdivisé en une dizaine de termes aux qualifications anglaises, allant de l'Oolithe inférieure aux calcaires de Portland. Cette initiation à la géologie locale servira beaucoup Marcel Bertrand, quand il aura la mission de lever les feuilles régulières au 80 000e de Gray (publiée en 1880) et de Besançon (publiée en 1882).
La mission d'ingénieur ordinaire avait été définie par un décret de 1810 ( !) prescrivant que celui-ci devait inspecter les exploitations - surtout mines et « minières » - de son arrondissement une fois par an, des « garde-mines », sous ses ordres, devant le seconder et réunir les documents pour faciliter et abréger les visites. En outre, l'Annuaire-Almanach (éditions de 1869-1870) de la Haute-Saône précisait que « l'ingénieur ordinaire est à la disposition des industriels et des agriculteurs pour exécuter les analyses des minéraux, terres, engrais, produits d'art, [...]. Les analyses sont en général gratuites ». On doute que Marcel s'y soit réellement livré.
Les ouvrages sur Vesoul indiquent qu'en 1834 (Thirria était alors ingénieur ordinaire) un « bureau des Mines » s'installa dans l'ancien couvent des Ursulines, devenu la même année « École normale » de garçons. On peut supposer que ce local technique abritait le « laboratoire » et l'administration des mines. Quant à l'ingénieur, il semble avoir travaillé à son domicile (en 1875 : 20 rue du Breuil, à la limite ouest de la bourgade).
Le traitement d'un « ingénieur ordinaire » de 3e classe (classe de début), était en 1872 de 2 500 francs. Quand Marcel passera, au bout de 4 ans et demi, en 2e classe, le montant fut porté à 3 500 francs. Un employé de bureau était payé par une subvention départementale, qui était si insuffisante que l'ingénieur avait dû, en 1861, la compléter par 300 francs de sa poche ! Cependant, Henri Poincaré - le futur célèbre mathématicien, qui succédera à Bertrand - reçut, en 1879, 600 francs de frais de bureau, que son prédécesseur immédiat avait peut-être aussi obtenus. À titre documentaire, un instituteur de 1e classe touchait en fin de carrière 1 200 francs, ce qui était considéré comme misérable.
Si l'on excepte Thirria, qui s'incrusta à Vesoul, s'y maria et finit par y mourir, les ingénieurs ordinaires des mines n'y faisaient pas long feu. Ainsi Achille Delesse (1817-1881) - autre géologue connu - y avait été basé de 1845 à 1849, profitant pour s'en évader de la création de la chaire de géologie de la faculté des sciences de Besançon, avant d'entamer sa brillante carrière, à la fois professorale et politico-économique, à Paris, couronnée par un fauteuil d'académicien. Dans le défilé de ses successeurs en Haute-Saône, on arrive ainsi à Choulette - camarade d'Auguste Michel-Lévy, avec lequel il étudia les filons métallifères en Bohême et en Saxe - mais celui-ci, en 1871, décède en fonctions. L'ingénieur Henry, nommé en juillet 1871 (après la guerre) se débrouille pour rester à Paris, adjoint au professeur de docimasie de l'École des mines. Il ne dut pas mettre les pieds à Vesoul, où Rigaud, ingénieur ordinaire à Chaumont, assura l'intérim. C'est sans doute lui qui introduisit son jeune camarade Marcel Bertrand, nommé le 1er août 1873 au sous-arrondissement de Vesoul, dépendant de l'arrondissement minéralogique, basé tantôt à Dijon (1870), tantôt à Chaumont (1873), sous la houlette de l'ingénieur en chef Trautmann, que nous retrouverons plus loin. Marcel, lui, était chargé, outre les mines, du « service spécial de l'établissement thermal de Luxeuil » fort prisé depuis le Second Empire, à deux heures de cheval de Vesoul.
La vie d'ingénieur de Marcel à Vesoul. Il dut arriver de Paris à la fin d'un après-midi d'août, par le train direct de la ligne Paris-Belfort et, à son arrivée, charger ses cantines dans la voiture hippomobile du service de la gare qui allait l'emmener à son domicile, réservé par l'un de ses futurs collaborateurs, dans la vieille ville, au pied méridional de la haute colline de la Motte, qu'une chapelle alors toute neuve couronnait. Il dut sans retard escalader la pente de marnes liasiques et, du chapeau de calcaires bajociens de cette butte-témoin isolée, apercevoir une bonne partie du territoire qu'il allait contrôler, des premiers reliefs lointains du Jura à l'est jusqu'aux plateaux calcaires du Jurassique moyen (le « Vésulien » !) et supérieur aux approches sud du bourg. Puis ce furent les visites protocolaires aux autorités préfectorales dont il dépendait et aux divers collègues des services administratifs, certainement flattés de recevoir à Vesoul le rejeton d'un célèbre académicien parisien. Le caractère souple de Marcel allait lui permettre de naviguer aisément dans le milieu local, surtout monarchiste ou bonapartiste, modéré il est vrai, qu'alarmaient les soubresauts d'une république naissante. Quant aux préfets (Marcel en connut quatre en quatre ans), ils valsaient suivant les changements de pouvoir à Paris. Heureusement, le millier de hussards du 9e régiment de cavalerie amenait une certaine harmonie patriotique, dans cette cité proche de la nostalgique « ligne bleue des Vosges », avec leurs défilés et leurs concerts bi-hebdomadaires.
L'ingénieur Bertrand trouve à Vesoul deux garde-mines. L'un, Bonnaymé, muté à Belfort, l'y seconde pour le « contrôle des chemins de fer de l'Est » - qui s'est ajouté en 1877 aux charges statutaires de Vesoul - et le remplacera à son départ en 1879, pour la visite des mines.
L'activité administrative du jeune ingénieur ne peut pas être appréciée par la lecture des comptes-rendus (« procès-verbaux ») directs des visites, que les Archives de Haute-Saône ne possèdent pas. Par contre, on peut y consulter la copie des « Observations » que, réglementairement, l'ingénieur en chef Trautmann devait envoyer en fin d'année au ministre des Travaux publics : ces observations résumaient les rapports que lui avaient adressés les ingénieurs ordinaires. Malgré les gémissements ministériels, ces textes étaient envoyés à Paris avec des mois de retard, et il est à craindre que, dans le cas de la Haute-Saône, Bertrand n'en ait été responsable.
En 1874 : « Rien de marquant [...] cette année dans les mines du dépt. de la Haute-Saône ; on peut pourtant regretter que les procès-verbaux de visite de M. Bertrand soient un peu trop écourtés et ne donnent pas une description suffisamment détaillée de l'activité et de l'état de ces exploitations... ». En 1875 : « Aucun fait saillant [...] dans les houillères du dépt. de la Haute-Saône, sinon l'insuccès d'un sondage et la recommandation de chercher la suite des couches houillères de Ronchamp vers le sud ou le sud-ouest ». On pourrait penser que Marcel s'est rangé, mais. en 1876, l'ingénieur en chef écrit : « M. Bertrand, dans ses procès-verbaux de visite, ne dit nulle part que, conformément aux prescriptions de l'article 6 du décret du 3 janvier 1813 ( !), ses procès-verbaux aient été insérés dans les registres des exploitations [sans doute formule polie pour dire qu'il ne l'avait pas fait] ; de plus M. Bertrand a rédigé ses procès-verbaux à Vesoul quelques jours après la visite, au lieu de les dresser sur les lieux le jour même de la visite, ce qui sans doute, lui aurait permis d'entrer dans un peu plus de détail. »
Ces remarques, certainement justifiées (l'avenir les vérifiera, pour les levers de terrain sans notes prises sur place), traduisent, à l'égard de son jeune camarade, l'irritation d'un supérieur d'un strict légalisme administratif. On remarquera que le travail essentiel de Marcel concernait les travaux de recherche et d'exploitation de Ronchamp. Des besognes annexes devaient s'y joindre de temps à autre : en août 1875, le voici chargé, pour la Haute-Saône, des examens préalables des candidats à l'École des mines de Saint-Étienne, alors destinée aux futurs directeurs d'exploitation et aux « garde-mines ». En juin 1876, il est attaché à la Commission régionale de l'Ouest [sic] pour les examens d'admission aux Écoles d'arts et métiers.
L'insertion de Marcel dans la vie de Vesoul. Certainement, les lettres à sa famille pourraient décrire la vie du jeune ingénieur. On en est réduit à feuilleter la presse locale. Celle-ci mentionne, au printemps 1875, qu'une « cavalcade vésulienne », au profit de l'hôpital et des pauvres, comportera un grand nombre d'attractions, avec plusieurs fanfares, des pelotons du 9e Hussards encadrant, en tête et en queue, la manifestation. Ces défilés de l'après-midi rassemblèrent un peuple immense, venu de tout le département à pied, à cheval, en voiture. Doit-on être surpris que, dans le comité d'organisation, figure en bonne place, avec un jeune conseiller de préfecture, sous la présidence du baron Bouvier - personnalité locale -, « Bertrand, ingénieur des Mines » ? On peut conclure que celui-ci, loin de se réfugier dans une retraite boudeuse de Parisien exilé, s'associait gaiement au personnel civil ou militaire de son statut et de son âge. Ainsi dut-il participer, ce dimanche 14 mars 1875, au bal de la mairie où, jusqu'à six heures du matin, rapportent les gazettes, les beautés vésuliennes virevoltèrent aux bras des jeunes officiers et des jeunes fonctionnaires d'avenir.
La participation à la vie locale se faisait aussi dans la sphère culturelle. On sait rarement que Vesoul possède une des plus anciennes sociétés scientifiques de France. Fondée en l'an IX [1801] - et toujours active - la Société d'Agriculture, Sciences et Arts du département de la Haute-Saône (son sigle « SALSA » ajoute les Lettres à son objet initial) rassemblait, à la fin du XIXe siècle, une centaine de membres, dont une cinquantaine de « résidants ». Le géologue Thirria l'avait présidée en 1840. Marcel dut s'y inscrire rapidement, les bulletins de 1876 à 1878 signalant sa présence à certaines des réunions mensuelles. Elle possédait une commission du musée et des collections, divisée en trois sous-commissions, celle de géologie comptant huit membres et dirigée par l'architecte Dodelier. On y trouve, outre Bertrand, de vrais géologues amateurs. Ainsi le commandant du génie en retraite Sautier, membre de la Société géologique depuis 1854, auquel Henri Coquand dédia un Strombe et qui avait publié sur le Haut Jura. C'est aussi le jeune Paul Petitclerc (1840-1937), fils d'un maire de Vesoul révoqué par la République, et qui publiera par la suite des notes sur la stratigraphie et la paléontologie du Jurassique du Jura, parfois avec Wilfrid Kilian, en rassemblant des collections de fossiles, qu'il offrira en particulier au Muséum de Paris : inscrit à la Société géologique en 1878 - comme Bertrand - Petitclerc gardera des rapports avec ce dernier, assistant à la Réunion extraordinaire de 1885 dans le Jura. Intéressés eux aussi à la géologie, quelques jeunes ingénieurs polytechniciens, deux des ponts-et-chaussées, deux du Service des forêts, durent être des familiers de Bertrand. On apprendra que celui-ci effectua, selon une déclaration du président Reboul de Neyrol (du 28 décembre 1876), un premier triage des échantillons du musée.
Le 29 juillet de la même année, il est nommé dans le comité départemental chargé du problème du phylloxera : il y côtoiera Perron, receveur municipal et vice-président du comice agricole de Gray, géologue amateur qui avait publié à la Société géologique sur le Jurassique supérieur des environs de sa ville. En 1877, on trouvera Marcel secrétaire du comité départemental de l'Exposition universelle, car il doit préparer la présence des productions de la Haute-Saône à la manifestation de Paris. Mais toutes ces initiatives n'auront qu'un temps. À son départ, le relais sera pris, pour les collections géologiques de Vesoul, par Paul Petitclerc qui, devenu notabilité locale, aura sa mémoire perpétuée par le nom d'une rue de Vesoul.
Il est certain aussi que Marcel Bertrand a effectué des levers géologiques durant son séjour à Vesoul. Le nouveau fond topographique au 80 000e en hachures allait permettre de réaliser une vraie carte géologique. Une délibération du Conseil général en avril 1875 concerne « la carte géologique de la Haute-Saône », « présentée par MM. Bertrand et Lebleu » (ce dernier pour une partie agronomique ?). Un rapporteur en souligne l'utilité. Comme « la seconde moitié de la dépense » est votée, on en conclura que le travail, bien avancé, avait dû débuter au moins en 1874. Cette carte départementale ne semble pas avoir vu le jour. Sans doute, la feuille de Gray (1880) de la carte régulière, sur le même fond, a-t-elle utilisé ces données inédites, une planche de coupes (comme l'avait fait Thirria) lui étant annexée.
Bertrand quitte Vesoul en janvier 1878. Henri Poincaré lui succède mais ne le remplacera sur place que le 1er avril 1879, pour peu de temps puisqu'il sera nommé chargé de cours de calcul différentiel et intégral à la faculté des sciences de Caen dès le mois de décembre suivant. C'est donc l'ingénieur en chef Trautmann qui va assurer l'intérim entre les deux hommes, aidé par les collaborateurs de Bertrand, les garde-mines Bonnaymé et Chalot, qui, en fait, ont eu longuement un rôle essentiel au service minier de Vesoul, où les jeunes « ingénieurs ordinaires », eux, apprenaient leur métier.
À la mort d'Élie de Beaumont, son fondateur, le Service de la Carte géologique détaillée de la France commença à être réorganisé par Eugène Jacquot, nommé directeur en 1875 et qui occupera le poste pendant douze ans. Avant lui, seuls quelques ingénieurs des mines (tels Edmond Fuchs, Alfred Potier, Albert de Lapparent et Henri Douvillé) étaient chargés des levers de terrain. Jacquot en augmenta le nombre et ouvrit le Service à des « collaborateurs », universitaires ou amateurs. Vrai géologue, ayant à son actif plusieurs cartes et monographies, spécialement en Aquitaine, le nouveau directeur entendait - a écrit Pierre Termier - « choisir ses collaborateurs, et n'aimait guère qu'on les lui imposât ; il se méfiait beaucoup de la prétendue conversion à la géologie d'un jeune camarade [Marcel Bertrand] qui, dans les années d'école, n'avait manifesté aucune tendance à cultiver les sciences naturelles ; il s'opposa donc, tant qu'il put, à sa nomination ». On aurait donc pu supposer qu'affecté « sans mission précise » au Service le 28 janvier 1878, Marcel ait été fraîchement accueilli dans cette annexe de l'École des mines, au 62 boulevard Saint-Michel : toutefois, nommé « adjoint » du Service le 4 mai 1877, tout en restant affecté à son service ordinaire à Vesoul, on doit penser que Jacquot avait baissé son opposition. Ses craintes furent rapidement levées : Bertrand devint un efficace cartographe qui réalisera une dizaine de coupures de la carte régulière au 80 000e, en commençant dès 1880 par la parution de la feuille de Gray.
Il fut en effet chargé des feuilles du Jura, sans doute du fait qu'il était familier de la Haute-Saône. Il a donc, de 1878 à 1886 - tout en travaillant (après 1881) en Provence - cartographié la chaîne allant du nord (Gray, Besançon) vers le sud (Nantua). Il est difficile de suivre précisément son parcours, les comptes-rendus annuels des campagnes de levers n'étant pas encore imprimés à cette époque. Nous savons cependant que, le 27 avril 1881 (Recueil Lacroix, Arch. Acad. Sci. Paris, 1 J-22-3) Jules Marcou, séjournant à Salins, sa ville natale, écrivait à son jeune ami Gustave Dollfus : « Marcel Bertrand [dont il venait d'apprendre qu'il était fils du mathématicien] s'est décidé à me faire visite la veille et le jour de Pâques, et je crois qu'il est parti convaincu que je n'étais pas l'ogre qu'on lui avait représenté ». Et l'acerbe Salinois d'ajouter : « Il est gentil et dévoué à son travail. »
Marcel, chemin faisant, apprenait son métier sur une succession stratigraphique déjà bien connue. Les Recherches géologiques sur le Jurassique salinois de Marcou avaient, dès 1846, donné un excellent tableau du Jurassique de Franche-Comté. Et, du point de vue structural, « en 1847 le Jura était certainement la mieux connue des chaînes de montagne » a écrit Marcel en 1889, dans son Éloge de Charles Lory. Il ajoutait que le « mélange de simplicité dans l'ensemble, et de complications locales », fait du Jura « une merveilleuse école pour l'étude de chaînes plus complexes [...], modèle réduit et simplifié, presque comme un modèle démontable des Alpes. »
Parmi les travaux structuraux consacrés au Jura se détachaient particulièrement ceux de Jules Thurmann, concernant la Haute chaîne et le versant helvétique. Bertrand va, prudemment, émettre quelques idées générales. Pour lui, la courbure du Jura, qu'il voyait esquissée dans la géographie des faciès du Jurassique supérieur, était liée à celle de « la bande des massifs anciens qui va du Plateau central aux Vosges et à la Bohême » : il suivait en cela une idée de Suess. Les plissements réguliers du Jura oriental « appellent l'idée d'une compression latérale, dont il semble difficile de ne pas chercher la cause première dans le soulèvement alpin » (Bertrand, 1884) : cette idée avait été émise anciennement par l'ingénieur Parandier et par le capitaine Claude Rozet, Thurmann lui-même s'y étant tardivement rallié.
Contrairement aux idées antérieures, Bertrand admet la relation ordinaire des failles avec les phénomènes de plissement (Bertrand, 1884), ce qui prouverait leur caractère superficiel. Il note aussi que les « renversements » de séries sont peu accentués mais, lorsqu'ils sont plus marqués, ils se font vers le nord-ouest. L'attention de Marcel s'est portée surtout sur les failles, pour lui « sujet d'étude et non [...] objet de constatation ». Il s'attaquait ainsi à une question que Just Pidancet (1823-1871) avait déjà abordée. Préparateur de Delesse puis de Henri Coquand à la faculté de Besançon, ce singulier personnage, velléitaire et imprévisible, est reconnu par Marcel Bertrand comme ayant été « l'un des plus originaux et des mieux armés parmi les géologues franc-comtois », et cela bien qu'il en ait contesté certaines affirmations autour de Besançon. Là, dans une note à la Société d'Émulation du Doubs (1848, publ. 1850), Pidancet figure une série de failles verticales sur une très belle planche de coupes en couleurs. Il affirme - ce que Bertrand contestera - que ces failles ont formé « un véritable obstacle au développement des plissements réguliers » qui, à leur contact, se recourberaient jusqu'à se paralléliser avec elles. Pidancet supposait que ces « failles principales ou continues » du Jura se disposent suivant trois directions différentes, pour lesquelles il utilise la terminologie d'Élie de Beaumont. Il reconnaît cependant que les unes (N-40° à 45°E), qui devraient, suivant le dogme, se rapporter au « système de la Côte d'Or » - d'âge théoriquement fini-jurassique - affectent le Néocomien. Certaines autres (N-S) dateraient du milieu du Tertiaire (« système de la Corse et de la Sardaigne ») et d'autres enfin (N-75° à 80°E), de la fin de cette ère (« système des Alpes principales »). À côté de ce premier type de failles, Pidancet distingue des « failles de ploiement » suivant l'axe des plis (ce sont celles de Thurmann dans le Haut Jura). Quant à ses « failles d'affaissement », il s'agit de panneaux calcaires glissant sur les pentes du Lias marneux (les futurs « décoiffements » de Lugeon). On retirera des écrits de Pidancet l'idée, très moderne, du polyphasage de la fracturation du Jura.
Les propositions de Bertrand sont tout autres et plus explicatives. Il s'intéresse spécialement à trois types d'accidents.
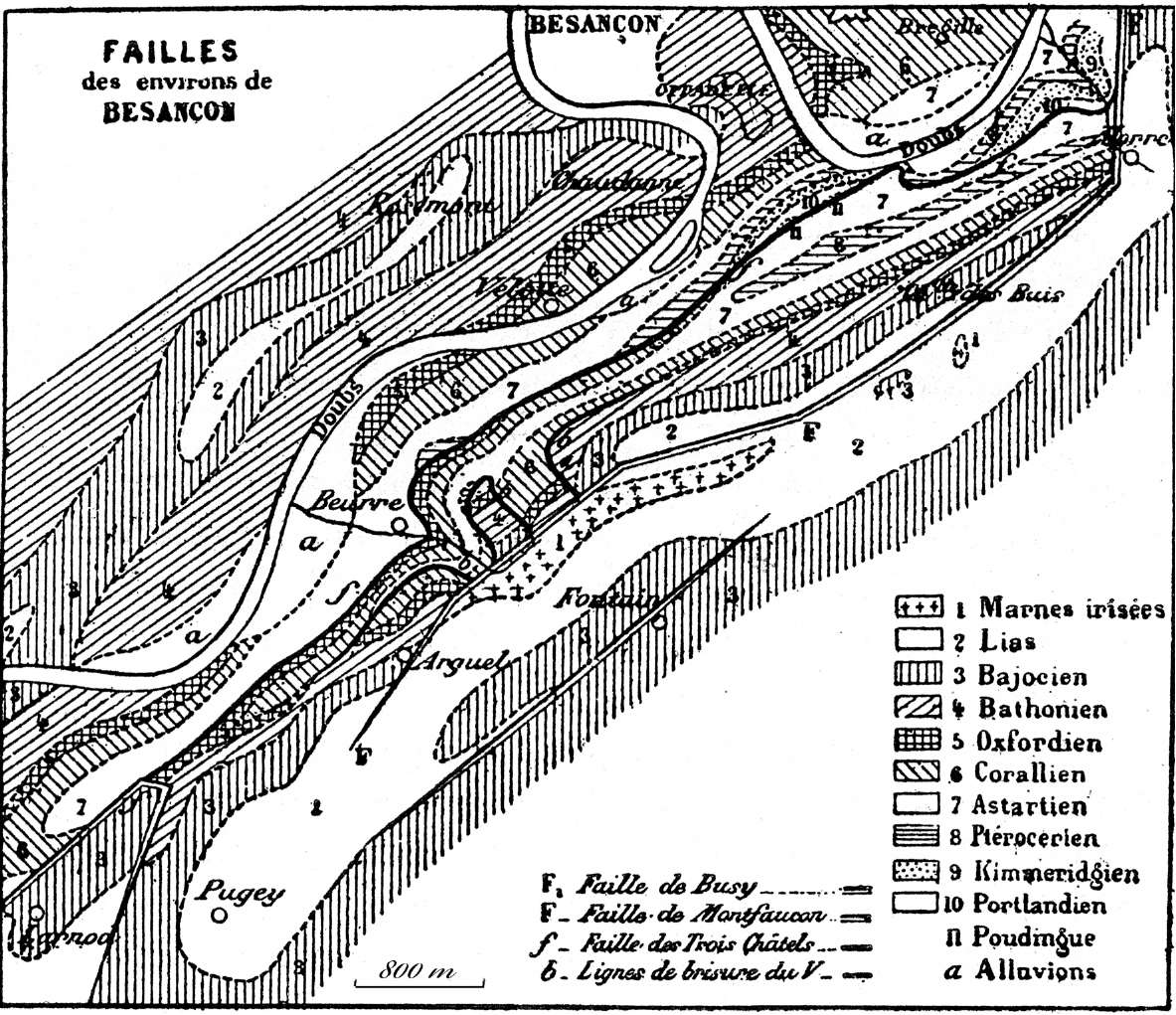
Fig. 2. Failles des environs de Besançon [Extrait de M. Bertrand, 1881].
Des failles plus ou moins horizontales (Bertrand, 1881), de tracé en plan à courbure variable, sont décrites à la lisière ouest de la chaîne (Fig. 2 et 3). Ces chevauchements à déplacement hectométrique vers le nord-ouest amènent des « terrains plus anciens » à être « poussés et charriés sur les terrains plus récents ». Dans sa Notice de 1894, il écrira qu'en dépit de leur faible amplitude, ces chevauchements « appelaient pour la première fois en France l'attention sur un phénomène dont j'ai reconnu depuis la généralité ». Ce travail de jeunesse semble oublier les propositions qu'en 1860 Charles Lory avait émises lors d'une Réunion extraordinaire de la Société géologique à Besançon : il parlait « d'accidents stratigraphiques [= tectoniques] compliqués » (« superpositions anormales », « renversements », « replis en superposition renversée »), dus à « quelque mode particulier de dislocation ». C'est Bertrand qui expliquera ce type de phénomènes. En attendant, quand ce dernier fera à Paris en 1881 son exposé sur « les failles de la lisière du Jura », Lory, qui y assistait, loin de chercher une priorité sur le sujet, se bornera à des remarques faisant appel à des « failles diversement orientées » ou à des « écroulements » de « tête de faille », ce qui est très en retrait sur ses termes de 1860.
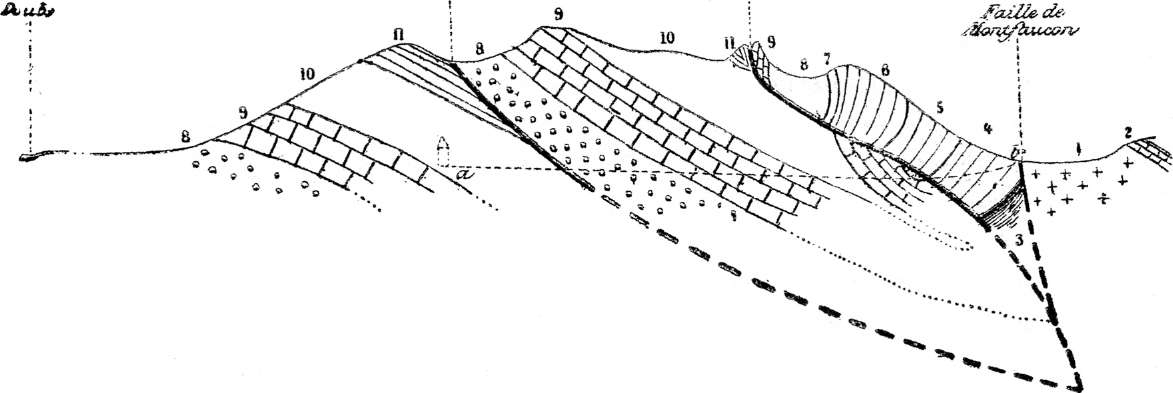
Fig. 3. Coupe entre le Doubs et la faille de Montfaucon, près de Beure (Doubs) [Extrait de M. Bertrand, 1881]. 1 : Trias (marnes irisées) ; 2-3 : « Infralias »-Lias ; 4 à 7 : Bajocien à Callovien ; 8 à 10 : Oxfordien (s.l.) ; 11 : « Ptérocérien ».
Si, près de Besançon, ces structures singulières - que Bertrand présentera le 21 août 1885 à la Société géologique, lors d'une Réunion extraordinaire - ont été retrouvées et précisées dans de nombreux travaux au milieu du XXe siècle, l'extraordinaire faille plate aux contours extrêmement sinueux qu'il dessina aux environs de Salins (Mont Poupet) a été critiquée, déjà par Émilien Bourgeat en 1908, et a fait l'objet de nouvelles interprétations, par André Caire en particulier.
D'étroits « bassins d'affaissement » (Bertrand, 1884), limités par deux failles parallèles et proches, se rejoignant longitudinalement, sont cartographiées spécialement entre Lons-le-Saunier et Arbois (Fig. 4). Ces « bassins » sont occupés par des assises relativement jeunes, effondrées au milieu de calcaires plus anciens, restés tabulaires. Bertrand l'expliquera par le remplissage d'un vide résultant d'une dissolution par les eaux souterraines, en somme une sorte de soutirage. Personne n'a repris cette explication, ni celle (Bourgeat, 1898 et 1911) d'un synclinal déformé, flanc inverse d'un pli couché. On a parlé de phénomènes distensifs, avec écartement des blocs d'une « crevasse », avec chute des terrains supérieurs (Choffat, 1885). Quant à Louis Glangeaud (1945), il a proposé l'idée d'un serrage transversal ultérieur de ces « pincées », certains auteurs (Pierre Chauve, 1974) y ajoutant la proposition de coulissements longitudinaux.
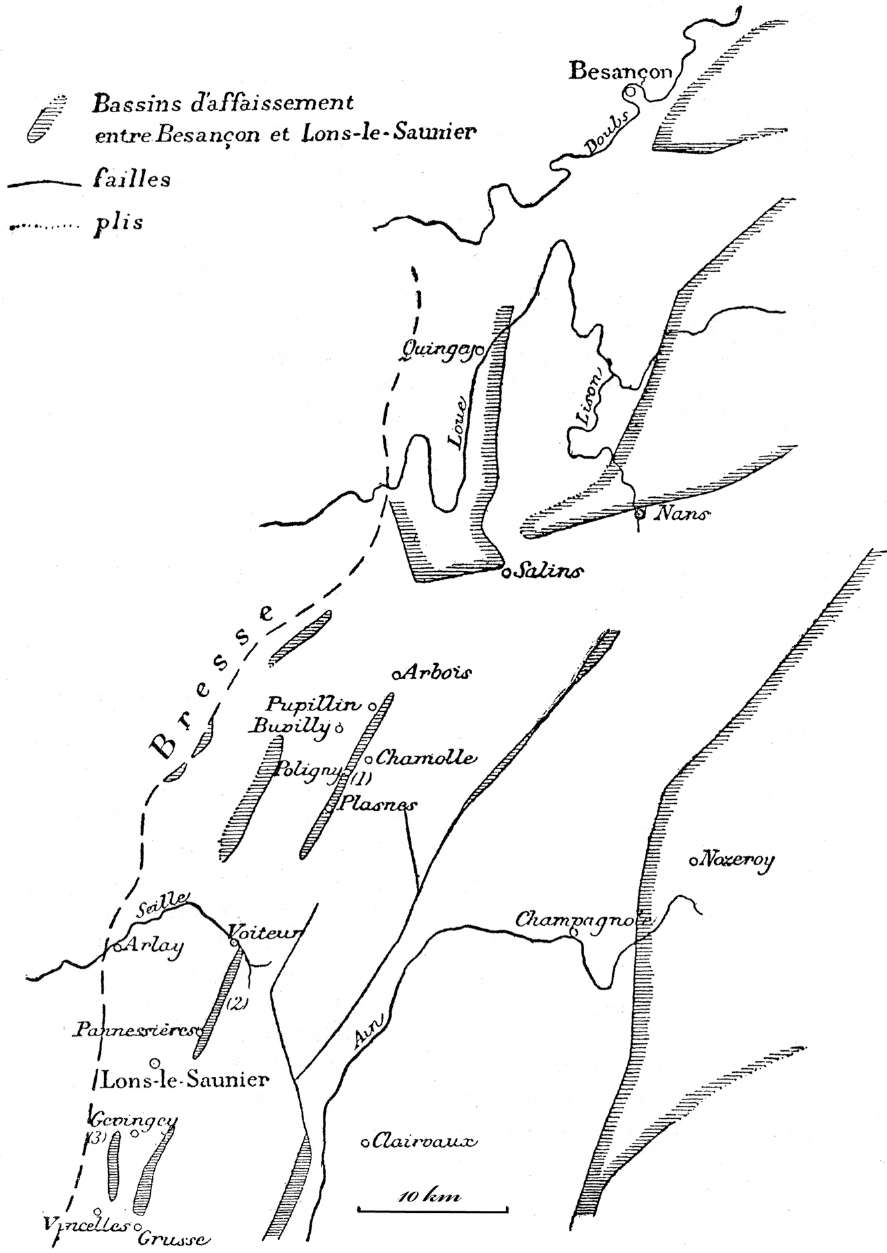
Fig. 4. Bassins « d'affaissement » entre Besançon et Lons-le-Saunier [Extrait de M. Bertrand, 1884b].
Des « failles à déplacement horizontal » recoupent les plis de la Haute chaîne jurassienne. Elles seraient « le résultat d'une torsion correspondant à un déplacement inégal, dans le sens horizontal, de couches plissées ». Bertrand citera la célèbre « faille transversale » de Pontarlier - que Jaccard (1869) connaissait déjà - dans la notice de la feuille de ce nom. Il montrera à la Société géologique l'accident similaire de Morez. Rappelant le terme minier allemand de « Blatt », que Suess avait utilisé pour de telles fractures, il souhaita qu'un nom français (ce seront bientôt les « décrochements » de Jaccard) leur soit affecté.
La lecture des brèves notices explicatives des feuilles que Marcel Bertrand a levées dans le Jura témoigne de la connaissance qu'il avait du faciès et des âges des formations, spécialement du Jurassique. L'un des problèmes qui subsistaient concernait le Jurassique supérieur : à partir de 1870, « presque tout ce que la France et l'étranger comptaient de géologues éminents prirent part au débat » sur les formations coralligènes du Jura (Bourgeat, 1887). Rappelons que la nomenclature utilisée alors comportait, au-dessus de l'Oxfordien (s.s.) : le « Corallien » et l' « Astartien » (équivalents plus élevés de l'Oxfordien au sens actuel), puis le « Ptérocérien » et le « Virgulien » (termes successifs de l'actuel Kimmeridgien), enfin le Portlandien [= Tithonien]. Les faciès coralligènes - en fait des récifs démantelés de polypiers inclus dans des calcaires oolithiques ou environnés par ceux-ci - étaient souvent regroupés dans une prétendu « étage Corallien ». Or, retrouvant et développant les conclusions de Paul Choffat (1876), Bertrand établira que ce faciès est hétérochrone.
Dans une importante publication à la Société géologique, présentée le 15 janvier 1883, il distingue trois niveaux coralligènes, de bas en haut : l'« oolithe corallienne » (il conserve ce nom), l'« oolithe astartienne », l'« oolithe virgulienne ». Il examine secteur par secteur, en allant du nord-ouest vers le sud-est, les diverses coupes qu'il a observées et utilise les nombreux travaux antérieurs d'Étallon, Ogérien et Choffat, en citant les fossiles significatifs des divers niveaux. Ainsi constate-t-il qu'en allant vers le sud-est, le faciès coralligène monte de plus en plus dans la série. Si l'oolithe « corallienne » se suit du Bassin de Paris jusqu'au Jura médian, l'oolithe « virgulienne » apparaît là pour se développer, seule, dans le Jura méridional de Saint-Claude, pouvant même - selon Bertrand - y atteindre la base du Portlandien.
De Cambridge (Massachussets) où il s'est installé, Marcou, qui a généralement la dent si dure, écrit à Dollfus le 14 mai 1883 qu'il vient de lire le texte de Bertrand, le qualifiant de « très bon ! », et lui demandant d'en féliciter l'auteur.
Bourgeat a écrit que, l'été 1881, il avait fait avec Bertrand « quelques excursions en montagne ». Or, cette année-là, ce dernier avait étendu ses levers sur la feuille Lons-le-Saunier. Comme nous savons qu'à cette époque, il devait étudier avec Abel Girardot les environs de Clairvaux-en-Joux, c'est peut-être là que l'abbé les accompagna alors qu'ils levaient la coupe « de Menetrux à la Fromagerie » (Bourgeat, 1883).
Nous ignorons dans quelles circonstances et à quel moment l'abbé décida (« l'idée me vint », a-t-il écrit) de s'occuper pour sa thèse des formations coralligènes jurassiques du Jura méridional. Le 21 novembre 1881, il est admis à la Société géologique, présenté par Albert de Lapparent - « mineur » devenu professeur à l'Institut catholique de Paris - et par Marcel Bertrand, alors premier secrétaire de la Société. En 1882 probablement - écrit-il - il va parler de sa thèse au professeur Hébert, grand maître de la géologie et doyen de la faculté des sciences de Paris, qui l'encourage « à publier ses observations ». Il est vraisemblable qu'il ait parlé de son projet à Marcel Bertrand, projet auquel il va consacrer ses vacances d'été, de 1882 à 1885.
Un « conflit d'intérêts » était inévitable entre les deux hommes, de la même génération. Tous deux n'étaient devenus géologues que depuis peu d'années. Pour de simples besoins de carrière, ils devaient faire leurs preuves par des publications : Bertrand ne voulait certainement pas rester un simple leveur de contours géologiques et l'abbé désirait devenir professeur titulaire de son université. Il n'est sans doute pas innocent que Marcel ait écrit dans l'introduction de sa note de janvier 1883 : « Les études que je poursuis depuis cinq ans pour l'établissement de la carte géologique du Jura » (sous-entendu tout entier !). Quant à Bourgeat, il était né et avait passé son enfance à Valfin, au centre du territoire qu'il avait décidé d'étudier. Il avait le sentiment d'être « chez lui ».
En tout cas, pendant l'été 1882, accompagné par le jeune Wilfrid Kilian - futur maître de la géologie grenobloise - Bertrand étudie la région de Saint-Claude. L'abbé y travaille de son côté et - à l'en croire (Bourgeat, Mémoires, 2002) - il lui aurait fait part de ses conclusions sur la répartition des faciès « coralliens ». Sur le secteur particulier de Valfin - site célèbre - les deux hommes avaient une opinion différente : pour Bourgeat, qui retrouvait l'ancienne opinion de Choffat, le faciès coralligène était d'âge ptérocérien [Kimmeridgien inférieur], alors que Bertrand voulait qu'il soit essentiellement virgulien [Kimmeridgien supérieur]. « En novembre 1882 », Bourgeat envoya à la Société scientifique de Bruxelles un texte (qui paraîtra en 1883) sur « La position vraie du corallien de Valfin dans le Jura », ce qui postule qu'elle était contestée (par Bertrand) et qu'il le savait. L'abbé indique, dans son texte, que le projet de son étude est « de démontrer l'exactitude des idées du Suisse Paul Choffat, lequel estime qu'il existe dans l'Est [du Jura] plusieurs niveaux coralliens superposés et que les bancs de polypiers se situent de plus en plus haut dans la stratigraphie en allant des Vosges vers les Alpes. Il s'agirait de dater avec précision le Corallien de Valfin qu'il estime ptérocérien. »
C'est le 15 janvier 1883, de son côté, que Marcel Bertrand présente sa grande note sur « Le Jurassique supérieur et ses niveaux coralligènes entre Gray et Saint-Claude ». Si ce texte intéresse tout le Jura, une dizaine de pages concernent les « couches célèbres de Valfin » et les environs de Saint-Claude. Il cite l'aide reçue de Kilian, de Girardot et de Guirand, sans aucune mention de l'abbé Bourgeat. L'auteur ne semble pas savoir que celui-ci avait, deux mois plus tôt, envoyé son texte sur Valfin à Bruxelles. La méfiance entre les deux hommes est assurée. Le fascicule du Bulletin de la Société géologique dans lequel la note de Bertrand figurait fut imprimé rapidement (c'était la règle à l'époque) et diffusé aussitôt aux membres de la Société, dont l'abbé faisait partie.
Écoutons celui-ci : « J'étais sur le point d'envoyer à la Société géologique un certain nombre de coupes de formations du Jurassique supérieur, quand [...] arriva le travail de M. Bertrand [qui] me déconcerta un peu ; car [...] j'y retrouvais les principales conclusions qui ressortent des études que je poursuivais depuis quatre ans [sic] sur le Haut-Jura ».
L'abbé sollicite un peu les dates car cela signifierait qu'il avait engagé son étude dès 1879 dans la région de Saint-Claude. Or le sujet de thèse n'a pas pu être fixé avant l'été 1881.
L'abbé continue : « J'en écrivis donc à M. Bertrand, et c'est à la suite d'une très aimable invitation de sa part que je me suis déterminé à communiquer ces coupes » (Bourgeat, 1883) sur les environs de Saint-Claude. Dans ses Mémoires, l'abbé est plus cru à l'égard de Bertrand : « au lieu de l'accuser de m'avoir dépouillé de mon bien [sic], je louai beaucoup son travail dans une note que je lui communiquai au préalable [...]. Ce procédé lui plut, il me laissa le champ libre, car Bertrand ne pouvait pas me répondre [sic]. » Effectivement, en 1883 (année d'une grave maladie) et 1884 (travaux sur Glaris et la Provence), Marcel Bertrand semble avoir jeté l'éponge dans le Jura. En réalité, il n'avait pas renoncé à ses idées sur l'âge « virgulien » des couches de Valfin, que Bourgeat jugeait « ptérocériennes ».
Devenu vice-président de la Société, Bertrand obtient que cette Réunion soit consacrée au Jura, pendant l'été 1885. Elle va rassembler près de 80 participants, parmi lesquels le président annuel (Ernest Mallard) et plusieurs grands maîtres de la géologie, comme Charles Lory et Jules Gosselet, ou encore Paul Choffat. Lors de la séance inaugurale à Champagnole, Bertrand est élu logiquement président de la réunion. Bourgeat en sera, évidemment avec l'accord, -voire la proposition - de Bertrand, secrétaire.
Les séances de la Réunion extraordinaire tenues entre les courses sont pour Marcel Bertrand l'occasion de célébrer les mérites de géologues jurassiens avec lesquels il a d'excellents rapports. Le très vieil inspecteur général des Pont-et-Chaussées Parandier, qui avait été « ingénieur ordinaire » à Besançon entre 1828 et 1845, est venu à la séance inaugurale : il avait confié à son jeune camarade Bertrand « toutes ses notes, cartes et coupes », documents « qui devraient placer son nom, avant ceux de Thurmann et de Thirria, en tête des fondateurs de la géologie du Jura ». C'est aussi Abel Girardot, professeur au lycée de Lons-le-Saunier, qui est venu représenter la Société d'Émulation du Jura. C'est également le modeste Edmond Guirand (1812-1887) qui rassemble depuis cinquante ans une remarquable collection paléontologique. Par contre, un silence total entoure le nom du doyen Alexandre Vézian, titulaire de la chaire de géologie à Besançon : son absence tient sans doute au fait qu'il est en délicatesse avec la Société géologique !
Il semble que, dès le début de la Réunion - alors que l'on était dans le Jura central -l'abbé Bourgeat ait voulu persuader l'auditoire de ses conceptions dans les problèmes du Jura méridional, oralement et par la distribution de textes justificatifs. Dans ses Mémoires, il dit avoir compté sur l'appui de Paul Choffat, maître respecté, mais celui-ci « se rangea presque complètement aux idées de Bertrand ». Il y aurait eu, écrit l'abbé, « un tollé général contre moi ! ».
À la lecture du compte-rendu, on se rend compte du combat à fleurets mouchetés entre Bertrand et Bourgeat, qui semblent prendre plaisir à s'opposer sur divers points de détail de l'itinéraire ! On arrive enfin à Valfin. Dans le compte-rendu qu'il a rédigé de la journée du 26 août, Bertrand rappelle la raison de cette visite : « Les observations de M. l'abbé Bourgeat, plus complètes et plus détaillées que les miennes, l'ont amené à l'ancienne opinion de M. Choffat, ce sont elles que la Société avait à vérifier. »
À la fin de la journée, Marcel Bertrand reconnaît que les couches du ravin [de Valfin] sont à classer, les supérieures comme les inférieures, dans le Ptérocérien. « L'intérêt qui s'attache à cette rectification très locale [sic] ne doit pas nous faire oublier le résultat d'ensemble que la course d'aujourd'hui, jointe aux précédentes, devait mettre en lumière : c'est qu'en approchant de Saint-Claude, le faciès coralligène s'intercale dans le Ptérocérien, et y monte près de Valfin jusque dans les assises où apparaît l'« Exogyra virgula » [l'espèce-type du « Virgulien »]. » L'abbé Bourgeat écrit (2002, Mémoires), satisfait : « Il fut constaté que j'avais raison, les procès-verbaux firent foi de mon triomphe [sic] ».
Peut-être cependant, en lisant la thèse de l'abbé, fut-il offusqué - mais c'était « la réponse du berger à la bergère » - de lire : « MM. Choffat et Bertrand purent par de patientes études jeter un peu de lumière [sic] sur la question » des formations coralligènes. En tout cas, dans le texte explicatif du panneau présentant le Jura à l'Exposition internationale de 1889 à Paris, si Bertrand fait état de la migration de ces formations vers le sud-est, aucun nom n'est prononcé comme responsable de la découverte. Et, dans la Notice de 1894 pour sa candidature à l'Académie, il écrit : « En prenant pour point de départ les travaux de M. Choffat [...] j'ai pu constater que, pendant la période Jurassique, les constructions de Polypiers ont reculé progressivement, du bassin de Paris vers le Sud, pour se concentrer, à la fin de la période, sur les bords de la mer alpine [...]. Sauf pour le gisement de Valfin que j'avais un peu trop rajeuni, ces conclusions ont été confirmées par la Société géologique, que j'ai conduite dans le Jura en 1884 » : le nom de l'abbé Bourgeat n'est pas prononcé.
On ignore si, après la thèse de l'abbé, les deux hommes ont conservé des rapports, Bertrand ayant changé de région d'étude. Les sentiments qu'a éprouvés Bourgeat, devenu chanoine, à l'égard de celui dont il apprenait la carrière éblouissante, sont contrastés. Dans ses Mémoires, il loue la « simplicité » de « ce grand savant », dont il avait partagé la « vie au grand air [...] des plus fraternelles », et « sa grande modestie ». Cependant, fixé à Dole quand il prendra sa retraite en 1911, le chanoine va parcourir le Jura de Besançon à Lons-le-Saunier. Ainsi fut-il amené, après 1900, à publier dans les colonnes de la Société géologique toute une série de textes notant les erreurs locales, en particulier tectoniques, qu'avait pu commettre Bertrand dans ses premiers travaux. Il n'y eut pas de réponse, car celui-ci était entré dans sa nuit intellectuelle. Ces notes du chanoine Bourgeat témoignent de la sourde rancoeur que, issu d'une rude famille paysanne de la montagne, ayant dû lutter pour atteindre un statut de savant respecté, le sévère Émilien Bourgeat pouvait éprouver à l'égard d'un géologue à l'esprit moqueur, comblé par des dons exceptionnels qu'avait favorisés sa naissance dans la haute bourgeoisie intellectuelle parisienne.
De toute manière, la réputation du chanoine est faite. C'est à lui - et à lui seul - que les traités, d'abord le célèbre Traité de géologie de Haug puis celui de Maurice Gignoux, donneront le bénéfice de la démonstration du déplacement progressif vers le sud-est de la barrière récifale du Jurassique supérieur. Sa thèse avait mis un point final à un débat qui durait depuis plus d'un quart de siècle.
L'été 1911, le chanoine Bourgeat va connaître la consécration de sa vie scientifique en présidant une nouvelle Réunion extraordinaire de la Société géologique, cette fois dans le Jura septentrional. Le programme n'a pas d'objectifs bien définis. Les interprétations que Marcel Bertrand a proposées sur les « failles courbes » de Salins et sur les « bassins d'affaissement » sont l'objet de critiques, parfois justifiées. À la fin de la Réunion, le pacifique professeur Louis Collot, titulaire de la chaire de Dijon, clôt les débats : « Cette session évoque pour quelques-uns d'entre nous [Abel Girardot, comme lui, était là !] le souvenir de celle de 1895, dans le haut Jura, et celui de Marcel Bertrand, qui se fit depuis un grand nom dans la science. À côté de lui, M. Bourgeat nous fit constater des faits du plus haut intérêt, découverts par lui et vous connaissez sa belle synthèse de la progression des récifs du Jurassique supérieur vers le SE [...] tantôt rectifiant les observations de Marcel Bertrand, tantôt appliquant heureusement la conception des plis couchés de ce maître... ».
Aux yeux de certains, cette réunion de 1911 apparut comme un essai d'exécution postmortem de Bertrand. En effet, le compte-rendu de la Réunion est suivi d'un texte du général Jourdy (autre géologue jurassien à ses heures) qui n'avait pu y assister. Il tint à rappeler la « découverte des failles horizontales et des paquets d'affaissement » de Marcel Bertrand, ajoutant : « Il n'était réellement pas possible de traiter de géologie dans cette partie du Jura sans invoquer le nom glorieux de ce géologue qui a parcouru dans la tectonique une carrière si brillante et qui laisse derrière lui une école dont la réputation s'est affirmée dans l'Europe entière. »
Tentons de conclure sur l'oeuvre de Marcel Bertrand dans le Jura. Essentiellement cartographique, sa démarche est - malgré sa jeunesse - marquée par la tendance à l'explication synthétique, sans pour autant négliger les observations de détail, que l'on peut même parfois juger exagérées. Quant à sa querelle larvée avec l'abbé Bourgeat, elle dénote que Bertrand tenait à garder son antériorité dans l'affirmation de la migration des récifs du Jurassique supérieur vers le sud-est. Ceci n'a pas empêché qu'il reconnaisse publiquement et sans retard que, sur le site de Valfin, l'abbé Bourgeat avait raison. Victoire picrocholine d'ailleurs, dans un débat où les deux hommes avaient abouti - après Choffat - aux mêmes conclusions d'ensemble.
Revenons en arrière. Au début de 1878, Marcel Bertrand quitte Vesoul et regagne la capitale. Il s'installe dans le « noble faubourg », au 29 de la rue Saint-Guillaume (7e), ses parents habitant à deux pas, rue de Tournon (6e). Il peut gagner à pied l'École des mines où le « Service de la Carte géologique détaillée de la France » occupe quelques pièces dans une annexe de l'École.
Le directeur, Eugène Jacquot (1807-1903), est alors au faîte de sa carrière. À la mort d'Élie de Beaumont en 1874, il a pris les rênes d'un organisme où quelques rares ingénieurs des Mines ont la charge d'étudier chacun une grande région, comportant de nombreuses coupures à cartographier : c'est ainsi qu'à son arrivée, Marcel héritera des feuilles de Franche-Comté. Il trouve au Service quelques camarades plus âgés que lui, géologues confirmés, eux, alors qu'il n'est qu'un débutant dans la discipline. Certains n'y sont plus que pour peu de temps. Edmond Fuchs (1837-1889) va devenir l'année suivante professeur de géologie technique à l'École des mines. Et en décembre 1880, le ministre Sadi Carnot va mettre Albert de Lapparent (1839-1908) en demeure de démissionner du Corps des mines s'il veut continuer son enseignement de géologie à l'Institut catholique de Paris, ce qu'il choisira.
Ayant cohabité avec les deux précédents pendant à peine un an, Marcel va donc se trouver en face d'Auguste Michel-Lévy (1844-1911), dont le rôle est déterminant car, depuis 1876, il est adjoint du directeur, qu'il supplée souvent, inévitablement. Il s'occupe lui-même des feuilles du Massif Central, du fait de ses éminentes qualités de pétrographe. En 1887, il remplacera logiquement Jacquot, qui prend sa retraite. Michel-Lévy, selon Louis de Launay, était « un caractère » dont l'autorité, incontestée, était servie par une belle prestance et un verbe direct. Les « sentiments sincèrement dévoués » par lesquels s'achève une lettre que Marcel lui adresse en 1884 semblent indiquer que le « cadet » - dont l'étoile monte - a d'autres sentiments que l'amitié pour un « camarade » un peu plus âgé, qu'il doit fréquenter quotidiennement depuis cinq ans. Plus tard, leur rivalité pour le poste de professeur de géologie (1885) à l'École des mines, puis à l'Institut (1895-1896) ayant disparu, leurs relations devinrent bonnes.
Les rapports sont manifestement meilleurs avec Alfred Potier (1840-1905), qui va rester le dernier des trois ingénieurs recrutés dès 1865 par Élie de Beaumont et définitivement nommés en 1868. Comme la plupart de ses camarades, Potier a été fasciné par le système de son maître, dont il fera un vibrant éloge mortuaire. De 1877 à 1883, il sera adjoint à la direction, au titre des « topographies souterraines » (houillères spécialement). Il a également la charge de lever quatorze feuilles au 80 000e du centre et du nord du Bassin Parisien. Potier joua aussi un rôle important dans la préparation du rapport sur le projet de tunnel sous la Manche, en 18751876, projet qui fut sans suite, les insulaires ne voulant pas perdre leur « splendide isolement ». « Travailleur silencieux et ennemi de la réclame » (Lapparent, 1906), Potier fut premier vice-président de la Société géologique en 1884, mais il s'effaça l'année suivante devant le 4e vice-président, Ernest Mallard (1833-1894), son aîné, professeur de minéralogie à l'École, ce qui dut faciliter sa propre nomination, en 1893, dans un poste de professeur d'électricité industrielle ! Ce fidèle géologue était surtout un physicien éminent, que l'Académie des sciences accueillit à ce titre en 1891.
Attiré par les Alpes - au titre de détente intellectuelle - Potier s'intéressa d'abord au comté de Nice, récemment annexé, puis à la Maurienne et à la Tarentaise, collaborant avec Marcel Bertrand lors des levers de celui-ci sur Albertville et Saint-Jean-de-Maurienne.
Quant aux rapports de Marcel avec son directeur, ils doivent s'être vite rassérénés. En juin 1885, probablement à la suite d'une course commune, les deux hommes annoncent la découverte d'« ophites » (il doit s'agir de roches de type lamprophyrique) dans le Crétacé pyrénéen, entre Pau et la vallée d'Ossau. Le sévère Lorrain qu'était Jacquot ne pouvait pas ne pas être sensible à l'efficace gentillesse de son collaborateur.
Béguyer de Chancourtois (1820-1886), disciple inconditionnel d'Élie de Beaumont et de son « dodécaèdre pentagonal », occupe depuis 1874 la chaire de Géologie de son maître disparu. « Vieilli et malade » (Termier, 1908), il demande à Marcel Bertrand de le remplacer.

Fig. 5. Marcel Bertrand, professeur à l'École des mines vers 1890 [Cliché bibliothèque de l'École nationale supérieure des mines, Paris].
Celui-ci est intéressé par l'offre mais il ne veut pas que cela se fasse subrepticement car il pense que son camarade et « aîné » Michel-Lévy peut être logiquement sur les rangs. Après avoir tenté en vain de le voir (Michel-Lévy est parti), il lui écrit pour l'aviser des événements (lettre du 6 septembre 1884 : Arch. Acad. Sci., dossier M. Bertrand) : « [...] je suis allé chez lui [M. de Chancourtois] ce matin, et il m'a déclaré qu'il désirait ne pas continuer son cours, ou au moins se faire aider, autrement dit suppléer. J'ai répondu que je ne pouvais accepter d'offre dans ce sens et qu'en dehors de considération à moi personnelle, je n'accepterais de candidature que nettement et ouvertement posée entre vous et moi en me soumettant au choix du conseil de l'Ecole (qui d'ailleurs n'accepterait évidemment pas d'autre solution). [...] M. de Chancourtois m'a dit alors qu'il serait disposé à demander au Conseil de nommer un professeur adjoint, lui se contentant du titre de professeur honoraire, et même au besoin, mais sans rien encore affirmer à cet égard, à donner sa démission. La dernière chose est encore à l'état d'hypothèse un peu vague ; mais la première semble sérieuse et équivaudrait à une vacance de la place [...] ».
Nous connaissons la réaction de Michel-Lévy qui, le lendemain (lettre du 7/9/1884, Arch. Acad. Sci., dossier Michel-Lévy), écrit à Fouqué, son ancien « patron » : « En revenant de Paris, je trouve ici la lettre ci-jointe de Bertrand, que je vous prie de me renvoyer [ce qui fut fait !] : donnez-moi des conseils sur cette situation nouvelle : professeur suppléant, professeur adjoint, c'est tout un et M. de Chancourtois me paraît désormais devoir peser singulièrement sur le choix de son successeur. Or vous connaissez ses sentiments à mon égard [ils sont réciproques ! une lettre de Michel-Lévy de 1881 cible « les Chancourtois et tous les animaux venimeux » !], j'allais dire à notre égard ». En énumérant les membres du Conseil de l'École des mines qui devront en décider, il demande à Fouqué de s'informer de la position de certains : « je serais désireux de connaître leur opinion, car il m'est pénible de m'exposer à un échec dans les conditions que vous savez ». Il poursuit : « Je n'ai d'ailleurs fait aucune visite et je suis, à ce point de vue, fort distancé par Bertrand et son père ». On notera que, entre le 6 et le 7 septembre, de telles visites leur auraient été difficiles !
Le 21 septembre, Michel-Lévy répond à Fouqué, qui s'était informé : « Je ne me fais pas de grandes illusions ; on reconnaîtra mes titres, on me déclarera propre à un cours de pétrographie qui n'existe pas, et on me sacrifiera à mon compétiteur [= Bertrand], sans tenir compte de ce fait que je ferais certes plus facilement un cours de stratigraphie que, lui, un cours de pétrographie. Néanmoins je ne prendrai une décision formelle qu'à mon retour à Paris, après avoir vu M. Lan [Charles Lan = le professeur de métallurgie, directeur de l'École] et M. Gouray, Directeur du personnel au Ministère des travaux Publics ».
En fait, Marcel paraît s'être trouvé seul candidat (Michel-Lévy devant guigner la prochaine succession de Jacquot à la tête du Service de la Carte géologique), et il sera nommé « professeur suppléant » le 27 mai 1885. Chancourtois s'éteignant à la fin de l'année, Marcel Bertrand deviendra, en janvier 1886, le deuxième successeur d'Élie de Beaumont dans la chaire de géologie de l'École des mines de Paris, l'arrêté de nomination ne paraissant que le 27 décembre suivant.
La carrière de Marcel dans le Corps des mines se déroulait parallèlement : ingénieur ordinaire de 1re classe le 29 juillet 1882, il fut promu ingénieur en chef de 2e classe le 26 mai 1888, atteignant la 1re classe du grade le 21 juin 1895.
Pierre Termier (1908) nous dit que, par l'universalité de ses connaissances et son goût pour les idées générales, Marcel Bertrand « ne pouvait manquer d'être un admirable professeur. C'est ce qu'il fut, en effet, dans ses bonnes années, de 1886 à 1899. Son cours vivait d'une façon extraordinaire. Il le modifiait sans cesse et ne craignait pas d'y parler, tout au moins brièvement, des questions les plus controversées et des plus récentes découvertes... ».
Marcel Bertrand dirigeait également de grandes tournées avec ses élèves. Ainsi, en mai 1895, va-t-il, avec vingt d'entre eux, effectuer une « course en Dauphiné », avec Joseph Révil à Chambéry puis avec Wilfrid Kilian autour de Grenoble, tout cela à pied ou en voiture à cheval, à partir des gares de chemin de fer.
Il sut se choisir un excellent collaborateur, qui aura la responsabilité essentielle du contact quotidien avec les élèves ingénieurs : Lucien Cayeux (1864-1944), jusque-là préparateur de Gosselet à la faculté des sciences de Lille, désireux de faire carrière à Paris, accepte l'offre que Bertrand lui fait en 1891, à la Réunion extraordinaire en Provence. Cayeux ne sait pas encore qu'il suppléera (1904-1907) puis remplacera son maître, que la maladie puis la mort vont atteindre. L'entente des deux hommes fut parfaite. On sait que Cayeux deviendra professeur au Collège de France et un jour académicien.
Marcel Bertrand dut également apprécier le voisinage de Pierre Termier, jusque-là professeur à Saint-Étienne, qui obtint en 1894 la chaire de minéralogie de l'École. Depuis 1890, les deux hommes collaboraient dans les Alpes.
La seule récompense qu'a ambitionnée Marcel Bertrand a été, selon Pierre Termier (1908), d'entrer à l'Académie des sciences, à l'image de tant de membres de sa famille !
Il avait depuis longtemps retenu l'attention des géologues de cette compagnie, étant par exemple choisi, début 1885, pour faire partie des membres de la « Mission d'Andalousie » organisée par l'Académie, un prix Vaillant collectif devant en récompenser les résultats. Cinq ans plus tard, est mis au concours un sujet pour une nouvelle attribution du même prix Vaillant, doté de 4 000 francs [environ 15 000 euros]. Le thème semble en avoir été défini pour Marcel, car il y eut une seule réponse,. la sienne (« Étude sur les refoulements... »). Daubrée, dans un consciencieux rapport, résume les conclusions de l'ouvrage (voir plus loin) qui concerne « quelques-uns des problèmes les plus ardus de la géologie alpine ». Comme on le sait, ce texte devait être imprimé dans les Mémoires de l'Académie (Savants étrangers), mais l'auteur, insatisfait, obtint qu'il lui soit restitué « pour le corriger ». Termier (1908) écrit que le temps passa, jusqu'à ce que, après la mort de Marcel Bertrand, son ami Emmanuel de Margerie révise « ces pages poussiéreuses à l'encre déjà jaunie », dont le manuscrit original semble avoir disparu.
En 1893, l'Académie distingue à nouveau Marcel par l'attribution du prix Petit d'Ormoy de Sciences naturelles, doté de la considérable somme de 10 000 francs (près de 40 000 euros d'aujourd'hui). Daubrée, encore une fois rapporteur, précise que ce prix récompense deux mémoires traitant des plissements dans les bassins de Paris et de Londres, l'auteur tentant d'en tirer des lois générales sur la déformation de l'écorce terrestre. Nous y reviendrons.
En 1894, Marcel, qui a 47 ans, vise à entrer à l'Académie. Le décès du minéralogiste Ernest Mallard, lui aussi professeur à l'École des mines, est l'occasion de poser candidature pour le trio Bertrand, de Lapparent et Michel-Lévy, amis mais concurrents ! Le doyen de la section, le vieux Daubrée, sans souci de choquer ses jeunes camarades « mineurs », va chercher - son choix est déterminant - ailleurs. Une lettre de Michel-Lévy à son maître Fouqué (académicien, en vacances à Pornic) expose la situation (lettre du 29/7/1894, Arch. Acad. Sci., 1 J-22-2) : « J'ai fait fort peu de visites et je n'en sais pas plus long que vous : cependant M. Daubrée paraît disposé à mettre en 1ère ligne M. Hautefeuille [le professeur de minéralogie de la Sorbonne], et à Marcel Bertrand et à moi il a fait l'éloge de Lapparent. D'autre part Bertrand d'abord découragé, fait front et cherche des voix ; de Lapparent aussi. Mes amis m'ont conseillé de me présenter ; de recueillir autant de voix que possible au premier tour ; de préparer l'avenir [...]. D'aucuns disent que B. n'aura que 14 voix, eu égard à l'hostilité maintenant peu déguisée de Daubrée [...]. Voilà tous les cancans que je sais ; joignez-y une tenue cordiale de Marcel Bertrand avec lequel je vous demande instamment de ne pas me brouiller, car il paraît avoir senti le danger du 3ème larron [c'est de lui qu'il doit vouloir parler !] et la sottise de la petite guerre à la pétrographie » [Marcel était moqueur !]. On retire de cette lettre que Michel-Lévy est disposé à attendre son tour après Marcel. En fait, le 14 janvier 1895, Hautefeuille, qui était seul placé en 1re ligne, l'emporta aisément (38 voix), Marcel (9 voix) précédant Lapparent (5 voix), Michel-Lévy (4 voix) et un outsider, Charles Barrois (une voix).
La tentative fut renouvelée un an plus tard, après le décès de Pasteur (on peut être surpris que celui-ci ait appartenu à la section de minéralogie). Le 6 janvier 1896, les quatre candidats « résiduels » du précédent scrutin étaient à nouveau sur les rangs, Bertrand et Michel-Lévy placés en 1e ligne, Charles Barrois et Albert de Lapparent en 2e. En assemblée plénière, Marcel Bertrand l'emporta aisément (47 voix sur 54 votants). Michel-Lévy (4 voix) et Lapparent (3 voix) devaient garder espoir cependant ! Marcel eut ainsi la satisfaction d'accueillir le premier à la fin de 1896, après la mort de Daubrée, le second (de Lapparent) en 1897, Barrois devant attendre 1904. On remarquera l'exceptionnelle qualité scientifique, à cette époque, des postulants possibles à l'Académie des sciences. L'élection de Marcel fut le fait d'une « section de minéralogie » (appellation datant de 1803 et qui dura jusqu'en 1955) avec : Auguste Daubrée, jouant le rôle de président, le volcanologue Ferdinand Fouqué, le paléontologiste Albert Gaudry, les minéralogistes Alfred des Cloizeaux et Paul Hautefeuille.
Marcel Bertrand prit place dès le 20 janvier. Son autorité était si reconnue qu'il fut amené, pour la seule année 1896, à présenter une dizaine de notes d'auteurs divers. Le registre de présences ne porte cependant sa signature qu'à partir du 9 novembre. Dès cette date, Marcel Bertrand se montra un membre assidu. Jusqu'au 15 avril 1900 (date de la mort de sa fille Jeanne, qui le déstabilisa), en un peu plus de quatre ans, il assista à 139 des 178 séances hebdomadaires.
Dès son arrivée à Paris, venant de Vesoul, Marcel Bertrand est inscrit à la Société. Il est proclamé membre le 4 mars 1878, présenté par ses camarades Henri Douvillé et René Zeiller, géologues confirmés, eux. On remarquera que, ni son nouveau directeur au Service de la Carte, ni ses anciens professeurs de l'École des mines, ne jouèrent ce rôle. Une petite année seulement s'écoule avant que le néophyte ne se retrouve au bureau de la Société qui est établie, depuis 1870, au numéro 7 de la rue des Grands-Augustins, étroit boyau sombre perpendiculaire à la rive gauche de la Seine, un peu en aval de la place Saint-Michel.
Vice-secrétaire en 1879-1880, Marcel remplace ensuite, comme « secrétaire pour la France », son ami Douvillé en 1881-1882. Une trace de son action subsiste, grâce aux lettres [Arch. Acad. Sci., Recueil Lacroix, 1-J-22-3] écrites de Cambridge (Mass.) à Gustave Dollfus par son vieil ami Jules Marcou, au sujet d'une carte d'Amérique du Nord dont la « commission du Bulletin » de la Société refusait l'impression en couleur : « En écrivant à M. Bertrand, j'ai demandé pourquoi on ne voulait pas mettre de couleurs ? Quel est ce M. Bertrand ? [...] Ce serait un gros regret de voir cette carte, sabrée avec des hachures. C'est le dernier travail pratique que je ferai jamais. Vous dites que c'est une question de gros sous : soit ! Je m'engage à donner 100 francs à la Société dans ce but » (lettre du 8 janvier 1881). Les choses s'arrangèrent, probablement par l'action de Marcel, sensible à la personnalité de l'ancien Jurassien. Le 20 janvier, nouvelle lettre de Marcou : « Comme vous l'avez prédit, la commission du Bulletin est revenue sur son vote et l'on imprimera ma carte en couleurs [...]. Je me suis douté que ce M. Bertrand était le fils du mathématicien. Je connais un peu son père, qui m'a en horreur depuis la publication de La Science en France » [un brûlot, fort bien venu, étrillant en particulier les moeurs académiques !].
Marcel Bertrand devint ensuite vice-président en 1883 et membre du Conseil en 18841885. En 1886, le départ à la chaire de géologie de Bordeaux d'Emmanuel Fallot, alors premier secrétaire, en passe d'occuper une vice-présidence, explique que Marcel y fut élu une deuxième fois, suivi à nouveau de deux ans comme conseiller, en 1887-1888.
La réputation de Marcel Bertrand fut fortifiée par la solution qu'il donna en mai 1887 à « l'énigme du Beausset » en Provence. On s'explique aisément qu'il devienne, le 20 juin 1889, le premier lauréat du Prix Fontannes, qui venait d'être fondé. pour la « stratigraphie » (terme qui englobait encore celui de « tectonique », en gestation !). Albert de Lapparent, le rapporteur du prix, salue en son camarade « l'initiateur des grands charriages dans les Alpes ».
La même année, Edmond Hébert, l'autoritaire professeur de la Sorbonne, est élu difficilement à la présidence de la Société géologique (85 voix sur 175 votants), Marcel Bertrand devenant son premier vice-président, et devant souvent remplacer le vieil homme à la présidence des séances. En 1890, ce fut par une « élection de Maréchal » (137 voix sur 158 suffrages) que Marcel Bertrand prend la tête de la Société. Mais comme, à l'époque, il met la dernière main à son Mémoire sur les refoulements..., son propre premier vice-président, Ernest Munier-Chalmas, doit le remplacer au cours de cinq séances. Cette année 1890 de présidence fut couronnée par la célèbre Réunion extraordinaire de Provence, où triomphèrent ses idées tectoniques. Marcel Bertrand deviendra ensuite, jusqu'en janvier 1901, membre du Conseil de la Société. Ainsi aura-t-il été, pendant treize ans, un pilier de l'association.
Comme à l'Académie des sciences, et d'après les registres de présence (Arch. Soc. géol. Fr.), Marcel Bertrand se sera montré un modèle de fidélité, non seulement aux réunions de bureau, mais aussi à celles des « Commissions du Bulletin » ou des « Mémoires » dont il fut un membre influent. On trouve sa trace dans certains documents. Le 14 janvier 1897 (Arch. Acad. Sci., Recueil Lacroix, 1-J-22-3), en réponse à Wilfrid Kilian, jeune professeur à la faculté de Grenoble, qui lui a écrit avoir reçu de Philippe Glangeaud, alors secrétaire de la Société, une lettre qui l'a indigné, Marcel calme son ami : il lui explique que Glangeaud est « de sa nature essentiellement maladroit et ne s'en doute pas ; il a la patte lourde et se croit la main légère ». On sait que Philippe Glangeaud eut un fils, Louis, qui marqua son passage à la Sorbonne après la Seconde Guerre mondiale.
Marcel Bertrand aimait la discussion et, en 1891, à la « séance générale » - présidée traditionnellement par le président de l'année précédente - il s'écrie, déplorant l'atonie ambiante : « La discussion à haute voix, pendant les séances et non après les séances, et le souci de vulgarisation des idées, le goût des querelles d'école, dirais-je presque, voilà, je crois, ce qui [nous] manque. » Cette déclaration va de pair avec la loyauté de son caractère. Le 19 décembre 1900, il assiste à une réunion du Conseil de la Société. Eugène Fournier, son féroce adversaire « anti-nappiste » de Provence, vient de déposer une longue note, où il s'oppose aux conclusions de Marcel. Celui-ci donne néanmoins un « avis favorable » à l'impression de ce travail, se bornant à appeler « l'attention du secrétaire sur certains passages [un peu vifs !] de cette note. »
Au cours de ces treize années, fidèle membre du bureau de la Société géologique, Marcel Bertrand a pris une part très active aux débats scientifiques en séance. Il présentera quelque 65 textes, et en particulier ceux qui rapportent ses découvertes essentielles. Si, à l'Académie des sciences, il signe aussi environ 25 notes, leur rythme ne s'en accélère pas après sa nomination d'académicien.
Ces Réunions, créées en 1835 à l'initiative d'Ami Boué et qui disparurent de facto à la fin du XXe siècle, étaient un remarquable lieu de discussion des découvertes récentes, quand la géologie se faisait sur des séries et des structures concrètes. Pendant 7 à 10 jours, des géologues de toutes les régions de la France et souvent de l'étranger, échangeaient leurs idées au vu de ce qui leur était présenté par les organisateurs. Marcel Bertrand en dirigea deux, qui obtinrent un très grand succès : dans le Jura (1885) et en Provence (1890), et il fut un élément moteur de la Réunion en Algérie (1896) dont on parlera plus loin.
De 1878 à 1896, il participa à 17 sur 19 de ces manifestations. La plupart des participants changeant d'une réunion à l'autre, Marcel Bertrand eut ainsi la possibilité de rencontrer physiquement la quasi-totalité du monde géologique français et beaucoup de ses voisins européens, ce qui explique que son caractère ouvert et aimable lui assure une popularité exceptionnelle. Lucien Cayeux (1908) rappela, à son décès, que Marcel Bertrand contribuait largement au succès de ces réunions, se montrant « aux excursions plein d'entrain et d'une humeur primesautière et gaie ». Jugeons-en sur quelques exemples, tirés des comptes-rendus de ces réunions.
En août 1879, dans le Morvan, Michel-Lévy est à l'honneur. Il rend compte de l'excursion à son patron Fouqué, ajoutant : « cette course a fait bonne impression sur les jeunes. Bertrand fils est du nombre. Vous ne trouverez plus un sceptique en lui, il a suivi son chemin de Damas » (Arch. Acad. Sci., dossier ac. Michel-Lévy, lettre du 5/9/1879).
En 1882, la Société se trouve à Saint-Girons, dans l'Ariège. Le dimanche 24 septembre, pendant que les « autorités » présentes sont réquisitionnées pour l'inauguration à Foix d'une statue de Lakanal, « les jeunes gens » gravissent le Pech de Foix, ce qui permet à Marcel de découvrir de minces « couches à Mytilus » (Dogger ?), jusque-là ignorées, entre Lias et dolomies du Jurassique supérieur... À Aurillac, en 1884, Bertrand manifeste une intense activité, ce qui doit attirer l'attention de Fouqué et de Michel-Lévy, présents à la Réunion (il sera recruté peu après pour la « Mission d'Andalousie » par Fouqué). Avec Louis Collot - le futur professeur de la faculté des sciences de Dijon, qu'il va retrouver en Provence - s'inaugure une longue amitié : les deux hommes décident d'escalader le Puy Mary - édifice important prévu au programme -, ce à quoi renonce le reste de la troupe, exténuée par la fatigue et la chaleur !
En 1890, Michel-Lévy dirige de Clermont-Ferrand au Mont-Dore la Réunion. Marcel exécute quelques passes d'armes parfois imprudentes avec ce pétrographe de haut niveau ! En 1892, Carez guide les participants de la Réunion dans les Corbières, avec escalade du célèbre Pic de Bugarach, premier exemple révélé d'un grand chevauchement dans les Pyrénées. Marcel Bertrand souligne l'identité apparente du Sénonien des Corbières et de Provence, le régime lacustre arrivant toutefois plus tôt en Provence, « conséquence naturelle de l'existence d'un golfe étroit ouvert sur l'Atlantique ». Et de proposer des équivalences : les « premières marnes rouges et brèches associées » = les « grès à reptiles » de Fuveau ; le « calcaire lithographique » = le calcaire de Rognac ; les argiles rouges supérieures « garumniennes » = les argiles de Vitrolles. Ainsi Bertrand extrapole-t-il judicieusement les conclusions de Collot sur le bassin d'Aix-en-Provence.
Si nous avons la certitude des rapports de confiance entre Joseph Bertrand et son fils aîné, nous ignorons si celui-ci joua un rôle particulier dans sa fratrie. Ses trois soeurs Gabrielle, Geneviève et Lucie se marièrent et on connaît leur descendance. Quant à ses deux jeunes frères, polytechniciens comme Marcel, l'un, Joseph (1854-1939) devint colonel d'artillerie, l'autre, Léon (1857-1951) terminant sa carrière comme ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, sans avoir, ni l'un ni l'autre, de descendance masculine.
À en juger par la durée de ses campagnes de terrain (« le tiers de l'année » à l'époque du Jura, selon Pierre Termier), par le volume - donc au temps nécessaire - de ses publications, par ses obligations statutaires à Paris et à ses engagements à la Société géologique puis à l'Institut, Marcel Bertrand ne devait guère avoir de loisirs. Le déroulement de sa vie, hors l'assistance - attestée par sa signature - à telle ou telle séance, est difficile à reconstituer. Un épisode est cependant connu : par une lettre de son père à Daubrée (Bibl. Inst. France, Man. 2421) - les deux hommes étaient liés - datée du « vendredi 31 mars » (1883 !), on apprend : « Marcel est plus que souffrant, il est gravement malade atteint d'une fièvre typhoïde au 15e jour [...] nous avons eu hier une journée meilleure mais il divague complètement [...] je ne quitte pas la chambre de Marcel ». Le 14 mai suivant, sans doute avisé par Gustave Dollfus, Jules Marcou (Arch. Acad. Sci., Recueil Lacroix, 1-J-22-3) écrit à ce dernier : « Je souhaite que Marcel Bertrand se guérisse de sa grave maladie ». On constate effectivement que, de février à novembre 1883, Marcel Bertrand ne paraît plus aux réunions du bureau de la Société géologique, dont il était alors vice-président.
On doit tenter de marier le charmant Marcel, qui, ayant échappé aux éventualités vésuliennes, approche de la quarantaine (Fig. 5). Son oncle, l'académicien Hermite, époux de Louise Bertrand (soeur de son père Joseph), « avait voulu, autrefois, le marier avec sa nièce Louise Henning, alors jeune veuve, qu'il tenait pour une femme "essentielle", on ne savait trop pourquoi [...] Marcel n'était pas tenté. Quand il sonnait [chez les Hermite] il demandait à Adélaïde [la domestique], sur un ton craintif : "la demoiselle n'est pas là ?... ». La cousine de Marcel Bertrand, Madame Forestier, poursuit : « L'élue fut un jour Mathilde Mascart. Hermite l'accueillit avec faveur, et le jeune ménage fut assidu rue de la Sorbonne. » Cette affinité - dont on ne sait pas trop ce qu'en pensait Joseph, père de Marcel, à couteaux tirés avec Hermite -dura puisque, en 1900, l'été précédant sa mort, Hermite, à Saint-Jean-de-Luz, jouit du « voisinage charmant des Marcel Bertrand ».
Ce mariage avait eu lieu le 7 octobre 1886. La « promise » ne pouvait être que bien accueillie car elle était fille d'académicien. Son père, Éleuthère Mascart (1837-1908), fils d'un sévère instituteur du Nord, était devenu un éminent physicien, professeur au Collège de France, qui collectionna les titres de nombreuses académies européennes et présida l'Académie des sciences en 1904. Éleuthère avait lui-même épousé Léontine Briot, fille de son prédécesseur au Collège de France. On restait entre soi !
Entre Marcel Bertrand et Mathilde Mascart, régna l'harmonie. Pierre Termier (1908) nous dit : « Rarement union fut plus heureuse ». L'épouse possédait « un admirable talent de pianiste [Joseph Bertrand, son beau-père, détestait la musique !] et la passion de l'art ; dans tout cela l'amour de la vie simple, le mépris de la richesse et le dédain du monde. » Sept filles - le désir d'une continuité masculine n'étant pas satisfait - furent le fruit de cette union : Jeanne - qui mourra tragiquement à 13 ans en 1900 -, Fanny, Claire, Hélène - morte en 1893, à 10 mois -, Thérèse, Marcelle - morte en 1899, à 18 mois -, enfin Louise, née en 1901. Des quatre filles survivantes, Marcel Bertrand, mort trop jeune, ne connaîtra pas la descendance. La dernière, surnommée « Yette », épousera Eugène Raguin (1900-2001), inspecteur général des mines et professeur de géologie appliquée à l'École des mines, dont on connaît le grand rôle qu'il eut dans la pétrographie française au milieu du XXe siècle et qui dirigea longuement le Service de la Carte géologique.
En 1884, Marcel Bertrand, pour peu de temps encore attaché au Service de la Carte géologique à Paris, termine ses travaux dans le Jura, et il a commencé à cartographier la région toulonnaise. Il est reconnu déjà comme un géologue de qualité, parmi d'autres.
S'il revenait parmi nous, il serait sans doute surpris que sa célébrité vienne pour une bonne part de la solution qu'il proposa, le 18 février 1884, devant la Société géologique à Paris, pour le problème structural des Alpes de Glaris. Pour lui, il s'agissait d'un essai intellectuel : « Je ne me serais pas permis d'écrire cette Note sur un pays que je n'ai pas visité si... », précise-t-il d'emblée au début d'un texte de 14 pages, dont l'objet essentiel est très rapidement traité.
Longtemps avant que la notion et le mot de « charriage » n'apparaissent - en France dans les années 1880 - on connaissait l'extraordinaire phénomène de superposition horizontale d'une série permienne (« Verrucano ») au-dessus d'un flysch tertiaire, dans les impressionnants reliefs des Alpes glaronnaises dominant la Linth et son affluent le Sernf. Il doit s'agir du plus ancien chevauchement visible à l'air libre, observé par un géologue. Nous sommes là en Suisse orientale, dans de hautes montagnes calcaires mésozoïques, certains sommets dépassant 3 000 mètres. Situées sur le versant nord de la crête alpine principale, ces ensembles s'appuient sur le haut massif hercynien de l'Aar. On sait aujourd'hui que les grandes nappes « helvétiques » qu'on y a définies proviennent d'au-delà (au sud) de ce massif ancien. Il s'agit de l'empilement des séries sédimentaires prolongeant vers le nord-est la zone externe « dauphinoise » des Alpes françaises (Fig. 6).
La région de Glaris a alimenté une considérable littérature géologique, et ce que l'on va lire n'est guère que la répétition ou le commentaire des longs exposés des plus grands auteurs (Eduard Bailey, 1935 ; Rudolf Staub, 1954 ; Rudolf Trümpy, 1988 à 1991,.). Voyons donc l'évolution des idées sur ce problème capital pour les Alpes.
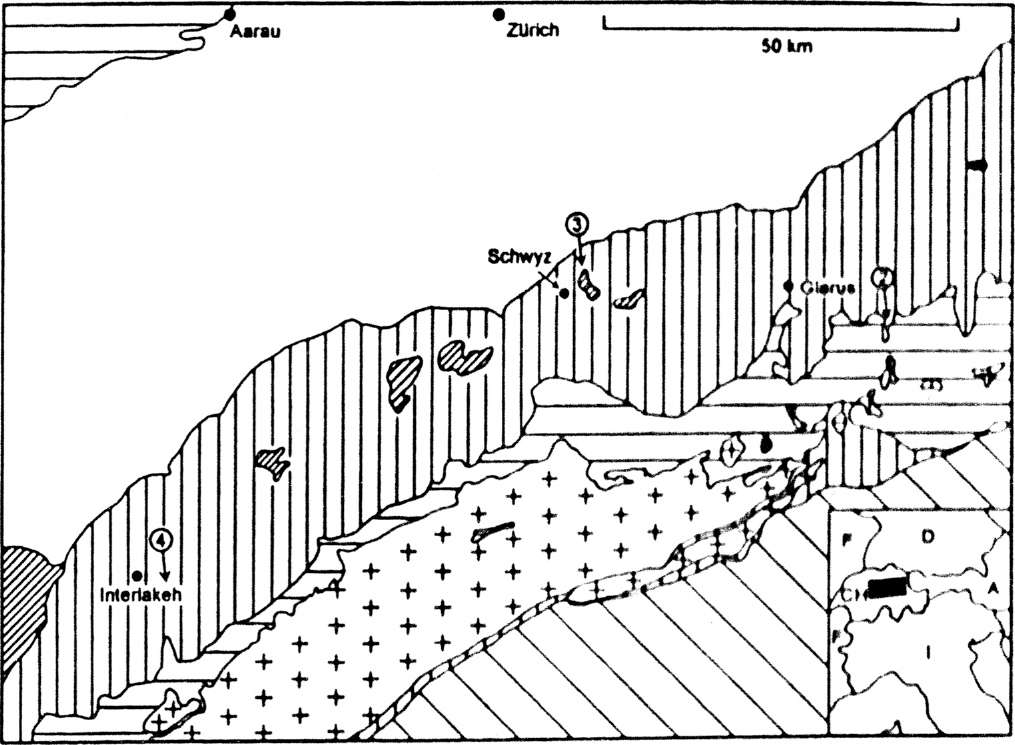
Fig. 6. Schéma des grandes divisions structurales de Suisse centro-orientale. Croix : massif hercynien de l'Aar ; hachuré oblique lâche : zones internes alpines ; hachuré horizontal : Parautochtone infra-helvétique et Jura ; hachuré vertical : nappes helvétiques ; hachuré oblique dense : nappes des Préalpes et « Klippen » ; blanc : molasse tertiaire. L'indication « Glarus » (à droite) permet de localiser la figure 9 [Extrait de S. Franks & R. Trumpy, 2005].
En 1809, l'ingénieur zurichois Hans Conrad Escher von der Linth - celui qui assécha les marais de la Linth -constata, près de Glaris, le repos de la « grauwacke » [le futur « Verrucano » en ce point] sur le calcaire mésozoïque. En 1810, le grand Leopold von Buch « le rappellera aussitôt à l'ordre » (Trumpy, 1988), une telle superposition contredisant l'ordre stratigraphique établi en Allemagne centrale.
Arnold Escher de la Linth, fils du précédent, cartographiant la zone de Glaris (Fig. 7), observa à son tour et fit connaître en 1846 la large superposition du Permien. En 1848, il fit suivre au célèbre géologue Roderick Murchison un itinéraire allant de la vallée de la Sernf à celle du Rhin, et passant par le « Martin' loch » [Segnas Pass). Le Britannique constata (Murchison, 1848) lui aussi que le « flysch » (à nummulites) est surmonté par des sommets de « talc and mica schists, in parts having quite the aspect of a primary rock » (il s'agit du Permien schisto-conglomératique, qui a subi un métamorphisme), par l'intermédiaire d'un « subcrystalline limestone » dont l'équivalent plus au nord-ouest, au Karpfstock, avait fourni des « Jurassic ammonites » à Escher.
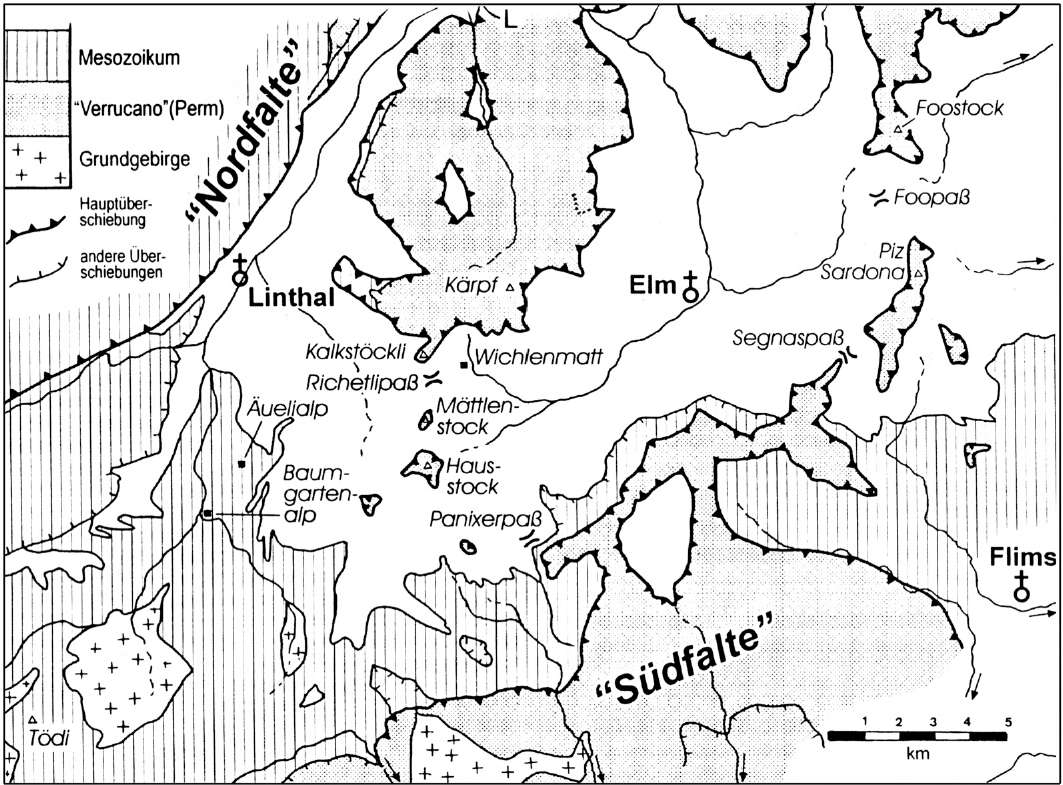
Fig. 7. Carte géologique simplifiée des Alpes de Glaris. Grundgebirge : socle de l'Aar ; Alttertiär : Tertiaire ancien (en blanc) ; Hauptüberschiebung : chevauchement principal de la nappe de Glaris (s.l.) ; Andere Überschiebungen : autres chevauchements ; Nordfalte, Südfalte : plis N et S, selon Heim, 1878) [Extrait de R. Trümpy & R. Oberhauser (1999)].
Celui-ci, effrayé par l'audace de ses impressions, interroge Murchison : « he ingenuously urged me to try in every way to detect some error in his views, so fully was he aware of the monstrosity of the apparent inversion. » L'Écossais était passé par des états d'âme successifs : 1) le Nummulitique aurait été plaqué contre les reliefs de roches plus anciennes (mais l'observation d'un tunnel naturel, au col, attestant la superposition des divers termes, l'en dissuade) ; 2) le métamorphisme aurait atteint et transformé la partie haute du « flysch » (flysch dont il fut convaincu de l'âge par la découverte de nummulites dans la descente sur le Rhin supérieur).
La conclusion semblait claire. Murchison, observant le phénomène dans le paysage jusqu'à dix kilomètres à la ronde, se rassure : « It became necessary to admit, that the strata had been inverted [...] in one enormous overthrow » [renversement], résultant d'une « lateral extrusion [.] of older and more crystalline masses » venant de la partie centrale de la chaîne. Tout en affirmant sa perplexité (« I dare not pretend to offer an explanation of the modus operandi by which such a marvellous mutation of order has been produced over so vast an area »), il évoque hypothétiquement pour résoudre « this enigm » la possibilité de poussées d'éventuels « great central crystalline ellipsoids, whether eruptive [il pense à des granites] or metamorphic ».
On pourrait donc créditer Arnold Escher, appuyé par l'autorité de Murchison, d'être le premier inventeur des nappes, si, « à une date inconnue entre 1849 et 1866 » (Trümpy, 1988), effrayé par son audace d'un unique déplacement du sud vers le nord, le professeur zurichois n'avait pas avancé la théorie du « double pli de Glaris » : un anticlinal couché à vergence nord serait venu affronter un anticlinal couché à vergence sud, l'intervalle entre les charnières des deux plis n'étant que de quelques kilomètres ; le « flysch » tertiaire, au-dessous, remplirait un synclinal « en blague à tabac » presque fermé.
Escher présente en 1866 cette curieuse conception du « double-pli de Glaris », qui diminuait de moitié (15 km cependant !) l'ampleur du chevauchement - jugé terrifiant - unique. Lui succédant en 1872 dans sa chaire du Polytechnikum de Zurich, Albert Heim va reprendre (Fig. 8, coupe du haut) l'interprétation de son maître, dans une célèbre monographie (Heim, 1878), qui fit de lui « le maître incontesté de la géologie suisse pendant un quart de siècle » (Trümpy, 1988).
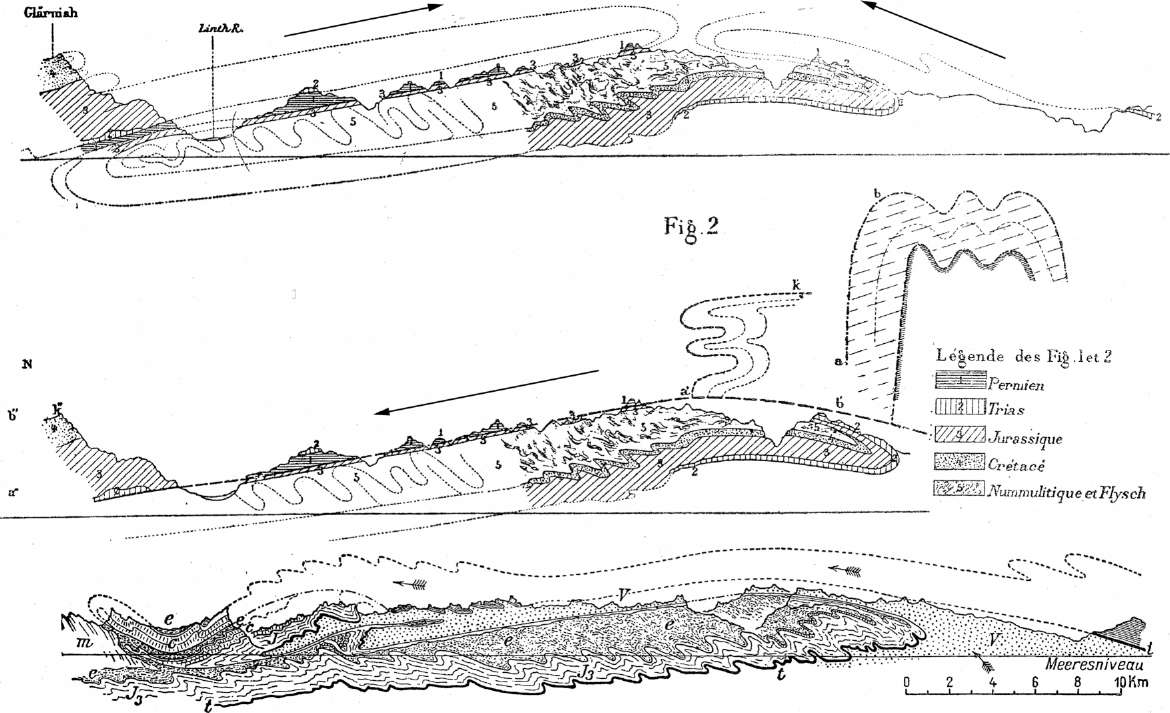
Fig. 8. Coupes interprétatives successives des Alpes de Glaris. En haut : hypothèse initiale d'Albert Heim (1878) ; au milieu : hypothèse de Marcel Bertrand (1884) ; en bas : interprétation finale d'Albert Heim (1908). [Coupes du haut et du milieu extraites de M. Bertrand, 1884a ; Coupe du bas extraite de E. Suess, 1918, La Face de la Terre, t. III-4, p. 1447].
Pourquoi Marcel Bertrand a-t-il eu l'idée, en 1884, de comparer la structure de Glaris à celle du bassin houiller franco-belge, alors qu'il ne connaissait aucune de ces deux régions et que ses débuts dans le Jura ne semblaient pas devoir l'y inciter ? La réponse est facile.
En septembre 1880, il assiste à la Réunion extraordinaire dans le Boulonnais, où Jules Gosselet (1832-1916), le très connu professeur de Lille, expose ses idées « sur la structure générale du bassin houiller franco-belge » : le large chevauchement du Silurien-Dévonien du Condroz (Ardennes) vers le nord, suivant la « faille du Midi », par-dessus le Houiller du bassin de Namur, un « lambeau de poussée » (terme de Gosselet) en série inverse s'intercalant entre les deux ensembles. Au vrai, de tels renversements de la série dévono-carbonifère étaient connus depuis environ 1840 par les travaux miniers, et les observateurs avaient bien noté que, dans le bassin de Namur, sous le grand chevauchement, le Houiller le plus jeune était affecté de plis « en crochon », renversés les uns sur les autres. François-Léopold Cornet et Alphonse Briart - fort connus en Belgique - avaient ainsi, en 1877, indiqué les grands traits de la structure que Gosselet exposa à son tour en 1880. Cornet, présent à la Réunion, surpris par le thème traité par le professeur de Lille, fut réduit à déclarer, sans doute un peu dépité : « J'avais pour but de vous entretenir de quelques faits relatifs aux bassins primaires de la Belgique et du N de la France ; mais après le brillant exposé que M. Gosselet vient de vous donner, je dois déclarer que je ne trouve plus rien à vous dire sur le sujet » ! Du coup, c'est au seul Gosselet que la postérité, en France - et notamment Marcel Bertrand -, attribua la paternité des fameux chevauchements ardennais...
Gosselet (1880) écrira donc : « L'ensemble de ces dislocations [...] semble au premier abord avoir été produit par une poussée formidable du sud vers le nord ». Mais, effrayé par cette idée, il pense que « cette poussée horizontale n'est qu'apparente. La cause du ridement [qui aboutira au chevauchement] du Condroz réside dans l'affaissement des parties centrales du bassin [plus septentrional] et dans le relèvement relatif des bords avec glissement des couches les unes sur les autres. L'affaissement lui-même est une conséquence du retrait constant de la croûte terrestre. » On ne peux mieux argumenter une hypothèse de tectonique par gravité !
L'année suivante, en septembre 1881, Charles Lory (1823-1883), le non moins connu professeur de Grenoble, va diriger une Réunion extraordinaire dans les Alpes dauphinoises. Nous savons (Arch. Acad. Sci. Paris, lettre de Michel-Lévy à Fouqué du 18/7/1881, dossier ac. Michel-Lévy) qu'une « compagnie des mieux choisie » - comprenant Alfred Potier, Marcel Bertrand, Eugène Renevier et lui (M.-L.) - fut invitée pour une huitaine de jours par Lory, afin de voir en place « les fameuses euphotides et variolites du Mont Genèvre ». Lors de la session qui suivit, Lory exposa ses idées sur la division de la chaîne en bandes nord-sud grossièrement parallèles, que séparent de grandes failles (Fig. 11) dont le jeu fréquent expliquerait les différences de faciès et d'épaisseur des séries de part et d'autre de ces accidents. Comme Marcel Bertrand (1889) l'a dit dans son bel éloge funèbre de Lory : « Se passer des pressions latérales, ou du moins restreindre leur rôle à celui d'une simple poussée au vide, tel était bien au fond le désir secret et le but mal avoué de Lory ». Et, ajoute-t-il, Gosselet, présent lui aussi à cette Réunion mémorable, « apporta son adhésion pleine et entière ».
Toutefois, Lory aurait pu être ébranlé par certaines observations de chevauchements dans les Alpes suisses, comme ceux dessinés par Albert Heim (1878) dans ses Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung. La célèbre coupe de Glaris, avec son « double-pli » (Fig. 8, coupe du haut), attira l'attention du Grenoblois (Lory, 1882) qui, cet été-là, put, « avec plusieurs géologues suisses [dont Renevier] et sous la conduite de M. Heim, vérifier l'exactitude de cette coupe ». Le 6 novembre 1882, Bertrand - dont la présence à Paris ce jour-là est assurée - peut donc assister à une communication de Lory, qui rend compte de son voyage en pays bernois. Sa tentative d'explication cinématique nous paraît presque incompréhensible. Il en ressort cependant que les « anomalies » alpines de ce type résident « moins dans des refoulements d'ensemble que dans des affaissements locaux, combinés avec la différence de flexibilité des couches et leurs glissements très étendus les unes sur les autres ». Lory et Gosselet, c'est le même combat !
Voilà donc, fin 1882, Marcel Bertrand au courant de ces chevauchements du bassin houiller franco-belge et de Glaris, d'âges tout à fait différents. Plus d'un an va s'écouler avant que le jeune ingénieur inconnu ose, en utilisant les phrases les plus élogieuses à leur égard, contester les interprétations de trois des grands maîtres de l'époque, Gosselet, Heim et Lory.
« Si », va écrire Bertrand en 1884, « on appelle faille du Midi la surface de séparation du Permien avec la petite bande amincie de Trias et de Jurassique renversés, faille-limite la surface de séparation de cette bande avec le Nummulitique [sous-jacent], on peut écrire dans une même phrase, applicable aux deux régions, soit l'ensemble des phénomènes, soit l'explication proposée » (Fig. 8, coupe du milieu). Et Bertrand d'opposer « simplement au fond l'hypothèse d'un "pli unique" [venu du sud] substituée à celle du "douple-pli" d'Escher », que son élève Heim endossa. Il considère que la « masse de recouvrement » a progressé, sans qu'il y ait « à invoquer comme cause appréciable l'action de la pesanteur ». Grâce à un « écoulement » de la matière, le mouvement de « glissement » n'a pu se produire que si les roches cristallines d'un « massif central » ont produit un « refoulement » de la série. À la différence de Heim mais surtout de Gosselet, Marcel Bertrand ne fait pas allusion à l'appel de matière vers le point bas d'un bassin sédimentaire : l'action essentielle est pour lui le refoulement par une poussée. En cela réside l'essentielle originalité du message de Marcel Bertrand.
En août 1888, Marcel Bertrand fut l'un des participants à une excursion comprenant entre autres Emmanuel de Margerie - ami à la fois de Heim et de Bertrand - et Gustav Steinmann. Nous avons le compte-rendu, ou plutôt la version de Heim. Steinmann se déclara convaincu de la réalité du double-pli. Heim ajoute : Bertrand et Lory [qui avait participé à l'excursion de 1882] « reconnaissant la justesse de ma présentation [des faits d'observation] ont essayé une explication quelque peu différente. Pourtant Bertrand, après avoir lui-même examiné la région, est revenu de ses idées et il se rallie complètement à mon interprétation. »
Ces phrases méritent commentaire. D'abord, Heim n'avait pas compris que l'opinion de Lory était proche de la sienne et n'avait rien à voir avec celle de Bertrand. Ensuite, Heim a dû entendre celui-ci se rallier, à cette date, à l'hypothèse du « double-pli ». En juin 1888, en effet, Marcel Bertrand croit voir, en Provence, le « pli couché » de la Sainte-Baume (poussé vers le nord) faire face aux plis couchés de Saint-Zacharie (prétendument poussés vers le sud), situés le long de la vallée de l'Huveaune, plus au nord. Et d'écrire que le « renversement de deux chaînons l'un vers l'autre est un fait exceptionnel et anormal, je n'en connais pas [...] d'autres exemples que celui de Glaris et celui de la Sainte-Baume... ». Il est donc vraisemblable que, deux mois après, quand il peut « suivre des yeux [...] un des plus beaux spectacles que présente la chaîne des Alpes » au-dessus de Glaris (texte sur les « plis couchés de la région de Draguignan », du 29 octobre 1888), Marcel Bertrand ait été convaincu par Heim. Mais cela n'aura qu'un temps.
En 1890, dans le grand mémoire sur les Refoulements..., l'ouvrage de Heim (1878) est longuement commenté : c'est « l'analyse magistrale qu'il y a faite des grands déplacements horizontaux et du mécanisme général des plis qui a donné le courage de croire à la réalité des faits de recouvrement, quand on les a retrouvés dans d'autres pays ». Bertrand aborde alors la question capitale, celle de la formation du fameux « double-pli », et il demande : « Comment concilier ce renversement de deux plis en sens contraire avec l'unité d'actions qui semble avoir présidé à la formation des chaînes ? ». Bertrand rapporte ainsi la thèse de Suess (1875) qui, dans Die Entstehung der Alpen, avait affirmé que la structure essentielle des grandes chaînes était le résultat d'une compression dans une direction définie, vers un avant-pays. À cela, Heim aurait répondu que « les pressions [...] dans l'écorce terrestre doivent créer en chaque point des forces égales et opposées » parce que « l'action est égale à la réaction ; il n'y a pas à parler d'un sens déterminé pour les efforts orogéniques. Ce qui détermine le déversement d'un pli, c'est seulement le vide plus grand qui, d'un côté ou de l'autre, s'ouvre à ses pieds ». Comme Gosselet et Lory, Heim croit donc à l'importance d'une « poussée au vide », mais Bertrand dit douter que ce phénomène puisse suffire pour expliquer l'alignement et le déroulement de plis horizontaux sur plusieurs kilomètres.
On pourrait admettre le double pli si, ajoute-t-il, il s'agissait d'un même pli anticlinal dont l'axe aurait tourné de plus de 180°, tout en se déversant constamment vers le synclinal situé entre les deux branches. Rappelons que c'est l'époque où Bertrand vient d'imaginer la disposition sinueuse des plis de Provence (à laquelle il renoncera plus tard) : « il serait intéressant de voir si la même formule ne s'appliquerait pas au double pli de Glaris, si, en d'autres termes, le pli nord ne serait pas dans la prolongation déviée du pli sud ». Et Marcel semble s'amuser à trouver dans le détail des structures cartographiées par Heim dans les Alpes glaronnaises des faits favorables à de tels grands plis sinueux. À moins que.
« À moins qu'on ne renonce à reconnaître au pli nord [de Glaris] une individualité propre et que, suivant une suggestion - c'est de sa suggestion de 1884 qu'il veut parler - qui date déjà de plusieurs années, on ne soit amené à voir, dans les montagnes du Glarnisch et de la Windgalle, non pas un nouveau pli déversé vers le sud, mais la continuation des masses de recouvrement charriées par le pli sud ». Bertrand discute alors les objections que lui a faites Heim à partir de structures locales, par exemple les charnières de petits plis visibles, de vergences opposées, interprétés comme significatifs de la vergence des deux grands plis couchés imaginés par Heim. À quoi Bertrand répond qu'il peut s'agir de froissements secondaires. Il remarque en outre qu'entre la tête des deux plis prétendument opposés, l'intervalle n'atteint pas deux kilomètres, un piton allochtone isolé à mi-distance, le Hausstock, ayant été « rattaché par Escher au pli sud, tandis qu'il est rattaché par M. Heim au pli nord » !
Ainsi donc, en 1890, s'il affecte de prendre en considération l'interprétation du « double pli glaronnais » du professeur de Zurich, Marcel Bertrand n'en rappelle pas moins sa propre hypothèse de 1884, dont il développe les conséquences : « S'il n'y avait dans les Alpes de Glaris qu'un pli unique, le Nummulitique de la vallée de la Linth [celle de Glaris] devrait aller rejoindre en profondeur celui qui fait au Nord la bordure des grandes chaînes calcaires [...], ce ne seraient pas des déplacements horizontaux de quinze [chiffre correspondant au seul pli nord de Heim], mais de quarante kilomètres qu'il faudrait supposer, et l'on arriverait à ce résultat effrayant qu'entre Interlaken et Glaris [c'est-à-dire sur un front d'une centaine de kilomètres], toutes les grandes montagnes de la Suisse sont superposées à l'Éocène. »
Essayant de se faire pardonner sa « hardiesse » - celle-ci étant « déjà grande d'avoir essayé d'en fixer le terrain » ! - Marcel ajoute : « Il est certain qu'une pareille idée ne peut être acceptée que si elle s'appuie sur des preuves matérielles, et ces preuves n'existent pas ; on peut seulement indiquer en sa faveur un certain nombre d'inductions, et ce ne sera que plus tard, quand les coupes des régions voisines seront mieux connues, quand elles pourront être comparées à celles des Alpes de Glaris, que les notions de continuité pourront intervenir pour juger de la valeur de ces inductions et fournir peut-être des arguments définitifs dans un sens ou dans l'autre. » Il est clair en tout cas qu'à cette date (1890), n'en déplaise à Heim, Bertrand avait conservé une certaine tendresse pour son hypothèse de « pli » unique de 1884 ! Cependant, l'autorité du maître zurichois était telle que les observateurs extérieurs étaient obnubilés par l'idée du « double-pli ». Et même l'Alsacien Émile Haug, redevenu compatriote de Bertrand à cette époque, parlait (Haug, 1894) du double-pli, « que M. Heim a si bien su mettre en évidence », en affectant - lui aussi - d'ignorer Marcel.
Les phrases de Bertrand reproduites ci-dessus n'ont pas été connues car le mémoire de 1890 sur Les refoulements n'a été imprimé qu'en 1908, après la mort de l'auteur. Cependant, en 1894, dans sa notice de candidature à l'Académie, - qui elle, fut imprimée - Marcel rappelle sa proposition de 1884 sur Glaris : « Si l'on veut parler de plis [cette phrase montre une évolution de sa pensée], c'est l'hypothèse d'un pli unique substituée à celle du double pli de M. Heim... ». Et d'ajouter, soulignant sa priorité - ce qu'il fait rarement, mais ici c'est pour la bonne cause, son entrée quai Conti ! - : « Dix ans plus tard, M. Schardt a été amené de son côté à une hypothèse semblable [sur les Préalpes] ; on commence seulement aujourd'hui à essayer de la préciser ou de la combattre par des arguments et des observations de détail. Quel qu'en doive être le résultat, l'hypothèse aura été utile en appelant l'attention sur le rôle important et général des déplacements horizontaux... ».
Rudolf Trumpy (1991) a rappelé la succession des événements après la conférence de Marcel Bertrand de 1884, qui fut accueillie par une indifférence générale.
En 1890, Heim organisa une excursion dont les participants allemands furent amenés à signer « a protocol attesting the validity of Heim's observations and inferences ».Ce texte concluait (traduction de l'allemand) : « Aujourd'hui, nombreux sont les géologues qui considèrent le double-pli de Glaris, non plus comme une création imaginaire, mais comme un solide marchepied sur la voie de la connaissance de la Nature. Et leur nombre s'accroîtra encore car la Vérité a un grand souffle » [« einen langen Athem hat die Wahrheit »]. Trumpy précise que ces phrases s'adressaient surtout à August Rothpletz qui affirmait la complexité du problème de Glaris dont les masses chevauchantes se seraient, selon lui, déplacées dans des directions variées ; mais Heim s'adressait implicitement aussi à Bertrand, dont il taisait obstinément le nom.
Et c'est ici qu'intervient Eduard Suess, dont le rôle dans la résolution du problème de Glaris a pu paraître ambigu, aux yeux de Bailey en particulier. Dans la préface de ses Tectonic Essays... (1935), ce dernier évoque le fait que Heim a fait figurer en 1922, dans sa Geologie der Schweiz, sous sa coupe « définitive » admettant enfin l'unique chevauchement de Glaris, la mention « Suess, 1892 », qui semble attribuer au maître autrichien la paternité de l'idée. Interrogeant Heim à ce sujet, Bailey crut comprendre que celle-ci avait été formulée seulement lors d'une conversation entre les deux hommes. L'Écossais se pose alors une question : « Perhaps some friend may yet tell us whether Bertrand, before he wrote his famous paper, has read the early instalments of Suess's Antlitz der Erde. »
Il est possible de répondre - posthumément - à Bailey : dans sa note de 1884, Bertrand cite en note infrapaginale ce dernier ouvrage ou, plus exactement, sa 1e partie, éditée en 1883. On n'y voit cependant pas ce que Bertrand aurait pu en tirer pour son hypothèse. Suess, en effet, a écrit (in La Face de la Terre, I, p. 141-142) : « Si la masse comprimée se replie sur elle-même, elle se dresse en voûtes rompues qui, parfois, peuvent se faire face l'une à l'autre » ; et il cite l'exemple donné « par Escher au Sentis », ajoutant : « Il est parfaitement exact, comme le fait remarquer Heim, qu'un même mouvement peut donner naissance à des plis déjetés en sens contraire : par exemple, dans une chaîne poussée vers le nord [c'est, pense justement Suess, le cas des Alpes], il peut se former des plis déjetés vers le nord et des plis déjetés vers le sud ». Convenons de la difficulté de ne pas penser que ces phrases ne s'appliquent pas au « double-pli » de Glaris !
On peut en conclure que l'argumentation de Heim avait influencé Suess, et cela d'autant plus qu'en 1888, dans le tome II de l'Antlitz, quand Suess évoque le bassin houiller francobelge, il cite la note de Bertrand de 1884, d'une manière on ne peut plus indifférente : « Bertrand compare cette zone de recouvrement à certaines portions des Alpes de Glaris ». (Suess, La Face de la Terre, II, p. 139).
Toutefois, dans ses souvenirs (Erinnerungen, 1916, cf. p. 423) posthumes, le maître viennois donne une version quelque peu différente. Il parle d'une visite qu'il fit à Zurich en 1883 : « Je mentionnai [à Heim ?] mes doutes [sur le double-pli ?] mais me manqua le temps pour un coup d'oeil plus précis ». On conçoit que l'opinion du Zurichois choque Suess car elle contredisait la règle qu'il avait énoncée en 1875 dans Die Entstehung der Alpen : dans les chaînes plissées, les poussées dominantes se font en direction des zones externes.
Presque dix ans plus tard, l'été 1892, le maître autrichien est à nouveau en Suisse, accompagné d'un groupe de géologues allemands. Ils escaladent les reliefs au-dessus de Schwanden (Fig. 7), reconnaissant, tranchée net au-dessus du « flysch » paléogène, une bande de calcaires « jurassiques » qui se suit de loin en loin sous les grès [Verrucano] permiens. La quasi-continuité de cette bande calcaire [en fait une mylonite triassico-jurassique, le « Lochseitenkalk »] prouve la liaison des deux « ailes » du prétendu « double-pli de Glaris ». Redescendu à Zurich, Suess tente de convaincre son collègue, mais en vain : celui-ci « voulut contrôler les choses ». Bailey (1935) en parla plus tard à Heim qui lui affirma avoir insisté pour que Suess publie son point de vue, mais que celui-ci aurait refusé, disant : « You must do it yourself, if you can agree with the idea ». On comprend que Suess ait hésité à se parer des plumes du paon, étant donné l'antériorité de Bertrand sur le sujet !
En 1894, lors du Congrès géologique international de Zurich, rien n'indique que Heim ait encore changé d'idée sur Glaris, contrairement aux « Souvenirs » (Erinnerungen, 1916) de Suess, qui a prétendu : « Les opinions s'étaient clarifiées. Heim acceptait la nouvelle explication du "double-pli glaronnais", Hans Schardt venant d'affirmer le caractère charrié et déraciné des Préalpes romandes. »
Suess gardera le silence sur Glaris jusqu'après la mort de Marcel Bertrand. Dans le tome III de l'Antlitz (Suess, La Face de la Terre, III, p. 718), il écrit : « Dès 1884, Marcel Bertrand exprimait publiquement l'opinion qu'à Glaris il n'y avait qu'un pli unique, venant du Sud. » Et il ajoute, afin d'épargner son ami Heim : « Les travaux classiques d'Albert Heim ont éclairci la face des choses. »
En effet, ce dernier s'est rendu après un long combat (Fig. 8, coupe du bas). En 1901, Maurice Lugeon vient d'exposer à Paris son célèbre travail sur « les grandes nappes de recouvrement des Alpes du Chablais et de la Suisse », où la question de Glaris est traitée dans l'esprit des propositions de Marcel Bertrand. Lugeon en a exposé la teneur à son maître zurichois et l'a convaincu. Dans une « lettre ouverte » du 31 mai 1902, publiée avec son accord par Lugeon à la suite de la note de celui-ci, Heim écrit : « j'incline fortement en faveur de votre manière de voir » et si la « nouvelle théorie [sic !] de MM. Bertrand, Suess et Lugeon [re-sic !] se heurte bien à quelques difficultés de détail », celles-ci « semblent de peu d'importance et seront sans doute aisément surmontables ».
La querelle de Glaris, au bout de vingt ans, est éteinte. En janvier 1907, Heim, qui ne sait pas que Bertrand vit ses derniers jours, prononce dans une conférence à Zurich des paroles, émouvantes quoique tardives, de repentance, que Termier (1908) rapporte : « Wie schüttelten unglaübig den Kopf, und eine Reihe von Jahren blieben diese Hinweisungen von Bertrand vergessen. Heute erfüllt uns Bewenderung vor dem Scherblick unseres Freundes nicht mehr mit uns empfinden kann. » [Incrédules, nous hochions la tête, et bien des années s'écoulèrent à négliger ces prédictions de Bertrand. Aujourd'hui, nous sommes remplis d'admiration pour le coup d'oeil aigu de notre ami qui, hélas, maintenant plongé dans les songes d'une pénible aliénation mentale, ne peut plus, avec nous, connaître la joie].
Albert Heim avait été élu, le 12 février 1906, correspondant de l'Académie des sciences de Paris. La signature de Marcel Bertrand atteste de sa présence, quai Conti, ce jour-là. Le rapport de présentation fut fait par Albert de Lapparent, mais on peut croire que, sans la brume intellectuelle qui l'entourait, Marcel Bertrand aurait eu plaisir à célébrer les mérites du maître zurichois.
Bailey a tiré la leçon de ces débats sur Glaris, en écrivant (1935) : « a geologist with Bertrand's experience was perfectly justified in accepting Heim's observations and in drawing for them his own conclusions. It is a thousand pities for the credit and progress of our Science that his 1884 paper passed almost unnoticed... ».
L'été 1896, Bertrand va - pour la première fois, sur le terrain, en Suisse - étudier l'Oberland bernois, prolongement occidental des Alpes de Glaris. Il rejoint à Grindelwald Henri Golliez, géologue lausannois qui en a entrepris l'étude en 1895. Parfois accompagnés par le tout jeune Lugeon, les deux hommes vont parcourir les montagnes mésozoïques au nord du massif de l'Aar. Comme Heim à Glaris, Armin Baltzer (1880) a imaginé là un « double-pli » couché, avec deux vergences opposées, par-dessus une étroite bande synclinale de « flysch » éocène, supposée s'élargir vers le bas, en « blague à tabac ». En fait, Bertrand et Golliez établissent que tous les plis se dirigent vers le nord et que le Mésozoïque de l'Oberland est en totalité charrié par-dessus le « flysch éocène », autochtone décollé du versant nord du massif de l'Aar. « Le rapprochement [avec le problème de Glaris] est d'autant plus naturel que la bande nummulitique [...] va [vers l'est] se raccorder avec la bande éocène centrale des Alpes de Glaris. » Marcel Bertrand est d'autant plus agréablement surpris qu'en 1884, dans son dessin audacieusement prophétique sur le « recouvrement » dans les Alpes suisses (Fig. 9), il avait prudemment laissé en blanc la zone de l'Oberland bernois. Cette fois, en 1896, il va, avec Golliez, conclure que « les chaînes schisteuses [jurassico-crétacées] de l'Oberland bernois n'ont pas de racines ». Bertrand - le texte est manifestement de sa main - conclut en considérant « toute la zone qui s'étend entre la chaîne [le massif de l'Aar] et la ligne des lacs [des lacs de Thoune-Brienz au lac des Quatre-Cantons] comme une nappe complexe de recouvrement venue du Sud ». Tout en remarquant « que cette coupe n'est, au fond, que la reproduction de celle que M. Schmidt a donnée pour la rive droite de la Reuss dans le Livret-Guide du Congrès géologique international », Bertrand et Golliez concluent : « L'avenir dira si nous nous trompons ». Les bons juges que sont Rudolf Trumpy et Marcel Lemoine (1998) ont, un siècle après, proclamé : « Nous pouvons affirmer qu'ils ne se sont pas trompés. »
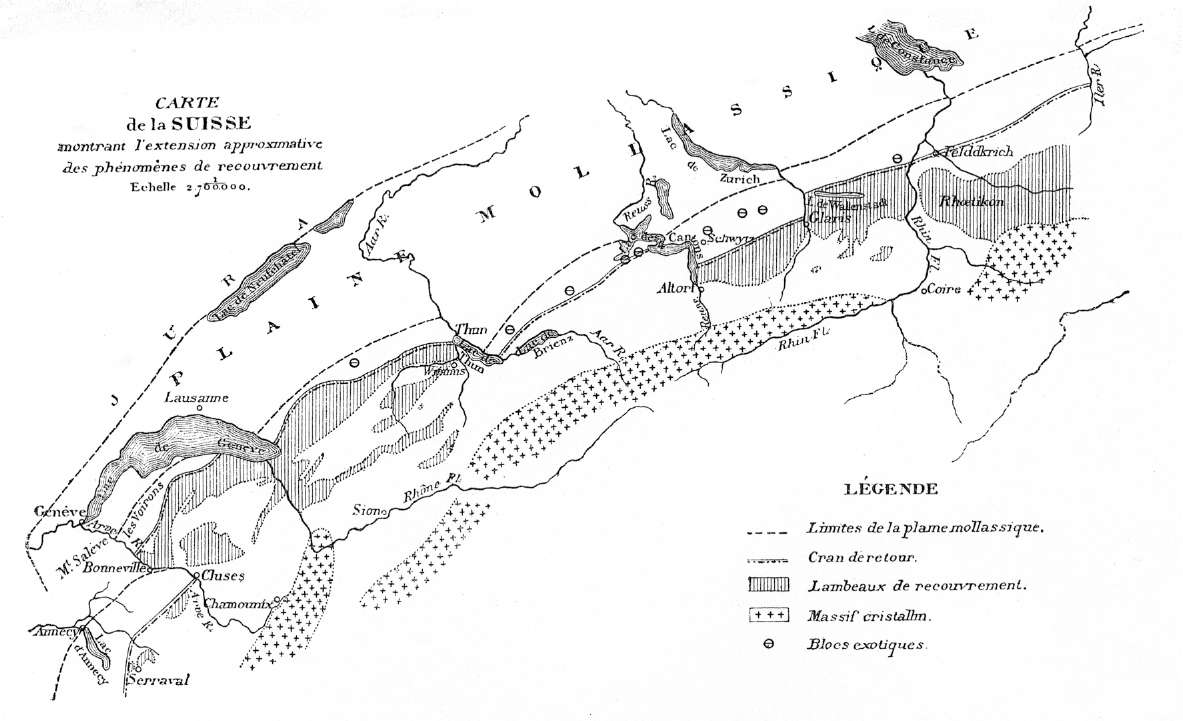
Fig. 9. Extension approximative des « recouvrements »dans les Alpes suisses [Extrait de M. Bertrand, 1884a].
Après avoir exposé son interprétation pour Glaris, Marcel Bertrand termine son article de 1884 par la phrase : « L'étude des cartes géologiques de la Suisse mène à cette conclusion que le phénomène de recouvrement n'est pas spécial aux Alpes de Glaris ». Dans une petite carte (Fig. 9), il a dessiné, « sous toutes réserves », l'immense aire de « recouvrement » au Nord de l'axe des « massifs cristallins » (Mont-Blanc, Aar,...), sur près de 300 km entre Savoie et Rhaetikon.
Ce schéma est prophétique. Il est certes facile aujourd'hui de constater que Bertrand a utilisé le même figuré pour des unités allochtones appartenant, les unes (entre Reuss et Rhin) aux nappes externes « helvétiques », les autres aux unités supérieures des Préalpes (entre l'Aar et l'Arve), voire à l'Austro-alpin (à l'est du Rhin supérieur) : en 1884, personne ne pouvait soupçonner ces distinctions (Fig. 6). Le schéma de Bertrand ne prétend indiquer que le phénomène de recouvrement. Il appelle un certain nombre de remarques.
Dans le bassin houiller franco-belge - base du raisonnement dans la note de 1884 -, un accident (« la faille ou le cran de retour ») sépare la « masse de recouvrement » méridionale de l'avant-pays autochtone du Brabant. À première vue, on y voit une faille normale, liée à l'affaissement du compartiment sud.
Dans son souci de vouloir trouver une stricte analogie entre Ardennes et Alpes de Glaris, Bertrand va donc imaginer un « cran de retour » limitant au nord les « recouvrements » des Alpes suisses. Il le dessine de la Savoie au Vorarlberg, parfois décalé par des décrochements perpendiculaires à la chaîne, suivis par les grandes vallées. Le texte est clair : « Il n'y a pas lieu de s'étonner que la superposition d'un semblable poids [des masses de recouvrement] ait au moins contribué à produire un affaissement de la partie recouverte ». Le « cran de retour » est donc une faille normale.
La même idée est exprimée en 1888 quand Bertrand parle, au nord de la Sainte-Baume en Provence, des « plis couchés de Saint-Zacharie », qu'il croit (à cette date) couchés vers le sud, et limités par une faille en extension le long du massif autochtone de la Lare. Tout se passe « comme si le poids des masses superposées en était la cause », et il rappelle : « il y a près de 4 ans que j'ai proposé cette explication dans le bassin houiller du Nord... »
Mais la pensée de Marcel Bertrand évolue. Présentant, en juin 1894, ses Études sur le bassin houiller du Nord, il affirme cette fois : « Le cran de retour n'est pas une faille d'affaissement ». Il s'agit d'une « faille inverse » : les couches houillères les plus méridionales (relativement anciennes) ont été poussées « de bas en haut, du Sud vers le Nord », sur des couches houillères plus jeunes. Comme celles-ci reposent transgressivement sur le socle du Brabant, Marcel Bertrand est conduit à éloigner paléogéographiquement l'un de l'autre les deux compartiments : le cran de retour doit être en profondeur (au sud) « une faille à peu près horizontale », permettant un déplacement de plusieurs kilomètres vers le nord du compartiment chevauchant.
Il reviendra sur la question en juillet 1898, quand il comparera la structure du bassin houiller du Nord à celle du bassin de Fuveau en Provence. Il ne voit plus « d'équivalent [du Cran de retour] dans le Midi », ni sans doute dans les Alpes suisses, dont il ne parle plus. Quant au Cran de retour du bassin du Nord - revenant ainsi à son opinion initiale de 1884 ! - il en fait une « faille de tassement », abaissant un contact anormal plat antérieur.
Avant 1900, le style admis dans le domaine des calcaires mésozoïques des Alpes orientales était celui de plis serrés, parfois à structure imbriquée, poussés vers le nord et bousculant un flysch bordier tertiaire, lui-même chevauchant la Molasse « miocène ». À l'ouest, dans les Alpes rhétiques, les reliefs calcaires s'interrompent brusquement, leurs reliefs dominant les schistes du Pratigau (Grisons). Suess, en 1883, envisageait une grand « décrochement [senestre, N-S] entre les Alpes orientales et les Alpes occidentales ». Quant à Marcel Bertrand, en 1890 (imprimé en 1908), il considère que le front nord du Mésozoïque calcaire des « Alpes bavaroises » montre un anticlinal déversé vers le nord ; ce pli va, vers l'ouest, « s'infléchir autour du Rhaetikon et du Prattigau », sans avoir en apparence « produit de déversements considérables ». Marcel Bertrand s'étonne cependant du brusque arrêt des charriages à l'est des proches Alpes de Glaris. Sans pouvoir encore, comme Haug le fera en 1896, proposer une origine lointaine, au sud, des masses des Alpes rhétiques, il suggère cependant que « les déplacements horizontaux n'auraient pas été moins importants dans les Alpes bavaroises que dans les Alpes suisses ». Et de remarquer (1884) que, d'après Edmund Moïssissovics, « il y a là [...] cette circonstance bien intéressante, que les terrains [Trias essentiellement] dans la masse de recouvrement » qu'il figure « présentent le faciès alpin, et dans les autres affleurements [à Glaris en particulier] le faciès helvétique ».
Marcel Bertrand (1884) dessine sur sa carte (Fig. 9), au sud et à l'est du lac Léman, de grands « recouvrements », que nous savons maintenant être répartis entre les nappes helvétiques et, au-dessus d'elles, les nappes des Préalpes (essentiellement équivalent du Pennique « briançonnais »). La découverte des nappes des « Préalpes romandes (zone du Chablais et du Stockhorn) » est due à Hans Schardt (1893). Dans ses premiers travaux, celui-ci s'était interrogé sur le « phénomène inconnu » pouvant expliquer les particularités - déjà notées par Carl Diener en 1891 - de ce domaine par rapport à son voisinage : ainsi l'Urgonien, absent dans le Chablais, est très développé dans le domaine « helvétique » voisin.
Préoccupé par la carte régulière au 80 000e, Michel-Lévy séjourne à Montriond (Haute-Savoie) d'où il écrit à Fouqué (lettre du 11/9/1892, Arch. Acad. Sci. Paris, Recueil Lacroix 1-J-22-2) : « combien la brèche [= l'unité supérieure du Chablais] laisse difficilement pénétrer son secret. MM. Renevier, Lugeon, Haug, Schardt et même Marcel Bertrand se sont succédé ici sans se mettre autrement d'accord. C'est à proprement parler la tour de Babel... ».
C'est peu après, en 1893, que Schardt trouve la solution. Il propose une explication, « exprimée, il y a huit ans déjà, par M. Marcel Bertrand, d'une plaque de recouvrement [...] qui aurait envahi les plis du bord N des Alpes. La zone du Chablais serait comprise en entier dans cette nappe de recouvrement. Les lambeaux des Almes [des Annes] etc., en seraient des restes. » Ayant ainsi rappelé la pensée de Bertrand, Schardt prête à son devancier l'idée que cette « plaque de recouvrement » vient. du nord : comme le remarquera Haug en 1899, Schardt a mal compris Bertrand, pour qui le déplacement s'est produit du sud vers le nord !
On pourrait en conclure que Schardt a reconnu la priorité de Bertrand dans l'allochtonie des Préalpes. Paraîtraient le conforter les phrases de Bertrand dans son étude du massif du Môle (1890) près de Bonneville, et aussi dans sa Notice (1894) : il écrit que sa proposition de « recouvrement » de Glaris avait été suivie « dix ans plus tard » par l'« hypothèse semblable » de Schardt dans les Préalpes. Haug lui-même - qui, initialement, ne croyait pas, contrairement à Schardt et à Lugeon, à l'allochtonie des Préalpes - affirme (Haug, 1899) : « Partant de considérations toutes différentes, les deux auteurs [Schardt et Bertrand] sont donc arrivés, à neuf ans d'intervalle, à des conclusions tout à fait analogues, mais il est hors de doute que si la théorie du charriage des Préalpes venait un jour à s'imposer, c'est à M. Marcel Bertrand que reviendrait l'honneur d'avoir émis le premier l'hypothèse du recouvrement. » Le rugueux Alsacien est ravi de minimiser l'apport de son « ancien compagnon de courses » Schardt !
Au stade de la note de 1884, la priorité de Marcel Bertrand peut être défendue, en notant toutefois que, pour celui-ci, tous les flyschs - essentiellement tertiaires - étaient autochtones alors qu'il en existe, charriés (on le sait maintenant), dans les Préalpes. Mais, en dehors de cette « illumination » de 1884, l'attribution de cette priorité repose sur des quiproquos. Pour en juger, reprenons les événements dans l'ordre chronologique.
L'étude du Môle (1892). La cartographie du massif du Môle, situé à l'extrémité méridionale du Chablais (Fig. 10), va permettre à Marcel Bertrand de se faire, pour la première fois, une opinion personnelle, sur place, des problèmes des Préalpes (Masson, 1976). Les roches mésozoïques, principalement jurassiques, du Môle dominent à Bonneville la rive nord de l'Arve (feuille « Annecy » au 80 0000e). Michel-Lévy, nouveau directeur du Service de la Carte géologique, demande en 1892 à Marcel Bertrand d'aller se faire une opinion sur l'âge des gypses et cargneules de la Savoie. Ces roches posent ici, comme ailleurs dans les chaînes autour de la Méditerranée occidentale, les mêmes problèmes de genèse et d'âge. Alphonse Favre (1849, 1867) en faisait du Trias, mais certains auteurs de Suisse romande, vers 1890, ont proposé des âges variés, allant du Jurassique à l'Éocène !
Marcel Bertrand arrive à Lausanne le 22 juin 1892 (Lugeon, in Fabre-Taxy et Gueirard, 1950). Il va être parfois accompagné dans ses courses par le professeur Renevier ou par le jeune Lugeon. Après étude du Môle, Marcel Bertrand accepte l'âge triasique des gypses et cargneules, du fait de leur étroite liaison avec l'«Infralias » [Rhétien] à « Avicula » contorta. Et il en profite pour donner une interprétation structurale du massif.
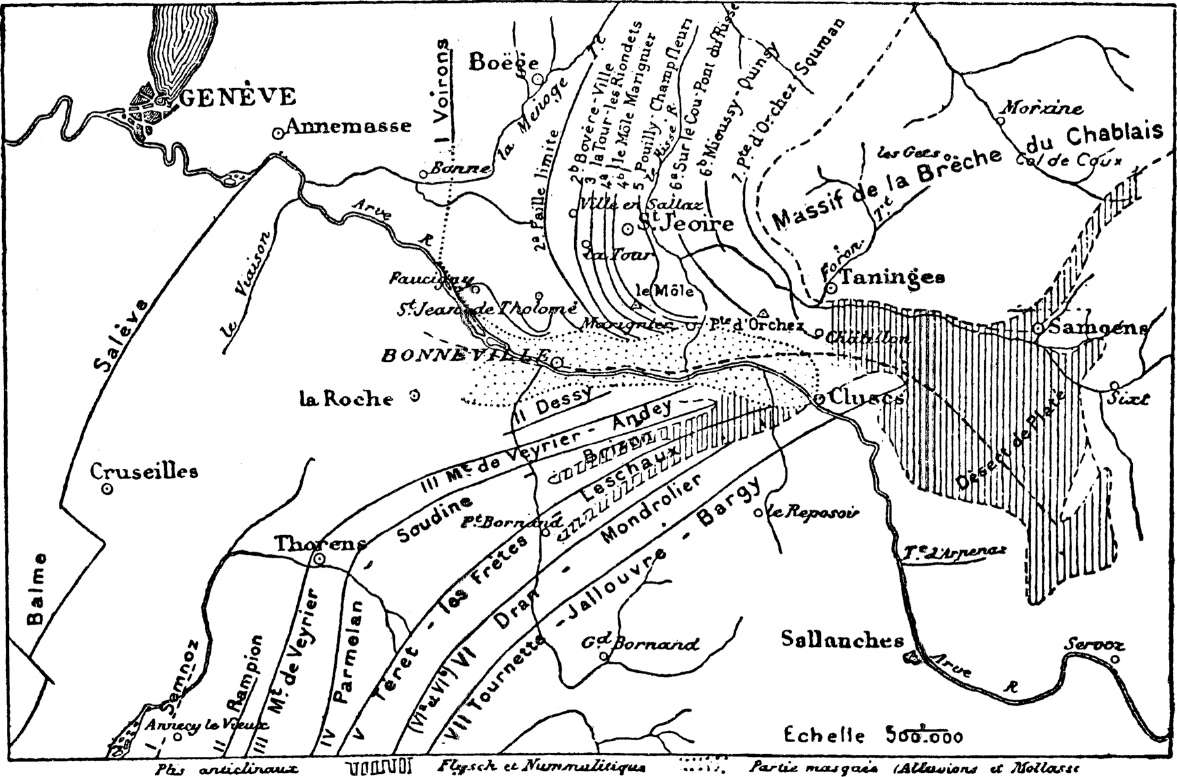
Fig. 10. Rebroussement des plis alpins des deux côtés de la vallée de l'Arve (Savoie) selon M. Bertrand, région du Môle [Extrait de M. Bertrand, 1892d].
De part et d'autre de l'Arve (Fig. 10), les terrains mésozoïques sont affectés de plis grossièrement SW-NE. Au niveau de la rivière, ces plis s'infléchissent vers l'est, en dessinant un rentrant. L'hypothèse la plus simple aurait été de placer une faille est-ouest le long de l'Arve, mais un tel accident n'apparaît pas immédiatement à l'est, vers Cluses. Bertrand va donc supposer qu'une « arête de rebroussement », masquée par des dépôts récents dans la vallée, sépare les deux mini-virgations que dessinent les plis.
Il y a cependant un problème. Les successions stratigraphiques sont différentes de part et d'autre de la fameuse « arête de rebroussement ». Au sud de l'Arve (massif des Bornes), le Crétacé, de type « dauphinois » [= « helvétique »], est très épais, avec un puissant Urgonien calcaire. Au nord de la rivière (massif du Môle), le Crétacé est mince, sans Urgonien, et des « couches rouges » marno-calcaires datées du Crétacé supérieur par foraminifères (déterminés par Lucien Cayeux) ont un faciès très particulier, inconnu dans les Bornes.
Refusant l'idée d'un contact tectonique entre les deux rives, Marcel Bertrand va donc imaginer un dispositif saugrenu : un grand pli-flexure est-ouest, en genou, déjeté vers le sud, se serait formé pendant la sédimentation crétacée : le côté nord (le Môle), zone haute, n'aurait reçu que de minces dépôts ; le côté sud (massif des Bornes), affaissé, recevant une série épaisse. Tel est le point de vue, franchement autochtoniste, de l'auteur du grand charriage de Glaris !
La Brèche du Chablais. La même année, cependant, Bertrand et Lugeon découvrent ensemble, à Taninges, au nord-est du Môle, des calcaires sous le Carbonifère détritique qui forme la base du massif « de la Brèche » (du Chablais). L'idée d'un âge carbonifère pour ces calcaires ne dure pas car des foraminifères du Crétacé supérieur y sont découverts : moment d'enthousiasme qui aurait été fêté par « plusieurs bouteilles d'Asti » (Lugeon in Fabre-Taxy et Gueirard, 1950) ! Cela signifiait que « la Brèche » (Trias-Jurassique) ne s'enracinait pas. Cette sensationnelle découverte va faire réfléchir Marcel Bertrand.
L'année suivante, il participe à la réunion (3-11 septembre 1893) de la Société géologique suisse dans le Chablais, dirigée par Renevier. De nombreux géologues français (Michel-Lévy, Haug, Kilian, de Margerie,...) sont là. Parvenus aux chalets du Lens d'Aulph (Lugeon, in Fabre-Taxy et Gueirard, 1950), dans le massif de la Brèche, les participants auraient entendu Bertrand s'exclamer : « un jour l'on dira peut-être que le massif de la Brèche est un lambeau de recouvrement un peu plus grand que d'autres ». Lugeon ajoute : « Personne ne s'y arrête » [à cette idée], et il ajoute perfidement : « Hans Schardt lançait quelques mois plus tard l'hypothèse du charriage des Préalpes, sans dire un mot de l'hypothèse de Bertrand. » Ce dernier aurait confié à Lugeon « regretter de n'avoir pas insisté et publié avec moi [Lugeon] immédiatement sa vision » ; mais il n'aurait pas voulu influencer Lugeon (qui, à l'époque, était, contrairement à Schardt, partisan d'une structure en champignon des Préalpes !).
Au début de 1894, la pensée de Bertrand se précise. Deux lettres à Kilian (Arch. Acad. Sci. Paris, dossier M. Bertrand), déjà commentées (Trumpy et Lemoine, 1998), permettent de la connaître. Le 6 février, il gourmande son ami grenoblois pour s'être mêlé des affaires des Préalpes avant que les confrères suisses n'aient développé leur argumentation. Le 9 février - Kilian s'étant justifié entre temps - Marcel Bertrand lui précise que la prudence s'impose : « comme Lugeon tient M. Lévy au courant de toutes ses idées et de ses arguments, que M. Lévy nous montre ses lettres et que nous en discutons à perte de vue, [je trouve] inopportun que nous ayons l'air en France de vouloir le devancer sur les conclusions relatives à sa région ». « Au fond pourtant [ajoute-t-il dans sa lettre du 6 février] j'ai été bien aise de savoir que nous étions arrivés à peu près au même avis : le Chablais probablement ou au moins possiblement de [= en] recouvrement, et les Préalpes certainement pas ». Le schéma qu'il donne dans sa lettre (Fig. 11) atteste qu'il nomme « Chablais » le massif de la Brèche (du Chablais) - qu'il fait venir de loin -, et sous le nom de « Préalpes » l'ensemble des unités situées sous le massif précédent.
Marcel Bertrand remarque cependant qu'au-dessus du « recouvrement » de la Brèche, on trouve des « couches rouges » du Crétacé supérieur ; or ce faciès a été rencontré dans le massif du Môle. qu'il tient pour être autochtone ! Il est donc conduit à un dispositif compliqué (Fig. 11) qui le laisse perplexe : l'unité de la Brèche, allochtone venu de l'est, formerait un « noyau anticlinal », sorte de tête plongeante dans le flysch autochtone, replissé autour de ce « noyau ».
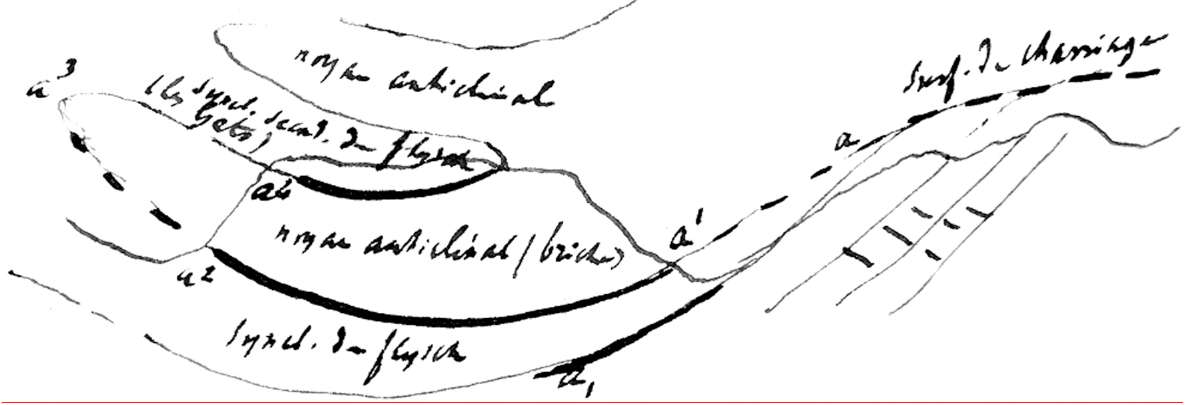
Fig. 11. Schéma extrait d'une lettre (6/2/1894) de Marcel Bertrand à Wilfrid Kilian [Archives de l'Académie des sciences, Paris : « M. Bertrand » in A. Lacroix, 1 J-22, t. III]. Proposition d'explication du charriage, du SE (à droite) au NW (à gauche), de la Brèche du Chablais sur le Flysch, supposé parautochtone et couverture plus ou moins décollée des calcaires mésozoïques « helvétiques » (à droite).
À l'époque (début 1894), Schardt, comme Lugeon, envisagent que l'ensemble des Préalpes (Brèche comprise, évidemment) est allochtone. Dans la lettre à Kilian, Bertrand les juge « capables avec leur enthousiasme de ne pas avoir réfléchi aux détails de cette question » ! Il est cependant ébranlé, puisque, dans la même lettre, il n'exclut plus l'allochtonie du Môle : « Il est évident pour moi, d'après l'étude du Môle, que si les Préalpes sont de recouvrement [c'est nous qui soulignons], les collines qui prolongent la base du Môle jusqu'à Faucigny et les Voirons [cf. Fig. 10] n'en sont pas » ; elles « ne seraient en tout cas que des saillies du substratum » autochtone.
L'appartenance du Môle aux « Préalpes » et l'allochtonie de celles-ci semblent admis par Marcel Bertrand en 1895. Un texte d'Otto Wilckens (1908) en témoigne (traduit de l'allemand) : « je me souviens de l'étonnement incrédule que, jeune étudiant, j'éprouvais lorsque E. Ritter [géologue de Genève], le semestre d'été 1896, lors d'une excursion dans le Vergy [la chaîne du Bargy, au sud-ouest de Cluses] nous racontait que Marcel Bertrand croyait que la montagne du Môle était venue du Sud en passant par-dessus le Mont-Blanc » [« Ich erinnere mich noch des ungläubigen Erstaunens, das... Marcel Bertrand glaube, der Môle sei von Süden über der Montblanc herübergekommen »].
Une lettre de Bertrand à Schardt (in Trümpy et Lemoine, 1998), datée du 11 juin 1897, laisse cependant perplexe, quand on lit : « Quant aux Préalpes [il exclut certainement la Brèche de cette appellation], je n'avais jamais songé à y voir le produit d'un charriage, et je crois même pouvoir ajouter qu'avant vos derniers travaux et ceux de Lugeon, une pareille idée aurait été une véritable folie ».
On est étonné de cette phrase, après le témoignage de Wilckens, qui semble prouver que, l'été 1895 (les dates possibles sont dans le créneau juillet-octobre), Bertrand aurait fait sa déclaration devant Ritter, lors de leur campagne commune. Et, comme le soulignent Trümpy et Lemoine (1998) : « Sur la carte [cf. Fig. 9] accompagnant son article de 1884 sur la nappe de Glaris [Marcel Bertrand] avait bel et bien représenté la majeure partie des Préalpes (du moins leurs roches mésozoïques, sans les flyschs qui les recouvrent), y compris les klippes savoyardes des Annes et de Sulens, comme appartenant à des "lambeaux de recouvrement", c'est-à-dire à des nappes de charriage »...
Doit-on voir, dans cette lettre de 1897, une défaillance de mémoire, ou un premier indice du futur dérèglement mental de son auteur ?
Les Annes et Sulens. Ces deux grand lambeaux, où figurent des roches carbonatées du Trias-Lias, sont situées à l'ouest du Mont-Blanc et couronnent la série crétacée-éocène « dauphinoise » (cf. Fig. 9). Alphonse Favre (1849, 1867) avait déjà observé, sans tenter de l'expliquer, leur situation apparemment supérieure.
Le schéma de 1884 de Marcel Bertrand indique clairement leur allochtonie. Toutefois, en 1895, dans des remarques faites à Haug et Kilian qui traitent de cette question, il se montre circonspect : « l'ordonnance périphérique des écailles autour du massif de Sulens » lui semble « un obstacle à toutes les explications proposées » (dont la sienne propre de 1884 !), que ce soit une « surrection sur place » de ce massif de Trias-Lias, ou une provenance lointaine. Attitude décevante !
En dépit des hésitations de sa pensée, et en laissant, d'abord à Schardt, ensuite à Lugeon, la gloire d'avoir prouvé l'allochtonie et la situation tectoniquement supérieure des nappes des Préalpes, on peut créditer Marcel Bertrand des intuitions suivantes : 1) en 1884, d'avoir proposé la situation « de recouvrement » pour toute la zone dont font partie les Préalpes ; 2) d'avoir noté la position allochtone des klippes des Annes et de Sulens, toujours en 1884 ; 3) d'avoir lancé le premier, peut-être sous la forme de boutade, l'hypothèse de la position élevée de la nappe de « la Brèche du Chablais » et d'avoir dessiné dans une lettre à Kilian sa provenance d'au-delà du Mont-Blanc. Bien qu'elles aient été vite dépassées, ces propositions montrent que, s'il n'avait pas sombré dans la maladie, Marcel Bertrand se serait vite rallié à l'allochtonie généralisée des Préalpes.
Sur son schéma de 1884, Marcel Bertrand avait indiqué par de petits cercles (Fig. 9), au nord des « recouvrements » de Suisse centrale, des « blocs exotiques », présentant des « caractères pétrographiques originaux », dont Émile Haug venait de lui signaler l'existence d'après les travaux des géologues suisses. Leur situation (ils sont « enfoncés dans le Flysch ») s'accordait, pour Bertrand, avec l'hypothèse de « recouvrements ». C'est cependant Edmund C. Quereau qui - selon Haug (1899) - le premier, établit la superposition anormale des « Klippes d'Iberg » au-dessus des nappes, en position la plus externe, des Hautes Chaînes calcaire du domaine « helvétique ».
Marcel Bertrand aborda cette question plus longuement dans son mémoire de 1890 (imprimé en 1908). La dimension de ces éléments « varie depuis celle de véritables montagnes, comme le Stanzerhorn [au sud de Lucerne], jusqu'à celle de simples blocs, qui semblent jetés à la surface du Flysch. Ces îlots [de Trias-Jurassique] sont connus sous le nom de Klippen ou « écueils » ; ils sont considérés comme des saillies du substratum ou des percées de celui-ci ». Bertrand est au contraire tenté de les mettre en recouvrement. « Mais si ces îlots étaient réellement superposés [au Flysch tertiaire], il faut avouer qu'il est impossible de comprendre d'où ils sont venus. » Certains blocs du Malm ou du Lias rappellent bien « le faciès alpin plus que le faciès helvétique », ce qui traduit « certainement un transport », mais Bertrand conclut en Normand : « comme rien jusqu'ici, ni pour les Klippen, ni pour les blocs exotiques, n'autorise un tel rapprochement avec les masses de recouvrement, mais comme un tel rapprochement n'est cependant pas impossible, je me contente de mentionner ce problème encore pendant de la géologie suisse ».
Son hésitation sera encore perceptible dans les remarques - les dernières sur les Alpes suisses - qu'il fera en juin 1900 à un mémoire d'Henri Douvillé sur les environs d'Interlaken. Celui-ci avait considéré que la « nappe des blocs et des massifs exotiques » [les Klippen] se plaçait sous « la masse schisteuse de l'Oberland » [= les nappes helvétiques]. Pour Bertrand, c'est l'inverse qui doit être vrai, comme il est admis généralement à cette époque. Le dispositif observé par Douvillé résulterait ainsi d'un pli couché coinçant secondairement la « nappe des Klippen » - « si elle existe ! », ajoute-t-il -, entre le substratum et le grand recouvrement de l'Oberland.
N'ayant pas étudié lui-même cette zone, il ne veut donc pas conclure, malgré ses intuitions.
En tant que géologue, Marcel Bertrand fait connaissance en septembre 1881 avec les Alpes dauphinoises, lors d'une Réunion extraordinaire de la Société géologique. Des environs de Grenoble, les participants remontent vers l'est la vallée de la Romanche. Marcel peut assister aux discussions entre Charles Lory, le professeur de Grenoble, adepte des grandes failles, et son collègue de Lausanne, Eugène Renevier qui, travaillant dans les Alpes vaudoises, privilégie les plis. Après avoir atteint puis descendu la Maurienne, la caravane arrive aux environs d'Allevard : la réception finale se fait, en musique, dans une clairière de La Tailla, d'où la vue embrasse le proche massif de Belledone et, à l'ouest, la Chartreuse. À l'issue de la manifestation, le jeune Marcel Bertrand, à cette époque en pleins travaux dans le Jura, a ainsi fait connaissance avec certains problèmes et avec les principaux géologues des Alpes occidentales.
La mort de Charles Lory est annoncée à la Société géologique le 4 mai 1889 par le président, Hébert, qui « espère que M. Bertrand voudra bien se charger de célébrer le souvenir » du disparu : ce qui est fait le 13 juin, cinq semaines plus tard, par un éloge remarquablement documenté. En 1863, Lory avait donné une première esquisse des Alpes françaises entre Briançon et le Mont-Blanc (Fig. 12), où les grandes divisions étaient déjà indiquées. La « zone houillère » s'enfonçait vers le sud sous sa couverture du Briançonnais (« 3e zone »), en marquant l'axe de la chaîne. De grandes fractures nord-sud la séparaient : à l'est des « Schistes lustrés » métamorphiques (« 4e zone »), triasiques pour Lory ; à l'ouest, de ce qu'on nommera plus tard « Subbriançonnais » (« 2e zone »), puis de la couverture du massif ancien du Pelvoux (« 1e zone »), plus occidentale.
La mort de Lory amène le Service de la Carte géologique, dont Michel-Lévy a pris les rênes en 1887, à organiser les levers géologiques sur le nouveau fond au 80 000e dit « de l'État-Major », dont les feuilles ont paru dans les années 1870-1880, après l'annexion de la Savoie. Au début de l'été 1889, Bertrand et son ami Potier rejoignent, dans la région de Modane, Zaccagna et Mattirolo, géologues du Comité géologique de Rome, accompagnés de S. Franchi. Le but en est de s'accorder sur l'âge des Schistes lustrés : triasiques pour les Français à la suite de Lory, paléozoïques, - ou au moins, anté-houillers - pour les Italiens, qui avaient, en 1887, déjà tenté en vain de convaincre le professeur de Grenoble. Cette fois, au vu du terrain, Bertrand et Potier se rallient au point de vue des Italiens.
Nous savons, par une longue lettre (22 décembre 1889) adressée à Kilian, qui vient d'être nommé chargé de cours à Grenoble, que Marcel Bertrand a dû rester dans les Alpes pendant l'été, car il a travaillé en Vanoise : « ce que j'ai pu voir jusqu'ici [...] laisse de bien grandes obscurités », car « je n'ai pas pu arriver à concevoir une succession lithologique constante ». Pour les « calcaires du Briançonnais », il admet, après Lory, qu'ils se placent, normalement, au-dessus des gypses et cargneules, « mais dans tout le massif de la Vanoise, cela m'a l'air d'être le contraire », surtout autour de Pralognan et de Tignes. Notons que, sans le savoir, Marcel Bertrand a observé la future « nappe des gypses » qui marque la base de la « nappe des Schistes lustrés ».
Echelle 1: 2.000.000
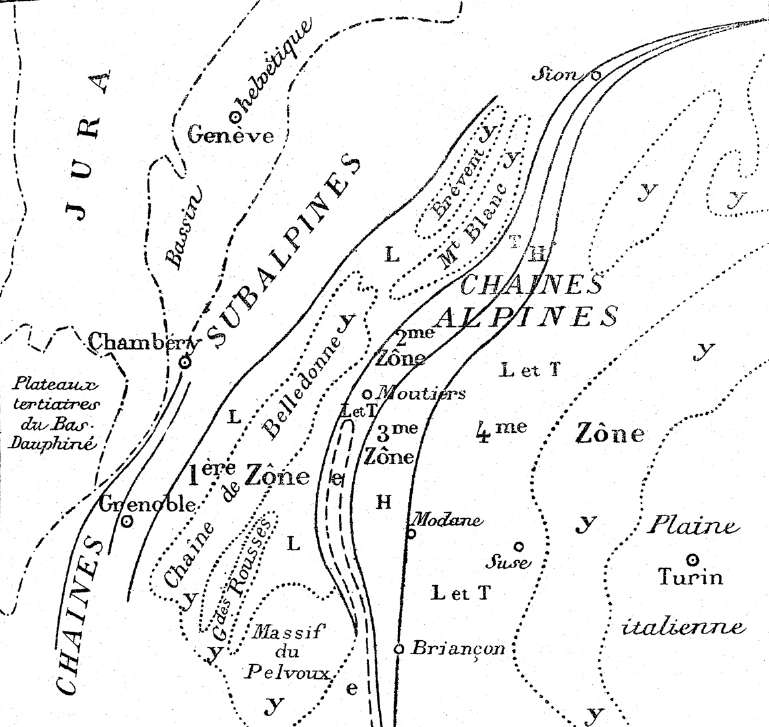
Fig. 12. « Zones » de Charles Lory (1881) dans les Alpes occidentales. 3e zone : Briançonnais-Zone houillère ; 4e zone : Schistes lustrés et massifs internes [Extrait du C.R. de la Réunion extr. de la Société géologique de France, 1881, cf. p. 655].
Se faisant le porte-parole du Service de la Carte géologique (auquel, devenu professeur à l'École des mines, il n'est plus « attaché »), Marcel Bertrand fixe comme « objectif dominant » d'assurer pour l'année 1890 la mise au point de deux « feuilles de Lory », Bonneval et Saint-Jean-de-Maurienne (en fait, elles paraîtront en. 1895). Il demande à Kilian de participer à ce programme, principalement en élucidant la question de l'âge (triasique ou jurassique) des « calcaires du Briançonnais », entre Guillestre au sud et Modane au nord. Il lui demande aussi de suivre au nord de l'Arc la bande nummulitique nord-sud de Saint-Michel-de-Maurienne en direction nord, vers Moûtiers. Potier et lui vont étudier, là, une bande de « Schistes lustrés » (c'est l'actuelle « zone valaisanne »). À cette date, il n'est pas encore question de l'implantation de Pierre Termier en Vanoise.
Marcel Bertrand va donc s'attacher à lever l'essentiel des feuilles au 80 000e des hautes montagnes loin au nord-est de Grenoble (feuille « St-Jean-de-Maurienne ») et à l'est de Chambéry (feuille « Albertville ») et la prolongation (feuille « Bonneval-Tignes ») jusqu'à la crête frontière. L'étude du massif savoyard du Môle l'en détournera un temps en 1892.
Cette cartographie (Fig. 13) concernera donc un grand quadrilatère de 80 km (nord-sud) sur 40 km (est-ouest). Le problème essentiel sera d'établir les rapports stratigraphiques et structuraux entre la zone des Schistes lustrés et, plus à l'ouest, l'ensemble « zone houillère »-Briançonnais. Ces difficiles problèmes seront repris (François Ellenberger, 1958) au milieu du XXe siècle (Fig. 14).
Ce programme implique un certain nombre de collaborateurs. À partir de l'été 1890, Pierre Termier (1859-1930) va s'occuper du massif de la Vanoise : les deux hommes vont se rejoindre au chalet du Saut, près du glacier de Grébroulas. Entre Marcel Bertrand et celui qui va devenir son disciple favori et son continuateur, l'échange est continu, au cours d'innombrables courses. Il y aura aussi Joseph Révil (1849-1931), le pharmacien de Chambéry : cet excellent géologue amateur, qui animera la Société d'Histoire naturelle et l'Académie de Savoie, nourrissait « une admiration sans bornes » (Léon Moret, 1931) pour Marcel Bertrand. Celui-ci l'avait accompagné, un jour de 1881, sur la colline de Montagnole, au sud de Chambéry, et il lui expliqua, à l'aide d'une coupe crayonnée, face au paysage, sur la table de marbre d'un restaurant, la structure, jusque-là énigmatique, de l'arête Nivolet-Revard avec son empilement de plis couchés, qui domine à l'est le lac du Bourget.
Il y aura aussi Wilfrid Kilian, qui occupe maintenant la chaire de géologie de Grenoble. Familier de Bertrand dans le Jura puis en Andalousie, il va être son fréquent accompagnateur, et Marcel le suivra inversement en Briançonnais et dans l'Ubaye. Une grande affection unira les deux hommes : leur courrier en témoigne. On trouvera aussi le minéralogiste Albert Offret (1857-1933), qui était aussi en Andalousie, et maintenant à la faculté de Lyon ; Alfred Potier encore, qui parcourt les cimes entre ses travaux de physique, se souvenant qu'il a été longtemps au Service de la Carte géologique. Pierre Lory (1866-1956), préparateur de son père puis de Kilian, était, lui, un alpiniste réputé. Familier des sommets de plus de 3 000 m (il fit ainsi, en 1893, seul, l'ascension du mont Pourri, 3 788 m !) il signalait ses observations à Marcel Bertrand qui, lui, préférait s'intéresser aux flancs des hautes cimes, au-dessous des neiges. L'un et l'autre furent accompagnés par le guide Blanc. C'est probablement avec celui-ci qu'une aventure, qui aurait pu être tragique, survint l'été 1891.
Termier (1908) a donné l'extrait d'une lettre que Marcel adressa à sa femme le 5 août. Il y conte qu'il s'était engagé, avec Révil et son guide, le groupe n'étant pas encordé, sur le glacier de Rhêmes, dans le massif, autour de 3 000 m d'altitude, dominant au nord l'actuelle localité de Val d'Isère. Subitement, après le passage de ses compagnons, Marcel sentit la neige céder sous son poids. Il se retrouva au fond d'une crevasse de 15 m de profondeur, où il passa « un peu plus d'une heure », par chance en position verticale, « les pieds dans l'eau et retenu par les coudes et les épaules ». Pendant que le guide allait chercher des secours, Révil, « bien plus angoissé et malheureux », lui faisait « une conversation un peu dénuée d'intérêt ». On voit d'ailleurs mal ce qu'il aurait pu faire d'autre, n'ayant sans doute pas la ressource, lui, de débiter sans fin les strophes de La Légende des Siècles, exercice familier à Marcel ! Descendu au nord vers le val d'Aoste, ce dernier se reposa quelques jours au presbytère de Notre-Dame de Rhêmes avant de regagner Paris. Dans une lettre à Daubrée (Bibl. Inst. de France, Ms. 2421), écrite le 21 août de Saint-Briac, près de Dinard, où il devait reprendre ses esprits, Marcel indique qu'il est « remis de sa chute » et ajoute que les journaux lui ont fait « la réputation imméritée d'imprudence », alors que le guide avait parlé d'un « col tout à fait inoffensif ». Doit-on le croire ? Termier, lui, écrit que ce fut « imprudemment ».
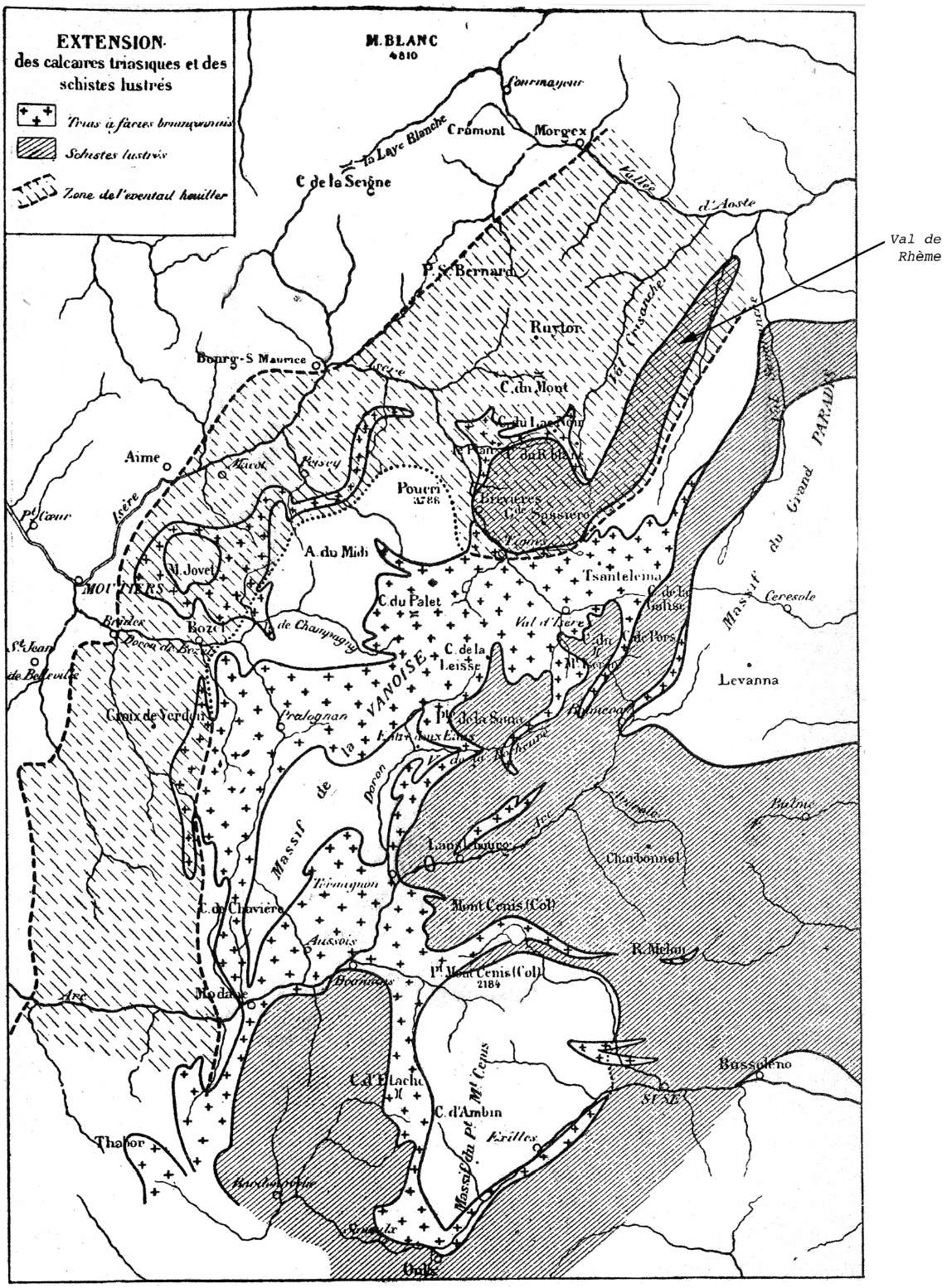
Fig. 13. Carte schématique de la zone étudiée par Marcel Bertrand (Vanoise- Schistes lustrés). Le Mont Jovet (Fig. 16) et la Grande Sassière sont sur le parallèle de Moutiers. La Sana (Fig. 18) est au centre du quadrilatère de cette carte [Extrait de M. Bertrand, 1894b, pl. VII].
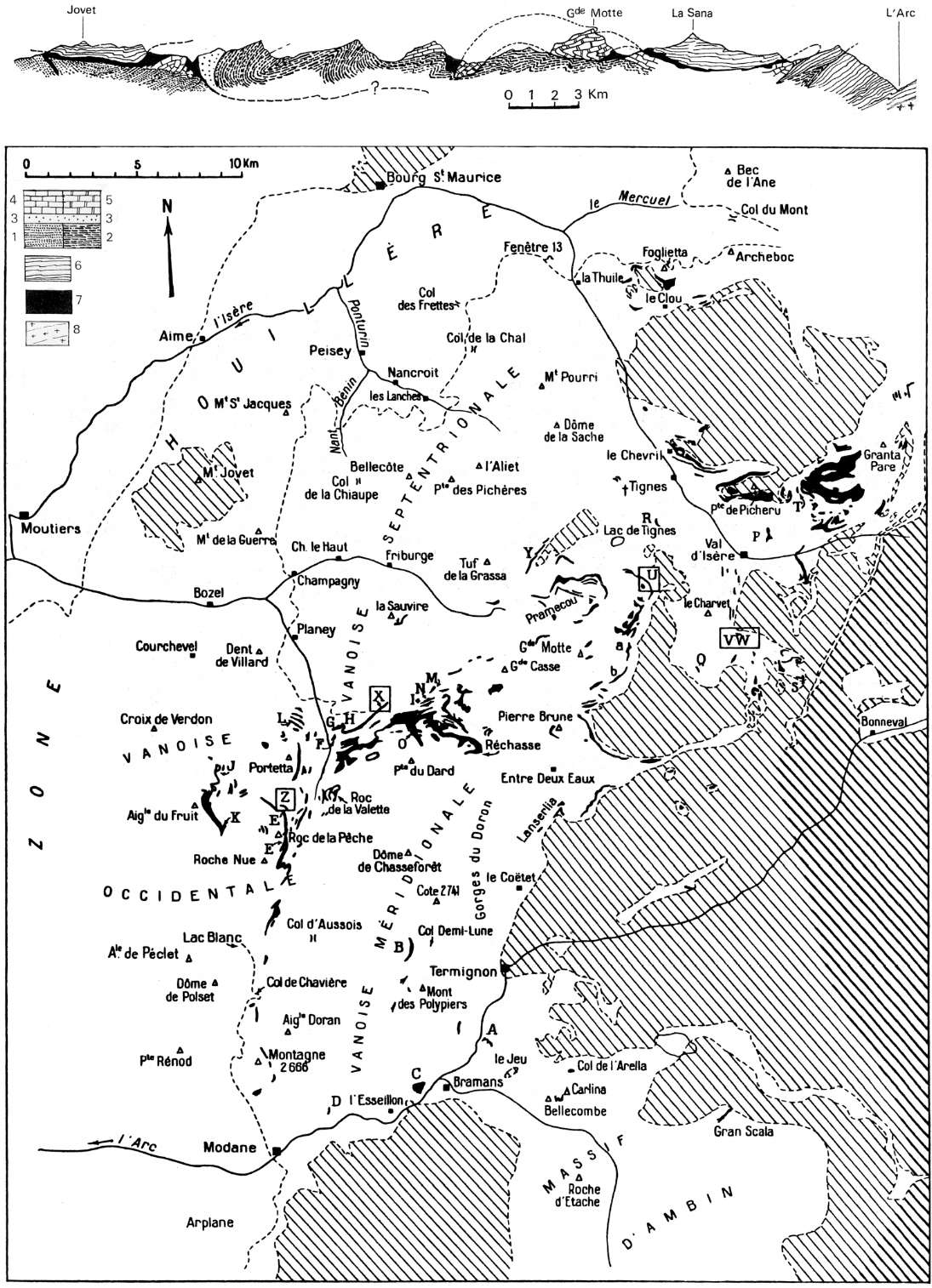
Fig. 14. Schistes lustrés et Vanoise, selon F. Ellenberger. À comparer avec la fig. 13. Hachuré fin : Schistes lustrés ; noir : calcaires post-triasiques de Vanoise ; hachuré épais : « socle » du Grand Paradis [Extrait de F. Ellenberger (1958), fig. 54]. La coupe (en haut) est extraite de J. Debelmas, 1974, Géologie de la France, t. 2, p. 418. 1-2: Permo-Houiller (2 : métamorphique) ; 4-5 Mésozoïque (5 : faciès « piémontais ») ; 6 : Schistes lustrés piémontais ; 7 : gypses triasiques ; 8 : massif cristallin interne (Grand Paradis).
De 1889 à 1895, Marcel Bertrand garde le silence sur les résultats de son travail. Est-ce dû à ses hésitations ou aussi au désir de ne pas gêner son disciple Termier dans son étude de la proche Vanoise ? Ce ne sera qu'au début de 1895 que paraîtront presque simultanément ses Etudes dans les Alpes françaises, dont les deux parties occupent plus de 100 pages dans le Bulletin de la Société géologique (Bertrand, 1894a). On va en rappeler les principales conclusions.
La « structure en éventail des Alpes françaises » généralise une vieille observation d'Alphonse Favre au niveau de la vallée de l'Arc. Pour Marcel Bertrand, « le trait caractéristique et essentiel [c'est lui qui souligne] de la structure des Alpes Françaises est la structure en éventail. » Sauf de rares exceptions, les plis de l'ouest se couchent vers la France et les plis de l'est se couchent vers l'Italie (Fig. 15). Il précise : « Jusqu'à maintenant, aucun des géologues qui ont étudié le versant oriental [la zone des Schistes lustrés] n'a cru y reconnaître l'évidence d'une structure plissée », car « on n'y voyait qu'une immense succession d'assises régulièrement superposées ». Marcel Bertrand ne semble pas avoir séparé chronologiquement les déversements divergents, qu'ils soient vers l'est ou vers l'ouest. En fait, Pierre Termier montrera que les choses sont plus compliquées : en 1903, quand il définit sa « quatrième écaille », qui couronne l'empilement des nappes de la région de Briançon, il constate que cette unité supérieure comporte des « gneiss » qui « ne peuvent provenir que [...] de la zone italienne, où les plis sont actuellement tous tournés en sens inverse, c'est-à-dire vers l'est. Ce serait la preuve d'un mouvement antérieur à l'éventail alpin et ayant eu lieu par-dessus son emplacement. »
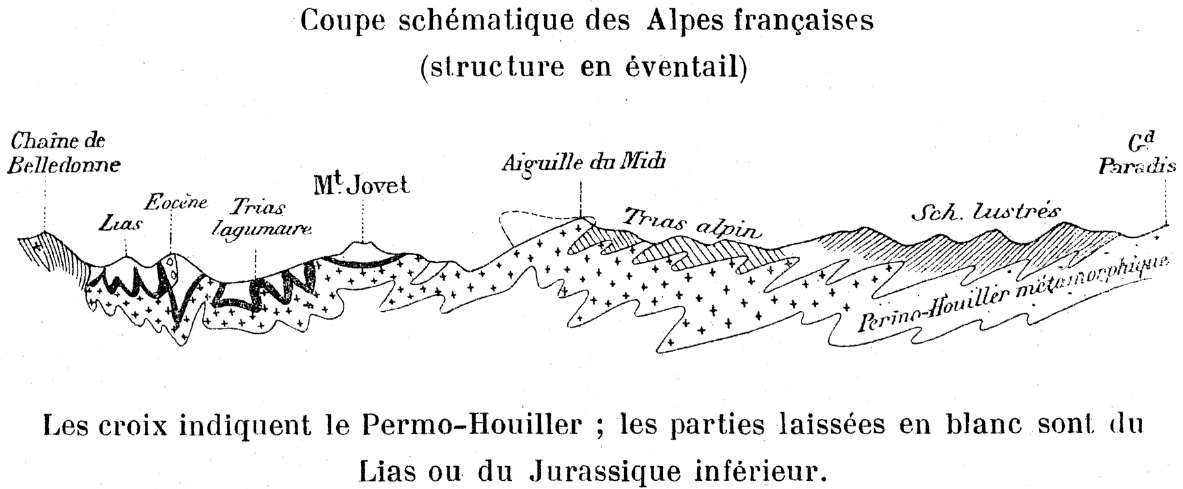
Fig. 15. Coupe schématique des Alpes françaises (structure en éventail) [Extrait de M. Bertrand, 1894b].
Quand il définit « l'éventail alpin », Marcel Bertrand considère sa région d'études mais il suppose que ce dispositif se prolonge vers le nord (ce que Haug contestera) et vers le sud. Et, sur ce point, Kilian lui exprime sa perplexité, ce qui amène Bertrand à insister (lettre du 9 février 1894) : « pour moi, le fait de l'éventail prime tous les autres » ; vers le sud, certains anticlinaux de la « bande houillère » [= la « zone houillère », axe de la chaîne], peut-être masqués par le Nummulitique, doivent se bifurquer « pour entourer le Mercantour », de part et d'autre duquel les déversements opposés doivent s'observer. Et Marcel insiste : « Cela doit être ; je m'en rapporte [...] à vous pour savoir si cela est » [c'est lui qui souligne].
De surcroît, Marcel Bertrand définit la « structure amygdaloïde » de certains massifs. Ces amygdales seraient, soit anticlinales (l'axe de la Vanoise, le massif d'Ambin, etc.) et apparaissant au milieu de zones synclinales, soit (inversement) seraient des étalements synclinaux (la Grande Sassière, le mont Jovet) au milieu de zones anticlinales. Dans les deux cas, ces élargissements structuraux seraient enveloppés, en plan, par des plis sinueux. Cette singulière conception ne fit pas long feu, à partir du moment où la structure en nappes de la zone Briançonnais-Vanoise fut soupçonnée. Termier (1907) considéra les « massifs amygdaloïdes » de Bertrand comme des « carapaces de nappes », c'est-à-dire des surfaces de contacts anormaux replissées.
Ce terme est appliqué à des formations diverses que l'on rencontre tout le long des zones internes des Alpes. Marcel Bertrand se heurte à ces roches singulières, qu'il doit cartographier à l'est de la Vanoise : ce sont là les « Schistes lustrés du Mont Cenis ». Pour lui (Bertrand, 1896), ces « schistes quartzo-sériciteux, ordinairement calcifères », d'une très grande puissance, représenteraient un flysch particulier, précoce. Les « roches vertes » intercalées en concordance dans ces schistes sont d'anciennes coulées ou des tufs (Bertrand, 1894). Quant à la serpentine associée, vu sa « nature éruptive », elle est « injectée ». En 1896, il envisage que les Schistes lustrés représentent « à la fois le Lias (peut-être même le Jurassique) et au moins la partie moyenne et supérieure du Trias ».
On sait actuellement qu'il s'agit des « Schistes lustrés piémontais » : les intercalations de « roches vertes » et de serpentine résultent de la fragmentation de leur ancienne base ophiolitique, socle d'un océan jurassique disparu. En se basant sur d'étroites analogies des suites de faciès entre Schistes lustrés piémontais à « roches vertes » et successions supra-ophiolitiques « ligures » de l'Apennin, on attribue à ce type de Schistes lustrés un âge allant du Jurassique moyen au Crétacé supérieur.
Avant 1900, Marcel Bertrand n'avait aucun moyen d'en juger. Comme ses prédécesseurs, il s'est efforcé de situer chronologiquement les Schistes lustrés « de type Mont-Cenis » par rapport à la succession stratigraphique de la proche Vanoise, fort mal connue alors et qui était censée comporter, pour lui comme pour Pierre Termier :
-
1, un puissant « Permo-Houiller » détritique, ayant fourni des flores du « Houiller » à sa partie occidentale, et qui devient de plus en plus métamorphique vers l'est, en s'approchant des Schistes lustrés ;
2, des quartzites clairs, parfois verdâtres, repère unanimement admis du Trias inférieur ;
3, une série surtout carbonatée aux faciès très variables ; ces « calcaires de la Vanoise », déjà tenus pour triasiques par Charles Lory, sont considérés par Bertrand et Termier comme du Muschelkalk, avec un niveau de gypses ;
4, de puissants gypses et cargneules correspondraient au Keuper.
La situation des Schistes lustrés par rapport à tel ou tel terme de la succession ci-dessus a donné lieu à des interprétations diverses.
Pour Charles Lory, ils doivent être plus jeunes que le Trias carbonaté et gypsifère (termes 3 et 4 de la colonne ci-dessus), avec lequel ils sont en contact dans le sud du massif d'Ambin (ou « Petit-Mont-Cenis » sur la partie basse de la Fig. 13), plus précisément au nord-ouest d'Oulx [Ulzio]. En 1889, les Italiens Zaccagna et Mattirolo montrent à Potier et à Bertrand que des quartzites du Trias basal (terme 2 de la colonne ci-dessus) s'intercalent entre calcaires triasiques et, plus haut, Schistes lustrés. Sans penser à des contacts tectoniques, ces messieurs s'accordent pour supposer que la série est renversée. Les Schistes lustrés doivent être le terme le plus ancien, paléozoïque, voire « archéen » : « les Schistes lustrés du Mont-Cenis sont bien certainement antérieurs au Trias » (Bertrand, 1889).
Par la suite, la complexité des coupes observées amène Bertrand, spécialement en 1893, année où Pierre Termier l'accompagne parfois, à remettre en question cette conclusion : « Il faut revenir pour l'âge [des Schistes lustrés] à l'ancienne opinion de Lory et de Gerlach » (Bertrand, 1894), c'est-à-dire à une attribution au Trias. Marcel en avise Kilian (lettre du 6 février 1894), qui, lui aussi, avait parfois été avec lui l'été 1893 : « Vous avez peut-être pu voir que j'ai brûlé mes vaisseaux pour les schistes lustrés [...], tous les massifs pris isolément imposaient presque la solution triasique [et] pour tous la solution paléozoïque menait à des complications invraisemblables et même pour certains contradictoires [...]. J'espère que, s'il vous reste encore des doutes, nous ne tarderons pas à être du même avis ». Et, le 9 février suivant, Kilian ayant dû réitérer ses réticences (il sera long à se rendre), Marcel lui propose de faire une tournée dans les Schistes lustrés pour le convaincre : « Donc à la disposition de usted », boutade tirée de leur ancien commun voyage andalou !
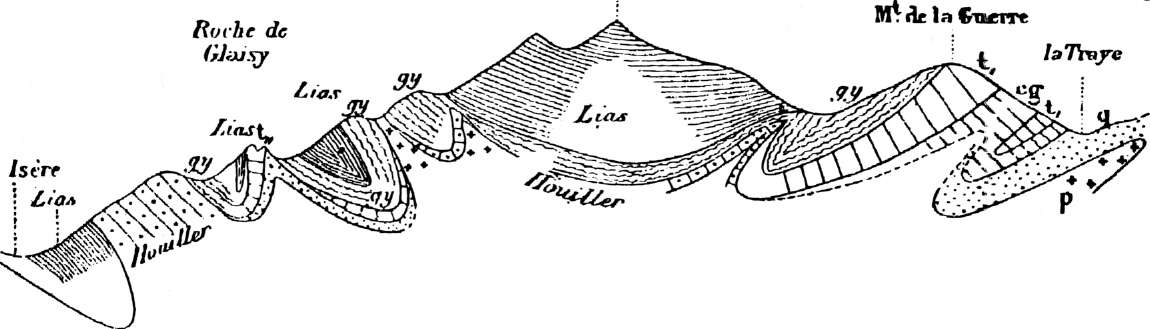
Fig. 16. Coupe du mont Jovet (Schistes lustrés attribués au Lias, superposés à « l'éventail alpin ») [Extrait de M. Bertrand, 1884b].
Deux affleurements de Schistes lustrés isolés sur la Vanoise lui semblent attester l'âge mésozoïque des schistes. C'est d'abord le cas du mont Jovet (Fig. 16). Ce paquet circulaire de Schistes lustrés au faciès un peu particulier et peu métamorphiques, couronne la « zone houillère » à l'est de Moutiers. Zaccagna avait considéré que ces schistes, qu'il tenait pour paléozoïques, formaient un « écueil », paléo-relief auquel s'était adossé le Trias environnant. En 1892, Alfred Potier, s'y promenant, constate qu'en fait les schistes du mont Jovet reposent à plat sur le Trias, ce qui les lui fait attribuer au « Lias ». Avisé, Bertrand, après analyse de détail, confirme en 1893 cette observation. Il propose de voir là un exemple de « structure amygdaloïde » : « le Mont Jovet serait un noyau synclinal ouvert entre les branches étirées d'un même pli anticlinal ».
Le cas de la Grande Sassière (Fig. 13), 40 km à l'est du mont Jovet, va conforter Marcel Bertrand dans son argumentation. Ce haut massif circulaire est formé par une accumulation de près de 1 000 m de Schistes lustrés. Sur presque tout leur pourtour, ceux-ci « sont incontestablement superposés au Trias [de type Vanoise], et ils passent latéralement au Trias » (Fig. 17). Nous savons actuellement (cf. Ellenberger, 1954) que les affleurements du mont Jovet et de la Grande Sassière sont des lambeaux isolés de la grande « nappe des Schistes lustrés ».
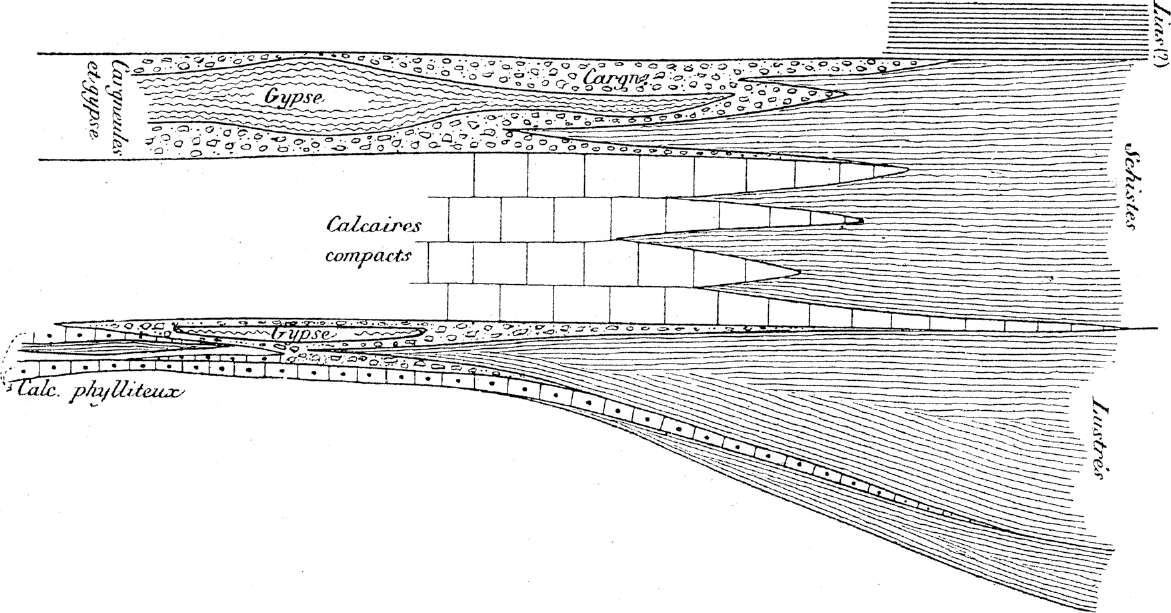
Fig. 17. Schéma théorique du passage supposé du Trias calcaire aux Schistes lustrés [Extrait de M. Bertrand, 1894b].
Ainsi le type d'argumentation utilisé par Bertrand (comme par ses contemporains), basé sur d'apparentes successions stratigraphiques et sur de prétendus « passages latéraux », n'a aucune valeur : même si, en ayant attribué aux « Schistes lustrés du Mont-Cenis » à « roches vertes » un âge mésozoïque (Trias supérieur à Jurassique), l'opinion finale de Marcel Bertrand peut sembler représenter un progrès, par rapport à celle de l'âge « paléozoïque », défendue par les géologues italiens à l'époque.
À l'appel de Marcel Bertrand, Pierre Termier vient étudier la Vanoise, spécialement du point de vue pétrographique. Il y consacre une longue campagne en 1890, dont une importante publication apportera en 1891 les résultats. Si Marcel Bertrand et Pierre Termier ne firent guère avancer l'étude stratigraphique, ni ne découvrirent guère de fossiles, cela est dû essentiellement au métamorphisme plus ou moins fort qui atteint, non seulement les Schistes lustrés, mais aussi les roches de la Vanoise (domaine briançonnais). Les deux hommes « auront le très grand mérite de rénover la pétrographie alpine en redécouvrant la réalité du métamorphisme alpin » (Ellenberger, 1958).
On revenait en effet de loin ! Lors de la Réunion extraordinaire de la Société géologique en 1861, Charles Lory avait protesté avec véhémence « contre la tendance qui a porté beaucoup de géologues à faire intervenir à chaque pas, dans les Alpes, des actions métamorphiques, dont il n'existe aucune preuve réelle ; à voir des sédiments houillers ou jurassiques modifiés dans des roches purement cristallines et feldspathiques, que, partout ailleurs, on appellerait gneiss ou micaschistes, et sur l'ancienneté desquelles on n'élèverait pas le moindre doute ». L'air léger des cimes (une séance de la Réunion se tint, le 4 septembre, en plein air devant Modane) n'adoucit pas l'irascible professeur de Grenoble, quand l'abbé Chamousset, comme le Suisse Bernhard Studer (qui présidait l'excursion) demandèrent si « les schistes micacés et les gneiss observés à la base des grès à anthracite ne devaient pas être considérés comme des grès houillers métamorphiques ». Ce fut cependant le jeune ingénieur des mines de Chambéry, Hippolyte Lachat (dont Termier a rapporté les prémonitions, restées inédites), qui fut durement repris par Lory alors qu'il défendait avec vigueur la liaison des roches feldspathiques et cristallines avec le Houiller : ce qui amènera le départ de la Réunion et l'abandon de la géologie par Lachat.
Un quart de siècle plus tard, au terme de ses études, Marcel Bertrand proclamera à son tour : « Je suis arrivé, comme M. Termier l'a fait pour la Vanoise, à rattacher avec certitude au Permo-Houiller les anciens gneiss chloriteux et micaschistes du Mont Pourri, du Mont Cenis [l'actuel massif d'Ambin] et ceux de Val Grisanche », et il les comparera aux schistes de Casanna, en Suisse. Du fait de l'accentuation du métamorphisme de l'ouest vers l'est et vers le bas, « il est même permis de se demander si les gneiss du Grand Paradis [le massif cristallin des Alpes internes, à l'est de la Vanoise, sous les Schistes lustrés] ne représentent pas un terme plus avancé de métamorphisme des assises permo-houillères ». Bertrand va jusqu'à proposer en 1894 : « Je ne vois pas de raison pour que le dynamo-métamorphisme, qui fait de faux gneiss, ne fasse pas aussi de vrais gneiss. »
Pour lui, le métamorphisme est « certainement dû aux phénomènes de plissement » (Bertrand, 1896). Pierre Termier indiquera que « la même cause de métamorphisme a agi sur tous les terrains ». Ainsi trouve-t-on des roches à « glaucophane » dans les roches basiques, tant dans le Permo-Houiller de Vanoise que dans celles des Schistes lustrés.
Marcel Bertrand a ainsi accepté l'idée de Termier : le « métamorphisme régional » est un phénomène dynamique lié à l'intensité des mouvements orogéniques. Ce « dynamométamorphisme » résulterait de « l'écrasement de la région entre le Mont Blanc et le Grand Paradis, produisant un dégagement de chaleur ». Souvenons-nous qu'en 1906, Termier placera cette orogenèse et le métamorphisme lié, au début de l'Oligocène.
C'est Pierre Termier qui, en 1899, écrira que « la zone des Schistes lustrés tout entière est une nappe venue de l'Est , chevauchant une série de lames de charriage [du Briançonnais] poussées vers l'Ouest, l'ensemble étant ensuite replié en éventail. » Après diverses péripéties, Kilian et Termier démontrent en 1920 l'existence de cette unité tectonique majeure des Alpes occidentales. La confirmation définitive suivra la découverte de résidus, paléontologiquement datés, de roches allant du Trias au Paléocène (cf. Ellenberger, 1958), sous les Schistes lustrés de la Vanoise et au-dessus du Permo-Houiller.
Marcel Bertrand, en 1894, avait rassemblé des observations de base qui auraient pu lui permettre d'affirmer, le premier, l'existence de cette nappe. Son allergie à de tels « recouvrements » (alors qu'il avait déjà proposé sa vision de Glaris et découvert des charriages en Provence !) semble être due essentiellement à sa conception de « l'éventail alpin » : cette notion semblait obliger les éléments structuraux situés à l'est de cet illusoire « axe » alpin (« zone houillère ») à se déverser et à se déplacer uniquement vers l'est.
Jusqu'à l'été 1893, Bertrand reste convaincu par l'argumentation de Zaccagna et Mattirolo en faveur de l'âge paléozoïque des Schistes lustrés et Pierre Termier, lors de son étude en 1890, partageait cet avis. Or, à quelque 7 km au sud de l'actuel Val-d'Isère, le massif de Schistes lustrés de la Sana (à l'est du lieudit Entre-Deux-Eaux) « dans son ensemble », repose à plat sur les « calcaires triasiques » de la Vanoise : le fait s'observe, sur plus de 2 km, le long du vallon de la Rocheure (Noter que cet affleurement de la Sana a été relié à la masse des Schistes lustrés, sur le schéma (Fig. 13) de Bertrand, alors qu'en réalité (Fig. 14, tirée d'Ellenberger, 1958) il en est séparé).
Pierre Termier (1891) concluait de ce fait à un refoulement vers l'ouest des Schistes lustrés, prétendument « paléozoïques » à cette date, refoulement par-dessus le Trias de Vanoise. Sans qu'il en ait eu conscience, c'était la première amorce de sa future « nappe des Schistes lustrés » !
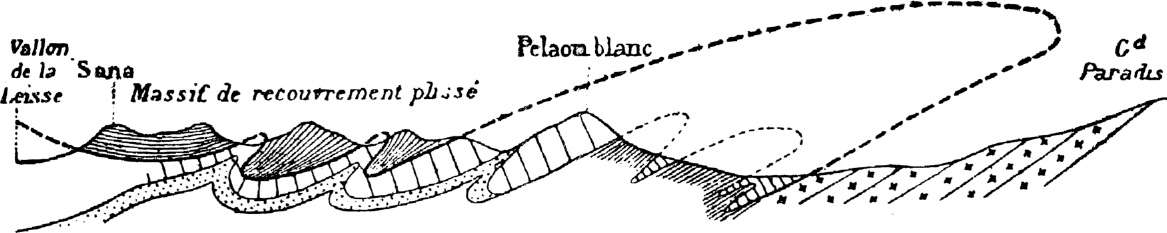
Fig. 18. Coupe allant du Grand Paradis à la Sana (cf. Fig. 13) dans l'hypothèse d'un « recouvrement » du « Trias » de la Vanoise par les Schistes lustrés [Extrait de M. Bertrand, 1884b]. Croix, socle du Grand Paradis ; hachuré serré, schistes lustrés, supposés (dans cette figure) anté-triasiques ; ponctué, Trias inférieur ; hachuré oblique, Trias calcaire de la Vanoise.
Début 1894, Marcel Bertrand a fini par se convaincre que les Schistes lustrés sont du Trias supérieur. De ce fait, le contact de base des Schistes lustrés de la Sana peut être stratigraphique. Cependant, Termier, qui l'avait accompagné en 1893, avait dû discuter la question avec lui, et Bertrand ne veut pas négliger l'argumentation de son disciple. Il écrit donc : « dans l'hypothèse d'un recouvrement, il faudrait supposer sur le bord du Grand Paradis [massif plus oriental] un grand pli couché vers l'Ouest, alors que tous les pendages sont vers l'Ouest [...], il faudrait supposer que cette masse de recouvrement a été postérieurement affectée d'un système de plis couchés en sens inverse du mouvement principal. Cela n'est pas rigoureusement impossible, mais cela est bien compliqué et bien invraisemblable ». Et il dessine (Fig. 18) la coupe dans l'hypothèse où les Schistes lustrés de la Sana seraient un « massif de recouvrement plissé ». Cette solution « allochtoniste », que Marcel Bertrand élimine à cause de sa prétendue complication, est pourtant la bonne, et elle illustre le proverbe : « Le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable » !
La Grande Sassière, avec sa masse de Schistes lustrés « à roches vertes chloriteuses » est, pour Bertrand, posée « presque horizontalement sur le sommet de l'éventail houiller, ce qui permet d'[en] observer la superposition avec certitude » (Bertrand, 1894) au Trias de Tignes. Dans son compte-rendu de la campagne 1893, il semble maintenir ouverte l'interprétation tectonique : ou « il s'agit d'une immense nappe de recouvrement venue de l'Est » (au moins 20 km de déplacement), ou bien « les Schistes lustrés sont [stratigraphiquement] supérieurs au moins à une partie du Trias ». Comme il croit voir des intrications stratigraphiques entre Trias et Schistes lustrés (Fig. 17), Marcel Bertrand conclut à l'absence de recouvrement. Ce sera à tort, puisque, au cours du XXe siècle, on trouvera dans les termes dits « triasiques », en contrebas des Schistes lustrés de la Grande Sassière, des microfaunes du Crétacé supérieur, qui prouveront l'allochtonie totale de cet immense lambeau.
L'affleurement du mont Jovet (Fig. 16) aurait pu aussi inquiéter Bertrand. Ces « schistes feuilletés » (auxquels il refusait - à tort - de relier les « roches vertes » voisines) sont par lui attribués au « Lias » ; leur faible métamorphisme ne les fera qualifier de « Schistes lustrés » qu'en 1896, dans une réponse à une note de J. W. Gregory. Quoi qu'il en soit, il note que « le froissement extrême des assises horizontales [du mont Jovet] du sommet de l'éventail [alpin] est assez difficile à expliquer ». Il ne l'est plus aujourd'hui car on en fait un lambeau de la nappe des « Schistes lustrés » piémontais à « roches vertes ».
Concluons sur les Schistes lustrés, vus par Marcel Bertrand. Sur les six campagnes en Haute Maurienne et Haute Tarentaise (1889 à 1895), il en aura consacré quatre à la haute montagne, entre le massif d'Ambin et le col du Petit Saint-Bernard (Fig. 13). Son silence, de 1890 à fin 1893, traduit les difficultés, voire la quasi-impossibilité, - que rencontreront ses successeurs au XXe siècle - , à reconstituer une succession stratigraphique valable dans des formations métamorphiques et, partant, à déchiffrer les structures. Pierre Termier (1908) n'a pas eu tort d'écrire que Marcel Bertrand aurait résolu les grands problèmes de sa zone d'études, « autant, du moins, que l'on pouvait, à cette époque-là, les résoudre ». En fait, la définition de la « nappe des Schistes lustrés » par Termier va bouleverser la donne. Prisonnier du « monophasage » de son « éventail alpin » et de l'âge (« Trias supérieur » au moins) des Schistes lustrés, Marcel Bertrand n'a pas, malgré ses éclairs fugaces sur l'allochtonie éventuelle de la Sana et de la Grande Sassière, osé aller plus loin. Toutefois, en confrontant son schéma d'ensemble de 1894 (Fig. 13) à celui (Fig. 14) de F. Ellenberger (1958), on remarque que les grands ensembles sont cartographiquement bien situés, ce qui a été la base essentielle des progrès ultérieurs.
Sur sa coupe générale de la chaîne (Fig. 15), la limite occidentale de la « zone houillère » correspond à une flexure, à regard ouest, abaissant les terrains, vivement plissés, de la « zone subbriançonnaise » (« 2e zone » de Lory) et de son prolongement septentrional. C'est là que Marcel Bertrand va commencer, en 1893, à étudier la « petite zone » [...] de Moutiers à Aime, où il y a indécision dans le sens du mouvement [du déversement des plis] ». Il reprendra ses levers en 1895, au revers oriental du Mont-Blanc.
Les anciens auteurs, en particulier Charles Lory, y avaient noté des « Schistes lustrés », dans une situation très différente de celle des « Schistes lustrés du Mont-Cenis ». Marcel Bertrand, en accord avec Zaccagna et Mattirolo, les en distingue. On a établi, depuis presque un demi-siècle, que cette zone est celle des « Schistes lustrés valaisans », définis depuis les Grisons et qui se terminent au sud-ouest près de Moûtiers.
Dans son compte-rendu de mission 1895, Bertrand distingue un certain nombre d'unités (« bandes »). Deux d'entre elles doivent correspondre aux actuelles « digitations » de Moûtiers et de Roignais-Versoyen. Elles comportent un épais « Nummulitique », flysch gréso-calcaire (actuel « Flysch de Tarentaise ») où, depuis, a été daté du Crétacé supérieur ; et, au-dessous, un « Trias » très épais, avec des « calcaires phylliteux » et des Schistes lustrés « satinés », en particulier au Mont Roignais où Marcel Bertrand cite des « roches vertes », en particulier « serpentineuses », dont l'âge est toujours débattu.
Il ne semble pas s'interroger sur la signification de ces « Schistes lustrés », situés à l'ouest de « l'éventail houiller ». « L'étendue horizontale des recouvrements », c'est-à-dire la flèche de chevauchement de cette zone par-dessus la couverture « dauphinoise » des massifs du Mont-Blanc-Belledone, est estimée à 4 km.
À la fin de la campagne de 1895, Marcel Bertrand rejoint le jeune géologue genevois Étienne Ritter dans la région de Saint-Gervais, à la terminaison sud-ouest du massif du MontBlanc, dans la zone externe « dauphinoise ». Ritter étudie depuis 1892 cette zone pour sa thèse. Pendant qu'il va examiner les coins synclinaux de Trias-Lias pincés dans le socle cristallin, Bertrand s'occupe, plus au nord-ouest, au-delà de la vallée du Dorinet (Hauteluce), du mont Joly, qui domine le cours de l'Arve. On considérait jusque-là que ce massif était formé par une « succession interminable de schistes noirs, presque horizontaux, attribués au Lias », ayant « échappé aux actions violentes qui bouleversaient les terrains voisins ». Bertrand prouve qu'il s'agit en fait d'un empilement de plis couchés rabattus à l'horizontale, avec une portée de plus de 5 km : les anticlinaux aplatis sont marqués par des lames de Trias ; le Lias ou exceptionnellement le Jurassique moyen sont pincés dans les synclinaux (Fig. 19, partie de gauche).
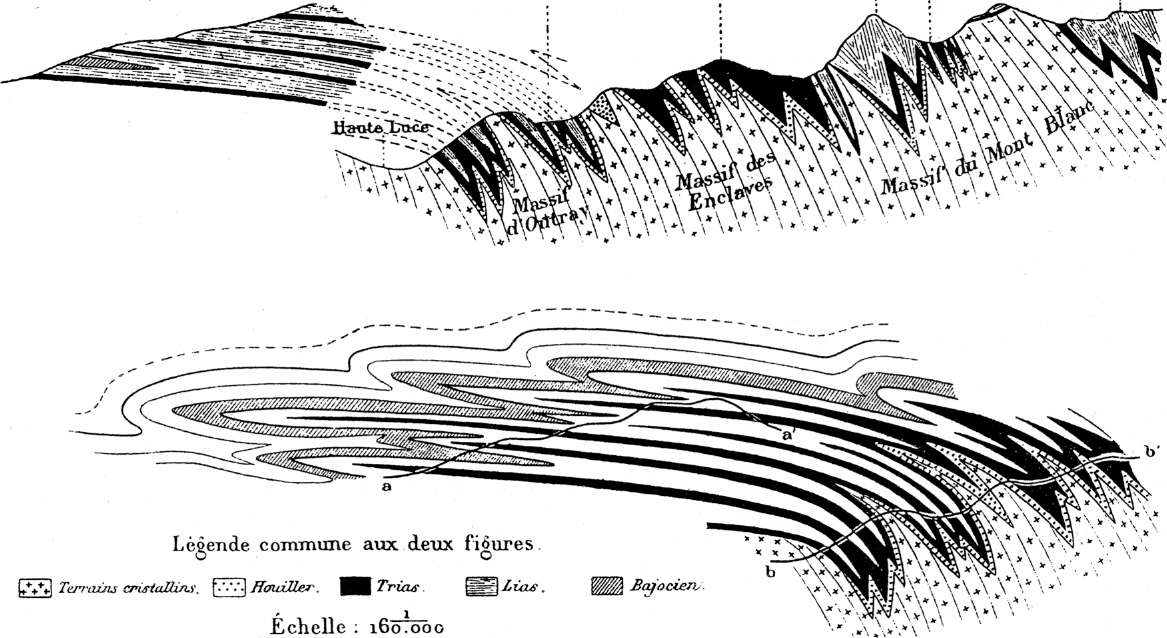
Fig. 19. Coupe entre le mont Joly et le massif du Mont-Blanc. La coupe du bas reconstitue la structure avant érosion [Extrait de M. Bertrand et E. Ritter, 1896].
L'intérêt de cette région est que les plis couchés vers l'ouest-nord-ouest du Mont Joly peuvent se relier cartographiquement, sur le terrain, aux plis très redressés pincés dans le socle cristallin du Mont-Blanc (Fig. 19, partie droite). Il s'agit, dans ces termes inférieurs de la série mésozoïque « dauphinoise », de la partie basse des grands plis couchés souples que montrent les termes les plus jeunes (Jurassique à Éocène) dans le massif du Haut Giffre puis dans celui des Dents du Midi (nappe de Morcles, en territoire suisse). La démonstration de l'empilement des plis du mont Joly eut un écho considérable, « fournissant ainsi la preuve à jamais classique du style de plissement dans les chaînes alpines » (Wilckens, 1909).
Cette région sera l'objet d'un examen lors de l'Excursion XIIIa du Congrès international de Paris (1900), dernier contact géologique de Marcel Bertrand avec les Alpes. Le début de l'excursion est dirigé, du 30 août au 5 septembre, par Wilfrid Kilian, dans les chaînons subalpins puis dans la remontée de la Romanche, à l'est de Grenoble. Le soir du mardi 4 septembre, la caravane s'installe à « l'Hospice » du col du Lautaret. À l'issue du banquet qui s'y tient, Marcel Bertrand est mentionné comme ayant porté un toast, sans doute en l'honneur des nombreux hôtes étrangers. Le groupe descend ensuite vers le nord, atteignant la haute Maurienne à Albertville. À partir de là, Bertrand va présenter en détail, durant les trois derniers jours, les résultats que Ritter et lui ont obtenus en 1895, dans le mont Joly et à l'extrémité sud du MontBlanc. L'excursion s'achève à Saint-Gervais. Le livret-guide invite ceux des participants qui partiront en suivant le cours de l'Arve à apercevoir au passage les célèbres plis couchés de la cascade d'Arpenaz, dans les calcaires du Jurassique supérieur. Ces replis en boucles ouvertes correspondent, à un niveau stratigraphique (et structural) supérieur aux plis serrés aplatis du mont Joly, dans le Trias-Lias. « En d'autres termes, les plis sont plus marqués dans les couches profondes que dans les couches plus récentes, plus voisines de la surface. L'action qui les a formés, quelle qu'elle soit, devait donc venir d'en bas », a écrit Marcel Bertrand.
Le texte qui suit, l'un de ses derniers messages scientifiques, est d'une pensée étonnamment moderne (cf. Trumpy et Lemoine, 1998) : « Ainsi les plis du Mont Joly et, par conséquent, est-on tenté de conclure, beaucoup d'autres plis des montagnes, se seraient formés en profondeur, au-dessous d'une surface relativement peu affectée par ces mouvements profonds [...]. Ce ne serait pas un paradoxe de prétendre qu'actuellement, sous les mers actuelles, de futures montagnes peuvent se constituer en profondeur, sans que rien à la surface ne révèle le travail intense qui s'accomplit. »
Ses travaux dans le Jura et surtout dans les Alpes ont amené plusieurs fois Marcel Bertrand en territoire helvétique, spécialement à Lausanne. Et il sera invité en 1894 à Zurich pour présenter sa célèbre conférence au 6e Congrès géologique international. On peut supposer que c'est à l'occasion d'une excursion organisée en Suisse orientale qu'il observa les chevauchements sud-alpins dans la région de Côme.
Jusqu'en 1885, Marcel Bertrand, attaché au Service de la Carte géologique, mène ses levers dans le Jura et - à partir de 1881 - il cartographie aussi la Provence toulonnaise. Un intermède survient en 1885 : la « Mission d'Andalousie ».
Auréolé par ses découvertes des « recouvrements » en Provence, il est invité en 1891 par le Geological Survey britannique à une excursion en Écosse, pour voir le chevauchement du Moine Thrust. Il est vraisemblable aussi que, lors de ses travaux sur la prolongation du bassin houiller franco-belge vers l'ouest, il ait encore franchi le Détroit. On notera qu'il n'est pas attiré par les congrès internationaux. Installé à Paris, il ne s'inscrit ni à Bologne (1881), ni à Berlin (1884). Et si, devenu professeur à l'École des mines, son nom figure sur les listes aux congrès de Londres (1888) et de Washington (1891), il n'y paraîtra pas. En 1896, il franchit la Méditerranée pour une réunion de la Société géologique en Algérie, qui fera date. Mais Marcel Bertrand ne réalisera son seul véritable voyage lointain qu'en 1897 quand, devenu académicien glorieux, il sera accueilli en Russie avec des honneurs particuliers.
Pour apprécier la situation du géologue « pratique » - comme disait Marcou - à la fin du XIXe siècle, il faut avoir conscience qu'en dehors des destinations pouvant se greffer sur les lignes ferroviaires, qui irriguent déjà les pays d'Europe, c'est la marche à pied, le mulet ou -mais pas en Andalousie ! - les voitures à chevaux qui permettent d'atteindre les régions d'étude. L'Amérique est à trois semaines de bateau et, seuls, les savants fortunés - les subventions officielles étant rares - peuvent se permettre des missions lointaines. Marcel Bertrand voyagera beaucoup « autour de sa chambre » car il était un grand lecteur des publications géologiques sur le monde entier, et il en a tiré maints commentaires sur la Salt Range, les cordillères américaines, le bassin du Congo, etc.
Détachons deux textes de 1898-1899 sur l'isthme de Panama, liés à l'expertise que son ami Zürcher, ingénieur des pont-et-chaussées, venait de faire pour la « Nouvelle Compagnie du Panama » (fondée après le krach de 1892). Observations et échantillons, sur le tracé envisagé pour le canal inter-océanique, permirent aux deux hommes d'établir une coupe géologique de l'isthme. Et Marcel Bertrand, étudiant le dossier sismo-volcanique, conclut avec prémonition : « Panama est la région la plus stable et la moins menacée de l'Amérique Centrale ».
Ses brefs séjours hors de France ont fourni, en particulier, de considérables résultats en Andalousie et en Algérie.
Le soir de Noël 1884, les montagnes enneigées entre Grenade et Malaga sont secouées par un violent tremblement de terre, faisant entre 2 000 et 3 000 victimes (Bonnin et al., 2002).
L'ébranlement est ressenti dans toute la péninsule ibérique. Alertée, l'Académie des sciences, à Paris, décide l'envoi d'une mission pour tenter d'expliquer les causes du séisme, en étudiant la géologie de cette partie centrale des Cordillères bétiques. Dirigée par Ferdinand Fouqué (1828-1904), volcanologue, professeur au Collège de France, l'expédition comprendra deux ingénieurs des mines, Auguste Michel-Lévy et Marcel Bertrand, ainsi que Charles Barrois, futur professeur à Lille. Ils sont assistés respectivement par Jules Bergeron (1853-1919), Wilfrid Kilian (1862-1925) - l'un et l'autre préparateurs d'Hébert à la Sorbonne -, et Albert Offret (1857-1933), minéralogiste, alors préparateur de Fouqué. Bertrand et Kilian, ensemble, se placent entre les deux autres groupes, dans les terrains sédimentaires du versant nord de la chaîne, d'Antequera à Grenade et, au Nord, vers Jaen.
À partir de Malaga, où les membres de la mission parviennent le 7 février, une tournée commune de quinze jours est consacrée à observer la zone d'Alhama de Granada, la plus affectée, et à suivre les quelques routes sillonnant le quadrilatère d'étude (200 km E-W, 100 km N-S). Fouqué reparti, les six jeunes savants vont rester jusqu'à fin mars, chacun dans sa zone. À leur retour paraîtront aussitôt une dizaine de notes à l'Académie des sciences, que suivra en 1889 l'énorme volume de « la Mission d'Andalousie ».
Nous possédons quelques renseignements sur l'activité de Marcel Bertrand par une lettre au ton enjoué qu'il adressa de Grenade, le 18 mars 1885, à Fouqué : et pourtant le temps « est terriblement gris et déplorablement humide » ! Marcel conte les mésaventures d'envoi des caisses de fossiles : par suite du déraillement d'un train, et faute de mulet disponible, il a dû cheminer pendant six heures de nuit, chargé comme un baudet, d'Archidona à Loja (30 km !) et rejoindre ainsi Kilian au rendez-vous fixé. Marcel va s'installer à Grenade et étudier la zone au nord de la capitale provinciale. Il compte ensuite passer un jour de la semaine sainte à Séville, remonter sur Madrid et être à Paris le 6 avril, dimanche de Pâques.
Cette lettre donne les premières impressions géologiques. « Les prétendues marnes irisées, la grande formation à gypse et à ophite, serait antérieure au Trias, probablement permienne ». Marcel a des progrès à faire : les fossiles qu'il a découverts avec Kilian dateront, le Muschelkalk et le Keuper.
L'acquis fondamental du séjour sera de souligner l'opposition, de part et d'autre de la ligne est-ouest de Ronda à Grenade, entre : 1) au sud, la « chaîne bétique » (s.s.) à terrains anciens ou métamorphiques ; 2) au nord, la région sédimentaire, surtout jurassico-crétacée. Marcel Bertrand la qualifie de « zone plissée subbétique », qui « doit son origine à un refoulement d'ensemble des assises mésozoïques et joue par rapport à la chaîne bétique le même rôle que les chaînes subalpines par rapport aux zones alpines du Dauphiné » (Bertrand et Kilian, 1889). Le terme « Subbétique » est devenu classique. On peut être surpris que l'importance de l'accident fondamental séparant Bétique et Subbétique - homologue du « front pennique » des Alpes occidentales - n'ait pas été reconnue : d'autant plus que nous savons maintenant que l'épicentre du séisme de Noël 1884 se situait à l'intersection de cet accident majeur et d'une faille transverse.
Marcel Bertrand ne fait guère d'allusions aux structures tectoniques, en particulier à l'éventualité de « recouvrements » qui sont, il est vrai, dans la zone étudiée, difficiles à analyser. Il avoue aussi ne pas avoir pu « expliquer les anomalies qui, en plusieurs points, comme dans les Pyrénées, font brusquement apparaître [le Trias] en dehors de sa position normale ». En revanche, les principaux stades de la structuration dans la partie externe des Cordillères bétiques sont reconnus. Si la discordance de l'Éocène qu'indique Marcel Bertrand se borne, en fait, à des basculements en certains points du Subbétique, il reconnaît que la structuration majeure est antérieure au Miocène moyen.
Les calcaires et marnes du Mésozoïque révèlent un monde de faits insoupçonnés auparavant, où le jeune Kilian, déjà rompu à la paléontologie stratigraphique, fait merveille : sont datés la plupart des étages du Jurassique - qui est comparé à celui d'Italie du sud (province faunique « tyrrhénienne ») -, en particulier le célèbre gisement « tithonique » de Fuente de los Frailes. Les marnes crétacées semblent discordantes sur les calcaires jurassiques, mais il est reconnu qu'il s'agit d'une disharmonie entre matériaux de compétence différente. Chose curieuse : les marnes roses du Crétacé supérieur ne sont pas identifiées, l'arme micropaléontologique manquant encore.
Bertrand et Kilian analysent aussi la succession néogène du bassin intra-montagneux de Grenade, au pied de la Sierra Nevada (Montero et al., 2003. Dans sa Notice de 1894, Marcel Bertrand évoquera les relations entre Atlantique et Méditerranée au Néogène. Au Miocène moyen, la communication se faisait par un large « sillon du Guadalquivir», à la bordure nord des Cordillères bétiques. Ce détroit va progressivement se rétrécir avant son émersion définitive, isolant la Méditerranée. Et ici Marcel Bertrand se fait prophète : après dépôt de « centaines de mètres de gypse » [il ne peut observer que les zones émergées !] « la Méditerranée a passé [.] momentanément à l'état d'une vaste Caspienne, sur les bords de laquelle on ne trouve plus que des dépôts saumâtres. Ce sera seulement au début du Pliocène que l'ouverture du détroit de Gibraltar a inauguré des conditions à peu près semblables aux conditions actuelles ». Cette ouverture résulte de l'effondrement de « l'axe médian » [l'espace occupé par l'actuelle mer d'Alboran] entre Andalousie et Rif marocain.
125 ans plus tard, les idées actuelles rejoignent ces réflexions. Elles résultent de l'observation, d'une part, des gypses « messiniens » de Grenade (comparés à la « formation sulfo-gypseuse de l'Italie »), et d'autre part, de la transgression directe sur le littoral méditerranéen, à Malaga et plus à l'ouest, de sables datés du Pliocène par une riche faune, recueillie par Jules Bergeron et que Munier-Chalmas déterminera : son caractère dominant « atlantique », avec des espèces de mer profonde, prouve l'irruption brutale des eaux froides de l'océan.
La datation pliocène de l'ouverture du détroit de Gibraltar est ainsi due à Bertrand et à Bergeron, lequel - en 1909 (Bertrand étant mort) - devra défendre sa priorité de l'idée, « redécouverte » par Louis Gentil.
Tous ces résultats - la moisson ne fut pas moins riche pour les autres groupes de la « Mission d'Andalousie » - à la fois sur le plan des faits et sur celui des interprétations, ont été acquis en moins de sept semaines, dans un pays d'accès difficile. On peut ainsi juger de l'endurance physique et de la capacité intellectuelle exceptionnelle de Marcel Bertrand et de son disciple Wilfrid Kilian, âgé de 23 ans.
L'interprétation des causes du séisme fut nettement moins brillante. Cet événement avait pourtant été à l'origine de la mission, dont les membres se montrèrent, de ce point de vue, hésitants et divisés. On sait aujourd'hui (Bonnin et al., 2002) qu'il s'agit d'un séisme de magnitude 6,5-6,7, dont le foyer se place à 10-20 km de profondeur. Les idées de Marcel Bertrand sur ce problème sont exprimées sur trois feuillets, abondamment raturés, conservés aux archives de l'Académie des sciences (dossier acad. M. Bertrand). Dans sa Notice de 1894, il conclut : « La cause directe des tremblements de terre demeure inconnue » mais « on doit y voir la suite et comme un dernier écho de cette mobilité exceptionnelle du sol [de l'Andalousie] dont nous avons retrouvé les traces dans toute la période tertiaire ». Il est amusant de constater que, dix ans auparavant, au retour d'Espagne, Marcel Bertrand avait déclaré à la Société géologique (le 4 mai 1885) que « les tremblements de terre correspondent à un tassement de la base des montagnes », et il ajoutait : « aucun argument sérieux [n'existe] en faveur de la thèse qui cherche à [les] relier [...] à d'anciens mouvements orogéniques ». Contredisant ainsi - à tort ! - le géologue espagnol José Macpherson - qui liait sismicité et fracturation - Marcel Bertrand poursuivait, en guise de « repentir » à son tableau : « si ce lien existait, l'existence des tremblements de terre dans une région montagneuse indiquerait, non pas que les forces de plissement y continuent leur action, mais au contraire qu'elles y ont cessé » et « que les effets de distension ont succédé aux efforts de compression ». Cette suggestion s'accorde avec l'importance considérable de l'extension tardi-orogénique néogène récemment reconnue dans l'édifice bétique.
Il ne connaîtra physiquement l'Algérie qu'en 1896, mais il en avait déjà parlé en 1891, à propos d'une curieuse structure dans le massif de l'Ouarsenis.
De même que la solution du problème de Glaris a été proposée d'après les seuls documents d'Albert Heim, de même le premier cas de tectonique tangentielle soupçonné en Afrique du Nord a-t-il été tiré d'une note d'Émile Ficheur (1889), et encore une fois par Marcel Bertrand.
Loin au sud d'Orléansville (l'actuel Ch'lif), le Grand Pic (1983 m) de l'Ouarsenis [« l'Oeil du Monde » !) semble jaillir au milieu des nappes telliennes. Cette énorme pyramide calcaire présente ses termes les plus anciens (Lias) à sa partie sommitale, les plus jeunes (Crétacé inférieur) au bas des versants. Ficheur estimait que les marnes rouges de l'Oxfordien (qui affleurent à mi-hauteur) s'étaient déposées contre une falaise abrupte de Lias calcaire, et que la position du Néocomien s'expliquait par son affaissement, dû à une faille. Ficheur eut « l'imprudence » de dire avoir trouvé « Terebratula » diphya à la base des bancs oxfordiens. Or cette espèce de Pygope est une forme-guide. du Tithonien ! Les couches « moyennes » du Grand Pic sont donc renversées, proclame Marcel Bertrand (1891). Et il propose de voir tout bonnement dans le Grand Pic le flanc inverse d'un gigantesque pli couché : le Lias repose sur l'Oxfordien-Tithonique, qui surmonte le Crétacé inférieur. « Sans doute il y a lieu de voir si l'existence d'un pareil pli est compatible avec la géologie du reste de la région mais, provisoirement, cette hypothèse semble préférable à l'interprétation qui fait débuter la Ter. Diphya à la base de l'Oxfordien » : car le stratigraphe Ficheur n'avait pas hésité à bousculer l'extension de ce Brachiopode. Joseph Répelin (1895) interprétera dans sa thèse cette série renversée du Grand Pic de l'Ouarsenis (dont il admettra la réalité) comme un « pli en champignon », déversé sur tout son pourtour : l'exemple du Beausset (Bertrand, 1887) aurait pu le faire réfléchir. Ce ne sera qu'en 1958 que l'étude détaillée de Maurice Mattauer (Fig. 20) établira que Marcel Bertrand était, là aussi, dans le vrai.
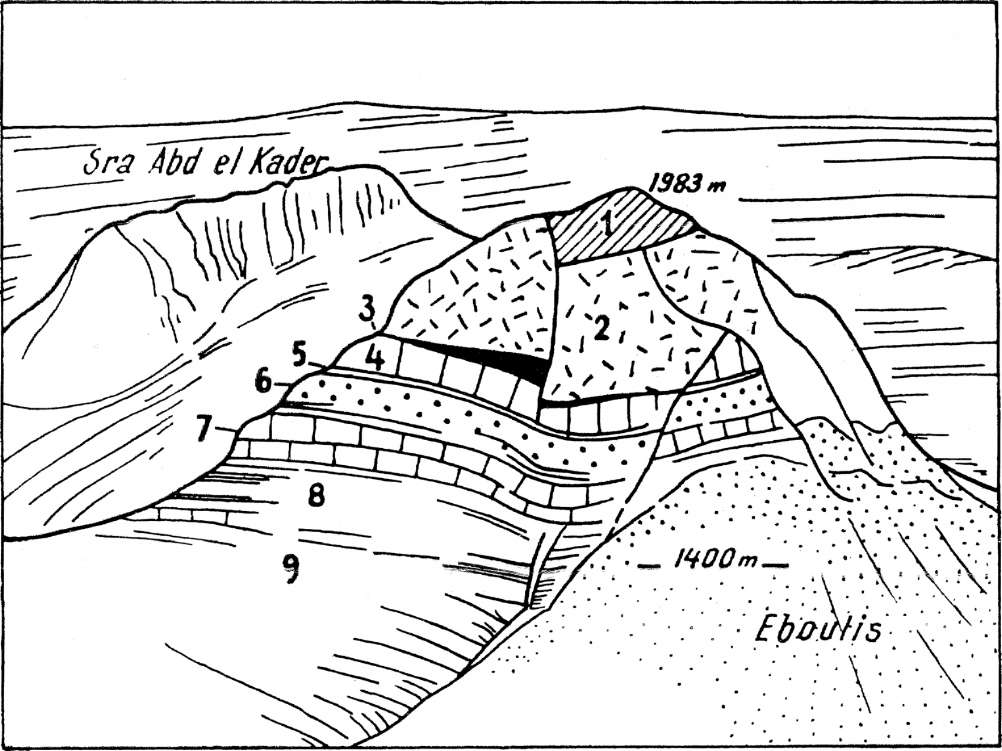
Fig. 20. Coupe-vue du Grand Pic de l'Ouarsenis (Algérie). Interprétation de M. Mattauer suivant l'hypothèse de Marcel Bertrand (1891) d'une série jurassique renversée [Extrait de M. Mattauer, Étude géologique de l'Ouarsenis oriental, Publ. Serv. Carte géol. Algérie, 1958, n. sér., Bull. n° 17]. 1 :« Infralias » ; 2 à 5 : Lias ; 6-7 : Dogger ; 8 : Oxfordien (« Argovien ») ; 9 : Tithonien.
En 1896, se tient la première Réunion extraordinaire de la Société géologique en Algérie. À cette date, les grandes divisions du pays ont été reconnues : les massifs anciens kabyles, séparés par le Tell et par les « Hauts Plateaux », de l'Atlas saharien aux plis « jurassiens ». Une carte géologique au 800 000e a été réalisée par les ingénieurs du Service des mines (1881, et 2e éd., 1889). La création en 1883 du Service de la Carte géologique d'Algérie, co-dirigé par l'ingénieur en chef Justin Pouyanne et par Nicolas-Auguste Pomel, professeur (et directeur) de l'École des sciences d'Alger - la future faculté des sciences - amène un programme de levers des feuilles au 50 000e. En 1891, Émile Ficheur (1854-1923), préparateur de Pomel et qui vient de soutenir sa thèse sur la Kabylie du Djurdjura, succède à son maître et donne une impulsion considérable aux recherches de terrain. C'est pour juger leurs résultats que la Société géologique passera trois semaines (7-27 octobre 1896) à parcourir les « provinces » d'Alger et de Constantine.
Le mercredi 7 octobre, la session débute dans une salle des « Écoles supérieures » à Alger-Mustapha. Marcel Bertrand, ancien président et membre du Conseil de la Société, ouvre la séance en remerciant le principal organisateur, Ficheur, qui va diriger la Réunion extraordinaire. Pomel, miné par la maladie et des chagrins domestiques, n'est pas là, mais son ami Pouyanne, présent, est élu président d'honneur. Une cinquantaine de personnes, dont 28 membres de la Société, vont suivre les excursions, qui aboutiront à des résultats originaux et de première importance.
Dans l'Atlas de Blida, au sud d'Alger, en plein Tell mésozoïque, un grand anticlinorium révèle, dans la partie nord des gorges de la Chiffa, des schistes sombres épimétamorphiques, terme le plus bas d'une succession où sera mis en évidence, au milieu du XXe siècle, un empilement d'unités crétacées allochtones. Pour Ficheur (1895), les « schistes de la Chiffa » sont, « suivant toute probabilité, à rapporter à la base des terrains primaires ». Bertrand et Charles Depéret ne croient pas qu'une discordance sépare ce « Paléozoïque » du Néocomien qui le suit au sud, et ils « seraient plutôt portés, jusqu'à preuve du contraire, à attribuer encore ces schistes de la Chiffa aux terrains secondaires ». La question sera résolue un demi-siècle plus tard par France Ehrmann et par Louis Glangeaud, des Ammonites du Crétacé inférieur y ayant été découvertes. La présence de Paléozoïque épi-métamorphique dans cette zone tellienne aurait eu une grande importance, et l'action d'un métamorphisme post-hercynien n'en a pas moins.
En Grande Kabylie, les trois étages de l'Éocène moyen-supérieur que Ficheur distingue, sur des arguments que l'avenir n'acceptera pas, seraient séparés par des discordances, que Bertrand et Depéret mettent en doute. Le faciès gréseux, nommé « Numidien » par Ficheur (le terme est toujours utilisé) et attribué à l'Éocène à cette époque, « est identique à l'étage supérieur de l'Eocène d'Andalousie », affirme Bertrand. Il faudra plus d'un demi-siècle pour que cette remarque trouve sa justification dans le Rif et en Andalousie occidentale (les « grès de l'Aljibe »), tout en précisant que ce puissant flysch gréseux « numidien » - élément principal de la gigantesque « nappe numidienne » - est daté par nannoplancton de l'Oligocène supérieur-Aquitanien.
Les découvertes essentielles concernent cependant le Trias. 1) Les conglomérats et grès rouges (futur « Verrucano » des auteurs). Au sud des massifs anciens qui, de loin en loin, jalonnent le littoral méditerranéen, une « chaîne calcaire » (actuellement dite « Dorsale ») forme de hauts reliefs. À ses roches carbonatées jurassiques, découpées en écailles serrées, voire en petites nappes empilées, se joignent des grès et conglomérats rouge-violacé. À l'est d'Alger, la Société géologique va les observer au col de Tirourda, par où passe la route principale franchissant le Djurdjura. Ficheur, dans sa thèse (1890), vient d'attribuer ces roches détritiques colorées au Jurassique supérieur. Bertrand s'élève contre un tel âge, relevant à juste titre que ces grès rouges, débutant par « des poudingues rouges à aspect permien » sont « identiques au Grès bigarré [Trias inférieur] classique, avec nombreux bancs de poudingues quartzeux ». Sur la route de Tirourda, cet ensemble coloré fait suite à « des poudingues et des grès micacés à faciès houiller », et il est surmonté en continuité par des calcaires dolomitiques suivis de « marnes vertes » ayant « l'aspect du Trias supérieur et de l'Infralias ». Il conclut que « la succession de quatre termes d'un type aussi constant et aussi caractéristique fournit un argument bien voisin d'une preuve définitive ». Malgré les objections de Ficheur, qui n'a manifestement pas compris l'écaillage du Djurdjura, la proposition de Bertrand, que Ficheur acceptera enfin en 1903, sera prouvée au cours du XXe siècle, tous les âges suggérés s'étant vus confirmer paléontologiquement. En particulier, les grès rouges viennent de fournir des associations palynologiques du Permien et du Trias.
Ce « Verrucano » gréso-conglomératique caractérise, tout au long des « massifs anciens kabyles » un domaine paléogéographique particulier.
2) Les marnes gypsifères du Tell, connues à l'époque en Algérie et en Tunisie (leur prolongation dans le Rif ne sera observable qu'à partir du début du XXe siècle), occupent toujours des situations singulières. En Afrique du Nord comme dans d'autres chaînes (Pyrénées en particulier), l'origine - souvent considérée comme liée à des « éruptions geysériennes » - et l'âge de ces roches faisaient l'objet de discussions interminables, parfois violentes. C'est à Marcel Bertrand qu'on doit ici la solution du problème.
Passant à Constantine, les participants de l'excursion apprennent qu'un professeur du lycée, M. Goux, a découvert des fossiles, que Marcel Bertrand reconnaît comme étant des Myophories. Le 22 octobre, les deux hommes quittent quelques heures la caravane et, accompagnés par Pierre Lory et par l'ingénieur ordinaire des mines Honoré Lantenois, se précipitent à pied au gisement du Djebel Chettabah, une dizaine de kilomètres à l'ouest de la ville. Là, Marcel Bertrand reconnaît, apparemment « intercalé » dans le Crétacé supérieur, un Trias bien stratifié, de faciès provençal typique, avec de bas en haut : 1, des calcaires dolomitiques « jaune-de-miel », fossilifères ; 2, des calcaires noirs à faciès Muschelkalk avec « des taches huileuses à la surface des bancs » [les calcaires « vermiculés »] avec des cargneules ; 3, des argiles bariolées avec gypse. Le grand paléontologiste de Munich, Karl von Zittel, présent à l'excursion, va reconnaître Myophoria vulgaris, espèce du Trias moyen germanique.
La question est réglée : les marnes gypsifères sont du Trias. Sur la ligne ferroviaire de Tunis, Bertrand dit en avoir reconnu trois bandes entre Guelma et Souk-Ahras (« on se croirait être dans les tranchées des environs de Draguignan et de Barjols »). La « montagne de sel » de Biskra (El Outaïa) lui paraît, en fonction du faciès des calcaires intercalés, entièrement triasique, et il étend sa conclusion « aux autres montagnes de sel [de l'Atlas saharien] ainsi qu'à la majeure partie des pointements gypseux de l'Algérie ». L'année suivante, Louis Gentil et Joseph Blayac, sur de nouveaux gisements fossilifères autour de Souk-Ahras, retrouvent la conclusion de Bertrand, et Léon Pervinquière la confirmera bientôt en Tunisie. Le voile est enfin levé sur une des questions les plus irritantes de la géologie de l'Afrique du Nord.
Structuralement, Marcel Bertrand estime que, « suivant le mode ordinaire de ces gisements », il s'agirait, au Djebel Chettabah, « d'un anticlinal plus ou moins déversé, dont les flancs étirés sont restés en profondeur », ajoutant que « le noyau triasique a seul percé au milieu de terrains bien plus récents » (Bertrand, 1896), en l'espèce crétacés. De tels plis à noyau perçant ne sont guère différents des « plis diapirs » que définira un jour Mrazec en Roumanie.
Dans une de ses dernières interventions à la Société géologique, le 22 janvier 1900, à propos de marnes bariolées et gypses des Pyrénées occidentales, Marcel Bertrand sera amené à parler des « coupes algériennes que vient de nous faire connaître M. Ficheur », et qui montrent des « enchevêtrements » [de terrains] « où le Trias joue un rôle à part et prend toujours les places les plus inattendues ». Il estime que « la singularisation du Trias doit avoir une explication générale » (c'est lui qui souligne), qu'il a tendance à lier à sa position à la base de nappes de charriage : « cette hypothèse est rationnelle, et jusqu'à nouvel ordre, je n'en vois pas d'autre possible ». Cette interprétation a été vérifiée dans les années 1960 par les découvreurs des nappes « sud-telliennes » qui se sont servis des bandes filiformes de Trias pour jalonner la base de leurs unités empilées. Pierre Termier (1908) a fort justement écrit : « L'intervention fortuite et momentanée de Marcel Bertrand sur la géologie de cette contrée [l'Algérie] a été le signal du renouvellement presque complet des idées que l'on s'en était faites », cette phrase ne prenant cependant sa véritable valeur qu'un demi-siècle plus tard.
L'étude de la Provence a constitué aux yeux de Marcel Bertrand son oeuvre essentielle, résultant d'une patiente analyse de terrain. On est surpris, en prenant connaissance de la trentaine de publications qu'il a écrites, de voir combien ont évolué dans le temps les solutions structurales qu'il a proposées. Bailey, commentant la succession des publications de Marcel Bertrand sur la Provence (Bailey, 1935, p.142-178), l'a fort bien exprimé : « Les papiers successifs de Bertrand montrent d'une très intéressante façon le développement de sa pensée tectonique. Les lire équivaut à écouter un esprit supérieur pensant à haute voix. »
Elles se sont déroulées de 1881 à 1899, combinées (de 1881 à 1886) avec la fin des levers dans le Jura puis (de 1889 à 1895) avec les travaux dans les Alpes occidentales. On peut ainsi distinguer quatre périodes d'activité :
1) entre 1881 et 1886, lever de la feuille géologique de « Toulon » (massif des Maures et sa bordure sédimentaire mésozoïque à l'ouest) ;
2) deux années d'intense activité (1887-1888), de la Provence orientale de Draguignan à la région de Marseille : découverte des chevauchements de la Sainte-Baume, du Beausset et éclair de génie sur le massif d'Allauch ;
3) en 1891, retour sur les abords de Toulon (chevauchement du socle) et sur le massif d'Allauch ; à l'automne, Réunion extraordinaire de la Société géologique de France, spécialement sur le problème du Beausset. La Notice de 1894, pour sa candidature à l'Académie, fait le point sur la pensée de Marcel Bertrand : la Provence est « un pays de plissements », où d'importants chevauchements accompagnent des « plis (couchés) sinueux », ayant tendance à se refermer (en plan) sur eux-mêmes.
4) En 1895, Eugène Fournier commence à contester les interprétations tectoniques de Marcel Bertrand. Celui-ci revient donc vérifier la réalité des « recouvrements ». Il les étend vers l'ouest au chaînon de l'Étoile (1897), ce qui l'amène (1898-1900) à abandonner la notion de « plis sinueux » et à la remplacer par la définition de sa « grande nappe de recouvrement de la Basse Provence », déplacée du sud vers le nord. Marcel Bertrand a encore la force de conduire, en 1900, une excursion du Congrès géologique international de Paris, mais il sera incapable de terminer les mémoires complémentaires sur la Provence qu'il envisageait.
La venue de Marcel Bertrand en Provence s'inscrivait dans un programme régional de levers pour le Service de la Carte géologique auquel il était attaché. Les cartes littorales furent confiées aux ingénieurs du Service. Alfred Potier avait déjà commencé l'étude des Alpes maritimes (feuilles de Nice et d'Antibes). Marcel fut donc chargé des coupures plus occidentales (Toulon et Marseille), qui sont en fait des demi-feuilles par leur superficie à terre. Il allait avoir comme voisins : au nord-ouest (feuille d'Aix), Louis Collot, nouveau professeur à la faculté des sciences de Dijon, dont la thèse (1880) portait sur le bassin d'Aix-en-Provence ; et, à partir de 1883, au nord-est (feuilles de Draguignan et de Castellane), Philippe Zürcher, ingénieur des ponts-et-chaussées, alors en résidence à Digne. La collaboration entre Marcel Bertrand et ses voisins fut excellente.
Avant sa prise de contact avec la région de Toulon au printemps 1881, la Provence « n'avait guère été étudiée qu'au point de vue de la composition des terrains qui s'y rencontraient ; la structure en était presque complètement inconnue » (Bertrand, 1894). Si quelques fractures et quelques plis y avaient été signalés, la faible inclinaison des couches dans la plupart des secteurs ne laissait pas soupçonner un domaine à tectonique « alpine ».
La feuille « Toulon » correspond à la moitié méridionale du massif ancien des Maures, à l'amorce occidentale de la « dépression permienne » qui l'entoure du côté nord, et, plus à l'ouest encore, aux terrains mésozoïques (Trias à Crétacé) des hautes collines dominant Toulon et allant au nord vers Méounes. Aucune publication (sinon la brève notice de la feuille « Toulon ») ne sera tirée de ses levers par Marcel Bertrand, novice dans les terrains cristallophylliens, qui pourtant durent l'occuper longuement. Il fait part de ses réflexions dans une lettre à Ferdinand Fouqué, pour convenir d'un rendez-vous dans les Maures (lettre du 1er mars 1884 : Arch. Acad. Sci., Recueil Lacroix, 1-J-22-2) : « Vos observations, conformes d'ailleurs en cela à mes notes des années antérieures, me montrent qu'il y a dans les régions de Saint-Tropez et de Plan la Tour [l'est du massif] d'innombrables différences avec ce que j'ai cru l'année dernière observer plus à l'ouest. [...] De plus, dans toute cette région [orientale] la direction générale [des couches] est nord-sud tandis que dans la région occidentale elle est est-ouest ou à peu près [...] ; j'ai observé dans les Maures une faille (qui serait même double) entre les deux régions... » Cette lettre prouve que Marcel avait mis en évidence la grande faille double nord-sud de Grimaud et de La Garde-Freinet, qui sépare l'unité orientale des Gneiss de Saint-Tropez, de l'ensemble occidental des Gneiss de Bormes, surmontés à l'ouest vers Toulon par des micaschistes et des « phyllades ».
La notice de la feuille « Toulon » ne fait pas allusion aux hypothèses précédentes. Par contre, elle insiste sur les fracturations, en gros est-ouest, qui accompagnent « une série de plis d'un caractère très irrégulier et très compliqué » dans la série secondaire au nord de Toulon. « C'est donc la même cause qui doit rendre compte de leur sinuosité et de celle des plis ». Ainsi retrouve-t-il en Provence la thèse qu'il défend dans le Jura externe : la liaison des fractures et des plis.
Le rôle des Maures est ainsi considéré : « On ne peut chercher la cause de ces effets complexes que dans une compression d'ensemble, exercée du Sud vers le Nord ; quant à l'irrégularité du plissement, il faut l'attribuer à l'inégalité des résistances. Cette inégalité s'est surtout fait sentir aux approches du massif des Maures, anciennement consolidé ; d'où la tendance des plis à s'arrêter brusquement et à remonter vers le Nord par une série d'ondulations ». C'est une première manière de signaler la « discordance tectonique » majeure qui sépare le Mésozoïque plissé de la Provence calcaire de son substratum ancien des Maures par l'intermédiaire du revêtement gréseux permien, apparemment tranquille tectoniquement.
Première étude de la Sainte-Baume. De 1881 à 1886, Marcel Bertrand a parcouru « la partie de la Provence qui, de Marseille à Toulon, Draguignan et Grasse, borde au Nord la chaîne des Maures ». Il a reconnu la difficulté à comprendre sa structure d'ensemble. Des « bandes étroites aux allures très tourmentées » alternent avec de grandes régions simples « comme le bassin du Beausset » (il n'a pas encore résolu « l'énigme » du Vieux Beausset !). Des « failles à contours extraordinairement sinueux » qui parfois « se ferment complètement » séparent les deux types de structures. Fracturations et sinuosités sont alors les maîtres-mots de la doctrine de Marcel Bertrand.
En 1884, il inaugure ses levers sur la feuille « Marseille » en étudiant le massif de la Sainte-Baume, situé 25 km au nord-ouest de Toulon. Coquand avait en 1865 observé que la partie septentrionale de ce haut relief, long de 15 km en direction est-ouest, était formée de terrains secondaires (Trias à Urgonien) en série renversée : c'était « une première » en France ! Mais l'explication manquait : pour Coquand, des failles verticales séparaient cette bande singulière des domaines, tant au nord qu'au sud, où le Mésozoïque était à l'endroit.
Marcel Bertrand observe que les fractures sont en réalité inclinées, proches de l'horizontale, et qu'il s'agit de surfaces de chevauchement. C'est donc avec satisfaction qu'il annonce « un de ces phénomènes de plis couchés, fréquents dans les régions alpines [mais] assez rares en France pour mériter d'être signalés ». À cette époque, il considère que le pli couché de la Sainte-Baume se termine à l'ouest tout à fait brusquement et que son apparente continuation vers le nord-ouest (« Tête de Roussargues » = Roqueforcade actuel) est en place. Il changera d'avis en 1888 quand il en reprendra l'analyse.
Le 13 juin 1887, Daubrée présente à l'Académie des sciences une note de Marcel Bertrand donnant l'« l'explication de l'anomalie stratigraphique du Beausset ». Souvenons-nous qu'à cette époque, le terme « tectonique » n'existait pas en français, et que la « stratigraphie » était comprise comme « la situation » des strates sédimentaires. Or, au Beausset, un îlot de terrains triasiques se trouve dans l'axe d'un calme synclinal est-ouest de terrains crétacés. Comme nous le verrons, Marcel Bertrand prouvera qu'il s'agit d'un lambeau « de recouvrement », reste d'un grand pli couché vers le nord. Par la suite, en 1891, il révélera que, pendant trois ans, il avait parcouru les environs du Beausset pour trouver une explication à cette « énigme ». Ses dates de présence à Paris prouvent que son « illumination » eut lieu pendant le mois de mai 1887, ce qui prouve sa rapidité de réaction car, dès le 20 juin, il dépose à la Société géologique un long texte explicatif qui, cette fois - à la différence de celui sur Glaris -aura un grand écho.
Il ne peut s'empêcher de donner à cette occasion une interprétation (la première) de la structure de la Provence (Fig. 22, coupe du haut) : le large synclinal est-ouest du Beausset est encadré, au sud (Le Beausset) comme au nord (la Sainte-Baume), par deux grands anticlinaux couchés vers le nord. Un troisième pli « du Mont Regaignas » existerait encore plus au nord, « légèrement renversé » sur la bordure du « bassin synclinal de Fuveau » [synclinal de l'Arc].
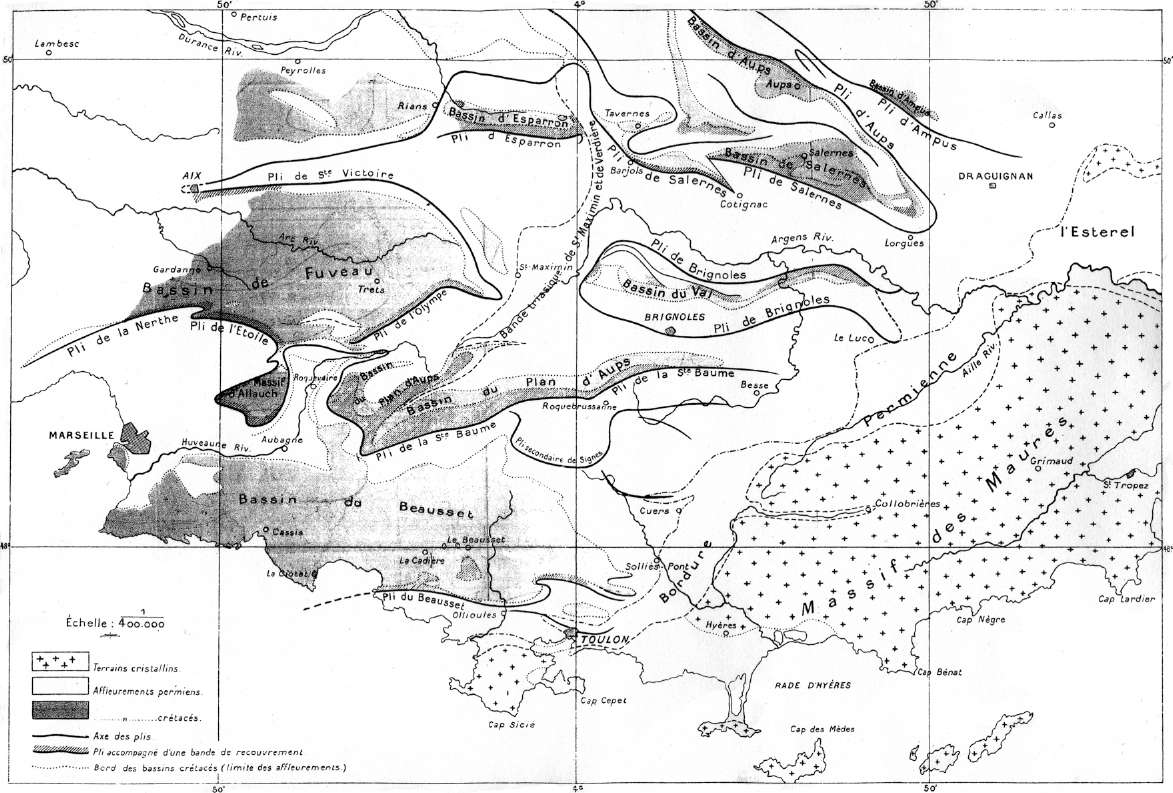
Fig. 21. Esquisse structurale de la Provence à l'époque des « plis sinueux » (1890) [Extrait de M. Bertrand, 1890a-imprimé en 1908].
Tout l'été 1887, Marcel Bertrand travaille sur la feuille « Marseille ». Il fait de nombreuses tournées de vérification entre Le Beausset et La Ciotat, et va poursuivre l'étude de la Sainte-Baume vers le nord, en s'aidant - a-t-il précisé - des contours manuscrits de la feuille « Aix » que, aimable confrère, Louis Collot lui a communiqués. Ainsi pourra-t-il, en mai 1888, décrire la région de Saint-Zacharie, dans la vallée de l'Huveaune, environ 8 km au nord de l'axe montagneux de la Sainte-Baume : il interprète des superpositions anormales de paquets jurassiques sur le Crétacé supérieur comme correspondant au coeur d'un pli (anticlinal) couché vers le sud. Comme un tel chevauchement fait face à celui de la Sainte-Baume, plus méridional, dirigé vers le nord, Marcel Bertrand est amené à l'idée d'un « double-pli provençal » : à l'image du « double-pli de Glaris » d'Albert Heim dont, à cette date, Marcel Bertrand a la faiblesse (temporaire !) d'admettre la réalité. Cependant, comme entre les lambeaux de Saint-Zacharie et la masse chevauchante de la Sainte-Baume, il y a, à l'ouest, continuité cartographique en passant par « la Tête de Roussargues », Marcel Bertrand émet l'hypothèse qu'il s'agit d'un seul et même pli anticlinal (couché), dont l'axe tournerait de 180° vers l'est, sans cesser d'être déversé vers un « synclinal » médian dit « du Plan d'Aups ».
Au début de l'automne, Marcel Bertrand visite la région à l'ouest de Draguignan en compagnie de Philippe Zürcher, qui la cartographie depuis plusieurs années. Ce dernier avait dû faire appel au nouveau professeur de l'École des mines, pour tenter de comprendre les singulières structures que ses levers révélaient. Marcel va les interpréter comme dues à l'existence de plis couchés sinueux, ceux de Brignoles et de Salernes (Fig. 21). Il insiste sur le cas du second, qui est situé plus au nord que celui de la Sainte-Baume. Un chevauchement vers le nord d'au moins 3 km est admirablement visible dans la profonde demi-fenêtre de la Bouissière, au Sud de Salernes.
C'est à la même époque (novembre 1888) que Marcel Bertrand écrit une brève note sur le massif d'Allauch, au nord-est de Marseille, dont les calcaires crétacés peu disloqués sont ceinturés par une étroite bande de terrains mésozoïques plus anciens, essentiellement formée de Trias. Pour lui, cette bande marquerait l'axe d'un pli anticlinal couché au tracé sinueux, constamment déversé vers le centre du dispositif. Toutefois, le fait que ce pli, après avoir tourné tout autour du massif crétacé, se raccorde exactement à sa direction première, lui impose l'idée qu'il s'agit en réalité d'une unique surface de chevauchement (ultérieurement plissée) d'une masse dont le Trias forme la base, masse déplacée vers le nord. De la sorte, sans qu'il prononce encore les mots de « trouée » ou de « regard » [fenêtre tectonique], Marcel Bertrand voit dans le massif crétacé d'Allauch une grande fenêtre, ce que l'avenir vérifiera.
Esquisse de 1889. Lors de l'Exposition universelle de Paris, toutes les feuilles géologiques au 80 000e de la Provence étaient levées, et certaines imprimées. Unies à celles du reste de la province situées plus au nord et plus à l'ouest, elles furent réunies en un panneau de 14 feuilles. Leur coordination (Potier s'occupant de son secteur) fut assurée par Marcel Bertrand, qui écrivit une notice détaillée, donnant l'état des connaissances à cette époque.
La doctrine est alors celle de la sinuosité des plis, Marcel Bertrand y voyant un fait analogue à celui des courbures, indiscutables, des grandes chaînes de montagne, qui peuvent se diviser en branches divergentes. Dans son ensemble, la Provence serait une ramification des Alpes, séparée des « Alpes liguriennes » et de l'Apennin par le « horst hercynien » des Maures : la masse de ce dernier a fait obstacle à la propagation des plissements et les a forcés à se diviser en décrivant des replis sinueux, et cela jusque dans le détail.
Les plis provençaux ont subi des efforts de torsion où « l'énergie des forces horizontales a produit les effets les plus extraordinaires » : ils se couchent sur « des largeurs [flèches de déplacement] qui dépassent certainement 5 kilomètres », recouvrant les synclinaux qui se trouvent en avant d'eux. L'existence de restes de flancs renversés prouverait l'allongement progressif des plis et leur « déroulement ». Des plissements ultérieurs ont pu déformer ces plis couchés.
En 1890, l'activité de terrain de Marcel Bertrand se ralentit : il va être occupé par la présidence de la Société géologique et par la préparation du gros Mémoire sur les refoulements. pour le concours du prix Vaillant de l'Académie des sciences. Dans ce travail (qui ne sera imprimé qu'en 1908, après la mort de son auteur), le rôle des Maures est longuement examiné. Marcel Bertrand estime que ce massif était émergé au Permien (d'après la nature des galets), au Jurassique (le caractère littoral des dépôts marins s'accentue à son approche), au Crétacé supérieur (la prolongation ouest des Maures aurait alimenté les poudingues turoniens du Bec de l'Aigle, à La Ciotat). Ainsi le massif, déjà en saillie quand se sont produites les premières actions de compression, aurait joué le rôle d'obstacle résistant, de barrière dans la propagation des plis. Cependant, la bordure du massif cristallin témoigne de déplacements horizontaux [en 1891, s'y ajoutera la découverte du charriage de Sicié] et « l'hypothèse du massif résistant ne saurait être admise qu'avec de fortes restrictions ». Marcel souffle donc le chaud et le froid ! En fait, il est profondément hésitant : « J'accepte la sinuosité des plis comme un fait d'observation, sans en rechercher plus profondément les causes ».
Le mémoire de 1890 donne, pour l'histoire de la géologie, une idée précise des pensées de Marcel Bertrand à l'époque où explose son activité intellectuelle. Pour la Provence, on lit que ses complications résultent de trois circonstances superposées : a) des plis successifs se sont déversés en amenant sur de larges espaces les terrains les plus anciens à recouvrir les plus récents ; b) « les lignes directrices de ces plis [...] décrivent très souvent des sinuosités très marquées » ; c) enfin des effondrements locaux (par exemple au sud de la Sainte-Baume : de Carpiagne à Chibron et à Signes) sont survenus.
Aussitôt écrit, le tableau général de la Provence présenté en 1889-1890, avec ses plis sinueux et ses chevauchements limités, va être l'objet de perplexité pour son auteur. On peut y voir la cause du retrait de l'impression du Mémoire sur les refoulements... Un message de Zürcher est alors responsable du retour de Marcel en Provence.
La carte au 80 000e « Toulon », levée précédemment par Marcel Bertrand, indiquait autour de cette ville une fracture séparant systématiquement le Permo-Trias et les « phyllades » paléozoïques : au sud de La Seyne (partie orientale de la péninsule de Saint-Mandrier) ; à l'est de la rade de Toulon, dans la bande littorale du cap Brun ; plus à l'est encore, dans le massif du Pradet. Une telle faille, extrêmement sinueuse, arrivant à se fermer sur elle-même, était censée être due à la remontée du socle à travers sa couverture permo-triasique. Marcel Bertrand avait cependant noté (un brouillon de ses levers, conservé à la bibliothèque du BRGM, à Orléans, en témoigne) que, curieusement, ce sont les termes les plus jeunes du « Permo-Trias » -spécialement le Muschelkalk - qui se trouvent au contact des phyllades, alors que, dans l'hypothèse de la percée verticale de celles-ci, ce devraient être les termes les plus anciens du Permien qui, relevés, soient le long de ce contact.
Zürcher, devenu ingénieur des travaux hydrauliques de la Marine, fut chargé des études préparatoires au creusement, à l'est de Toulon, d'un tunnel amenant à la mer les eaux de l'Eygoutier. Son tracé nord-sud recoupait la colline de grès rouges permiens séparant les deux masses de « phyllades » du cap Brun, à l'ouest, et du Pradet, à l'est. Or Zürcher découvrit « une bande [de phyllades] de quelques mètres de largeur », sur 500 m de longueur, reliant les deux masses précédentes. L'idée la plus simple était de supposer que cette bande correspondait à un « pli anticlinal écrasé », que le tunnel devait traverser en profondeur. Or celui-ci resta constamment dans le Permien, à structure relativement simple. « La bande de phyllades n'a pas de racine en profondeur », écrivirent Bertrand et Zürcher le 11 mai 1891.
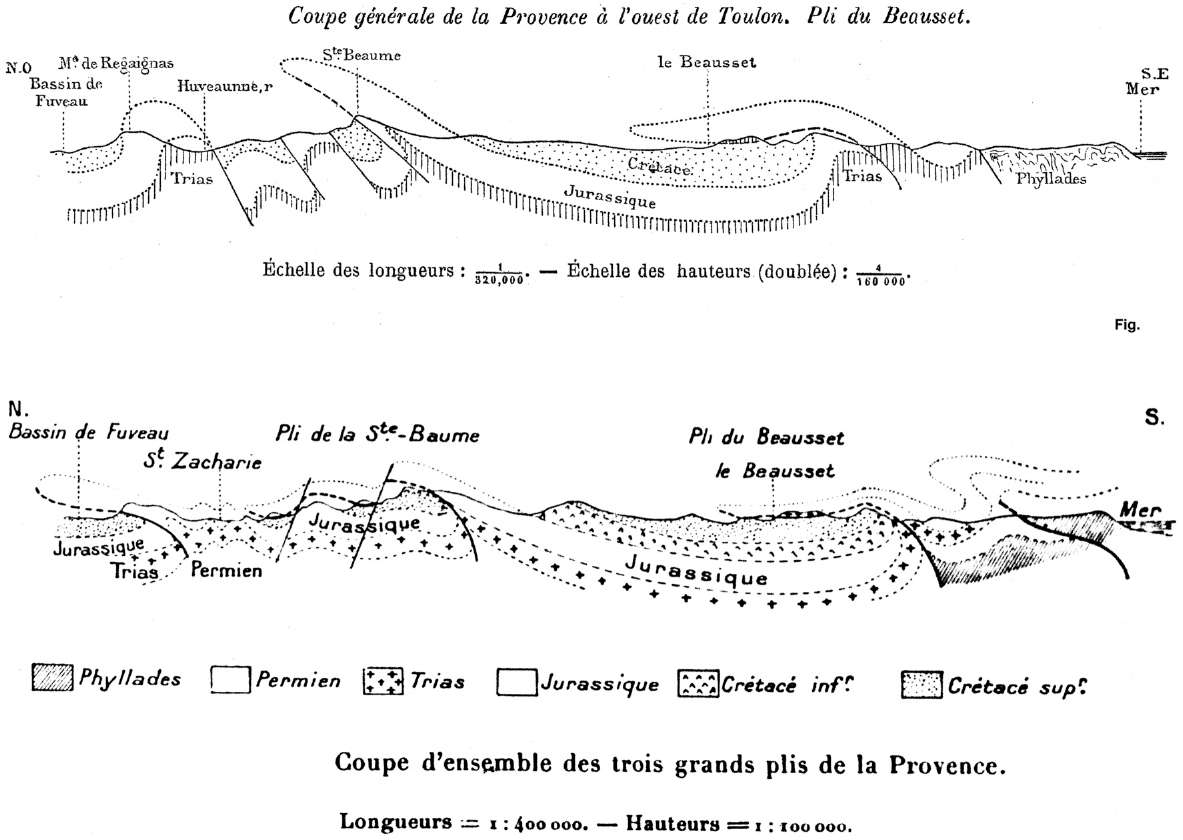
Fig. 22. Coupes interprétatives successives de la Provence par Marcel Bertrand. Coupe du haut (1887) [Extrait de M. Bertrand, 1887b]. Coupe du bas (1890) [Extrait de M. Bertrand, 1890a-imprimé en 1908].
Les affleurements côtiers montrèrent en outre que les phyllades sont superposées au Muschelkalk et séparées de lui par de minces lames de terrains renversés. Ainsi les « phyllades » côtières entre le cap Brun et Le Pradet sont-elles allochtones et ne peuvent provenir que « du massif, aujourd'hui submergé, qui réunissait la pointe de Sicié à la presqu'île de Giens », situé 5 km plus au sud. Les auteurs sous-entendent que le Permien de Saint-Mandrier, au sud-ouest de la rade de Toulon, est en demi-fenêtre sous les « phyllades » (comme le prouvera au XXe siècle le percement d'une grande galerie). Manifestement Marcel Bertrand va laisser Zürcher maître de développer les conclusions de cette note capitale.
L'intérêt de ce chevauchement - obstinément qualifié de « pli couché » à partir de restes minuscules, réputés dériver d'un flanc inverse - est « qu'il intéresse les terrains cristallins des Maures ». Et les deux auteurs concluent qu'« on ne peut plus, comme l'avait fait l'un de nous [Marcel Bertrand] précédemment, considérer les Maures comme un massif résistant », dont le rôle aurait été de dévier les plis [de la couverture]. Ce massif « est, pour une de ses parties du moins, le centre d'un grand pli couché, rasé par la dénudation... ».
Une nouvelle coupe générale de la Provence (Fig. 22, coupe du bas) est donnée dans le texte écrit en « 1890 » (imprimé en 1908). Il est indiqué que cette coupe et le texte la commentant ont été ajoutés (en 1891) au manuscrit primitif.
En 1888, Marcel Bertrand avait proposé une hypothèse (voir plus haut) selon laquelle les calcaires crétacés de ce massif apparaissent en fenêtre sous le Trias qui forme périphériquement la base d'une unité (« pli couché ») chevauchante. L'ensemble aurait été ultérieurement plissé en une sorte de dôme, ce qui aurait porté le Crétacé en hauteur, en redressant les contacts avec le Trias le ceinturant.
Cette explication - qui, après un demi-siècle de vives discussions (cf. Guieu, 1968-2002), apparaît comme la bonne - est cependant remise en question par son auteur ! Le 8 juin 1891, il va décrire en détail le massif d'Allauch et l'on a la surprise de lire : « j'ai été amené à concevoir la possibilité d'une seconde hypothèse que j'exposerai en regard de la première [= celle de la situation en fenêtre] ». Cette nouvelle hypothèse résulte de la difficulté que Marcel Bertrand dit trouver pour raccorder la structure d'Allauch avec les structures des massifs qui l'encadrent à l'ouest (l'Étoile) et à l'est (zone de l'Huveaune et de Saint-Zacharie).
Dans cette nouvelle hypothèse, le Crétacé d'Allauch serait, non pas remonté, mais affaissé verticalement de plus d'un kilomètre ; le Trias qui l'environne correspondrait à sa base stratigraphique, « remontée » (relativement) autour de lui. L'apparence actuelle de chevauchement de ce Trias sur le Crétacé serait due à des mouvements postérieurs limités et dans des sens divers. Cela supposerait évidemment que le même Trias doit se retrouver également en profondeur sous le Crétacé.
Il ne peut être question ici de suivre l'argumentation de Marcel Bertrand dont la pensée a fluctué en cours de rédaction. Au début, il dit ne pas « oser se prononcer entre elles [= les deux hypothèses] d'une manière formelle ». Plus loin, il développe les objections qu'il fait à sa nouvelle interprétation ! Et de conclure que, « du point de vue théorique, la première solution [= celle du Crétacé en fenêtre] serait préférable, ou du moins plus séduisante ». De toute manière, conclut-il, « la discussion des deux seules solutions possibles mène à relier le pli de la Sainte-Baume à celui de l'Étoile, à en faire une même unité, et à admettre dans la région intermédiaire [= le massif d'Allauch] des déplacements horizontaux au moins aussi importants que dans les massifs voisins ».
L'itinéraire suivi allait de Marseille à Draguignan, l'un de ses objets essentiels étant le problème du Beausset. La réunion débuta le 29 septembre. Après une mini-croisière de La Ciotat à Bandol, le groupe va se fixer au Beausset pendant deux jours durant lesquels Marcel Bertrand va, sur des itinéraires pédestres, présenter les arguments permettant d'affirmer le repos tectonique du Trias des collines du Vieux Beausset et du Castellet sur le Crétacé supérieur du synclinal du Beausset (Fig. 23).
Ses opposants sont là. Le jeune Eugène Fournier (1871-1941), élève du professeur Vasseur à Marseille, va pour l'instant écouter les discussions. Il n'interviendra sur le sujet qu'à partir de 1895. Par contre, Aristide Toucas (1843-1911), qui a laissé un nom dans la paléontologie des Rudistes, va avoir un rôle actif. Cet officier retraité devenu géologue est le fils d'un médecin du Beausset qui avait commenté en 1869 à la Société géologique la cartographie des environs de son village. Aristide en avait lui-même, en 1873, analysé la succession crétacée, dont il croyait que les assises successives s'appuyaient sur un paléo-relief de roches triassico-liasiques (Fig. 24, coupe du haut). Marcel Bertrand avait, en 1887, objecté qu'aucune des couches, subhorizontales du Crétacé supérieur ne contenait le moindre débris que n'eût pas manqué de fournir la falaise d'un tel « îlot » émergé. De plus, du côté sud de la colline, au-dessus du Crétacé terminal d'eau douce, on trouve trace de couches du Crétacé supérieur, renversées, au pied immédiat des reliefs triasiques.
Marcel Bertrand avait « proposé à M. Toucas de trouver un moment pour monter ensemble vérifier la question ; les journées ont été jugées trop chargées jusqu'au bout pour que cela nous [on appréciera la litote !] eût été possible... ».
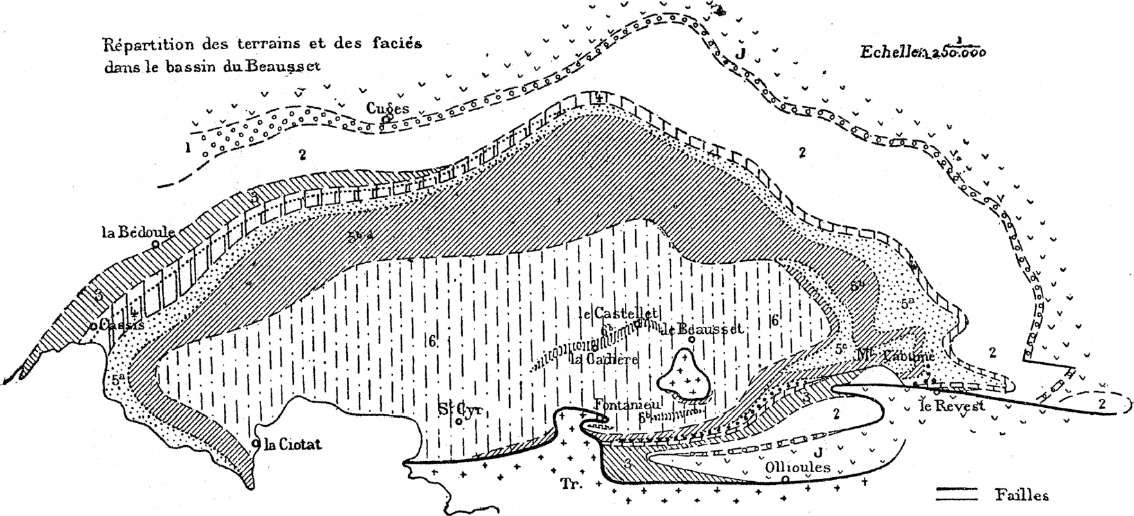
Val d'Aren
Fig. 23. La région du Beausset [Extrait de M. Bertrand, 1887b]. 1 : Muschelkalk ; 2 : marnes irisées ; 3 : « Infralias » ; 4 : Lias ; 5 : Jurassique supérieur ; 6 : Crétacé inférieur ; 7a : Aptien ; 7b à 9 : Crétacé supérieur marin ; 10 : Crétacé supérieur d'eau douce.
Val d'Aren
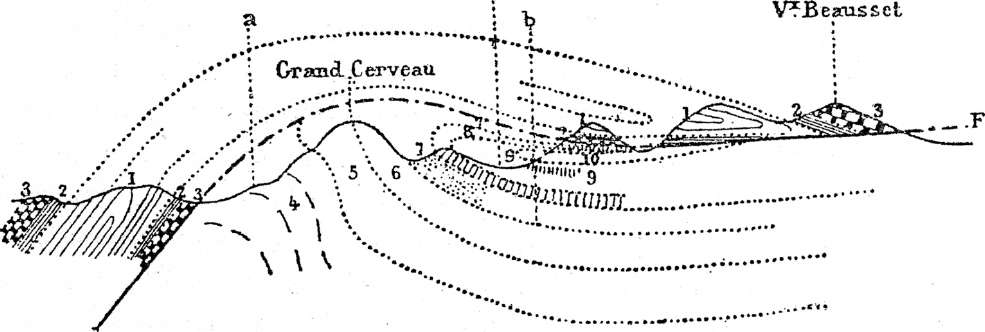
En 1891, les participants de la Réunion vont examiner cette succession inverse du Petit Canedeau, puis le contact entre ce Crétacé et le Trias qui le chevauche (une fouille vient d'être faite par Gaston Vasseur qui, initialement, avait pensé que le Trias était sous le Crétacé). Le Trias sommital est lui-même en série renversée (le Muschelkalk est en haut, l'« Infralias » en bas) et, à la partie nord de la colline, l'ensemble paraît dessiner la charnière d'un pli anticlinal couché vers le nord. Ces observations ne paraissent pas susciter de contradictions, par Toucas en particulier, qui avait tacitement abandonné son hypothèse de 1873, celle de l'îlot dans la mer crétacée. Il n'accepta pas cependant l'interprétation de Marcel Bertrand, celle d'un lambeau de recouvrement. À la suite de l'excursion, il dessina (Toucas, 1896) un extraordinaire pli en champignon (Fig. 24, coupe du milieu) : le Trias formerait un mince piston enraciné, traversant verticalement le Crétacé et se déversant périphériquement sur une distance d'ordre kilométrique. Marcel ne réagira pas par écrit à cette singulière proposition. Il se contentera par la suite, les 25 et 26 septembre 1900, de montrer aux participants de l'excursion du Congrès géologique international la situation structurale (Fig. 24, coupe du bas) des « îlots » triasiques du Vieux Beausset et du Castellet qui - Toucas et Fournier mis à part - sera acceptée unanimement.
Une autre course fut organisée, en 1891, par une chaleur exténuante, entre le village de La Cadière et la colline du Télégraphe, pour reconnaître la zone d'origine des lambeaux du Beausset. Le Trias apparaît là (Fig. 23) au sud du relief du Gros Cerveau, dans l'axe d'un pli anticlinal qui se couche progressivement vers le nord. Au flanc est du Télégraphe de La Cadière, le groupe atteint le vallon de Fontanieu où une mine exploite le lignite dans le Crétacé terminal d'eau douce (« Fuvélien ») en contrebas du sommet triasique.
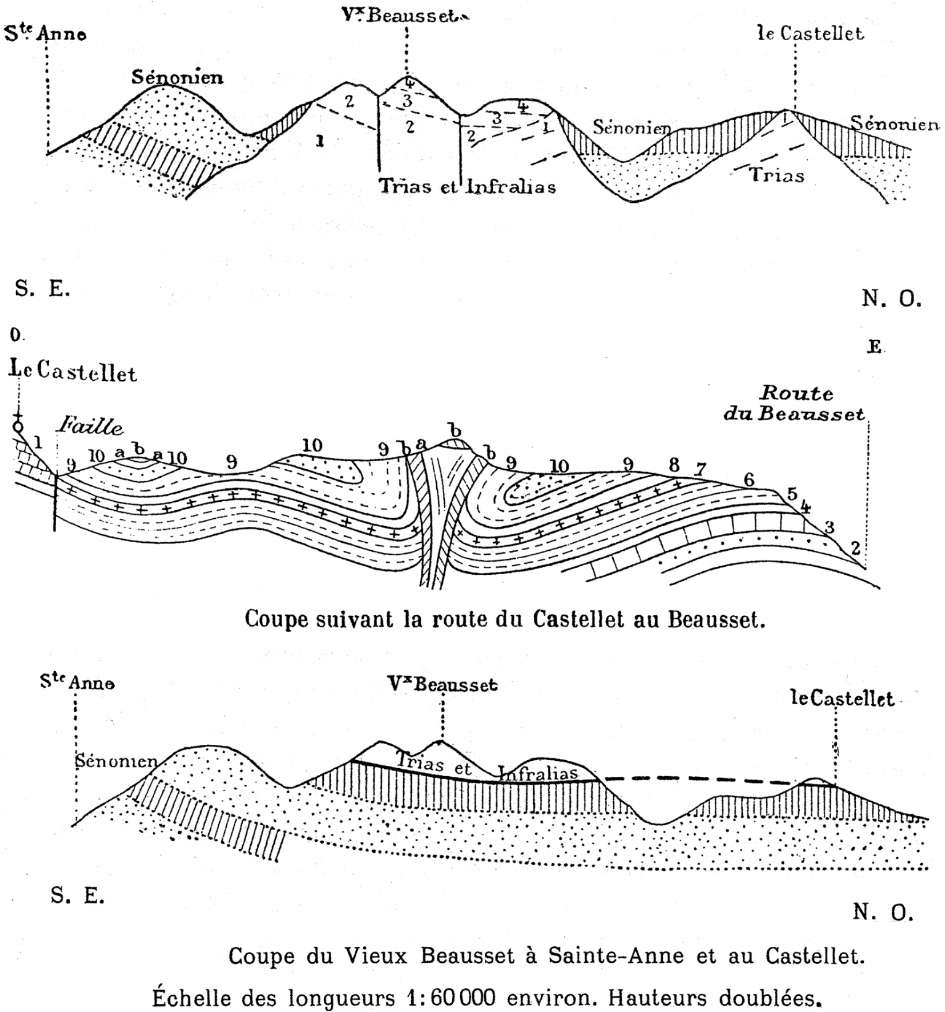
Fig. 24. Interprétations de « l'énigme du Beausset ». Coupe du haut (hypothèse de l'écueil : A. Toucas, 1873) [Extrait de M. Bertrand, 1887b]. Coupe du milieu (hypothèse de la percée du Trias : A. Toucas, 1896) [Extrait de A. Toucas, 1896, fig. 13]. a-b : Trias ; 1 à 7 : Crétacé supérieur marin ; 8 à 10 : Crétacé supérieur d'eau douce. Coupe du bas (« recouvrement », M. Bertrand, 1887) [Extrait de M. Bertrand, 1887b].
La visite d'une galerie nord-sud révèle que les horizons à lignite sont surmontés par le Trias de la colline du Télégraphe, par l'intermédiaire de minces couches de Crétacé supérieur marin, renversées (couches à Rudistes sous restes d'Urgonien).
C'est près de là que Marcel Bertrand va montrer (cf. Bertrand, 1891d, fig. 12) un des points d'affleurement d'une brèche singulière à ciment calcaire : elle se place entre le Crétacé supérieur renversé, chevauché (ici les calcaires à hippurites), et le Trias (ici le Muschelkalk) chevauchant. Il y voit (cf. Bertrand, 1887) « incontestablement une brèche de faille ». Au sud de Fontanieu, cette « magnifique brèche » englobe, dans un ciment de calcaire blanc compact, des fragments de roches allant du Muschelkalk au Turonien. Lors de la réunion de 1891, Renevier s'opposa vigoureusement à l'interprétation en brèche de faille, que Bertrand tenta de défendre par de longs arguments spécieux. En 1900, lors de l'excursion du Congrès géologique international, il reconnaîtra que la « pâte » de la brèche « ressemble à celle du calcaire à Hippurites ». Il envisagera alors « que la faille s'est formée lentement, à plusieurs reprises, et pendant plusieurs périodes géologiques », les fragments pénétrant progressivement à mesure que se déposait « la pâte encore molle ». Obnubilé par une explication tectonique, Marcel Bertrand ne pensa pas à la solution stratigraphique (Philip, 1967) : celle d'une transgression de la mer crétacée directement sur le Trias, remonté à la faveur d'un premier jeu, avant le Santonien, de la fracture qui, par la suite, amènera l'extravasion vers le nord du « pli couché » du Beausset.
La réalité de ce dernier suscitera une opposition. À la suite de la Réunion, Toucas communiquera ses remarques à « la théorie fort séduisante de la superposition du Trias sur le Crétacé [qui] semble trouver sa consécration dans l'existence de quelques lambeaux isolés à série renversée ; mais il ne faut pas perdre de vue que cette théorie rencontre à chaque pas [sic !] des objections qui prouvent qu'on ne doit pas en faire une application trop générale. Sans être systématiquement opposé à l'idée émise par M. Bertrand, on peut supposer que le Trias a sa racine dans le massif du Vieux-Beausset. » Pour la mine de Fontanieu, Toucas imagine également (1891 et 1896, fig. 14) - comme le fera Fournier (1896) - une étroite colonne triasique traversant verticalement le Crétacé et le retroussant, pour arriver vers le haut à s'extravaser en éventail, à la fois vers le nord et vers le sud. Bertrand aura beau jeu (1894, fig. 5-6) de répondre que des impossibilités géométriques sont évidentes, à l'est en particulier où aucune « colonne » de Trias ne traverse le Crétacé. Il ajoutera : « Je croyais [...] et je crois encore qu'une théorie qui a subi [...] l'épreuve d'une confrontation avec des travaux de mine est bien près d'être définitivement vérifiée. »
On ignore si Toucas assistait à la dernière séance de la Société géologique, à Brignoles, le 4 octobre 1891. Dans son allocution de président de la Réunion, Marcel Bertrand estime avoir atteint son but : celui d'avoir convaincu ses confrères « de la réalité de ces grands phénomènes de chevauchement, qui forment le trait dominant de la structure » de la Provence. Il ajoute, à propos du Beausset, qu'il y a là un exemple intéressant de la subordination involontaire des observations aux idées admises : « pour voir les choses, il faut les croire possibles ».
Ailleurs, Marcel Bertrand écrira : « Je ne crois pas m'avancer beaucoup en assurant qu'il y a au fond des objections de M. Toucas une autre objection beaucoup plus grave, qu'il ne dit pas et que bien d'autres pourtant ont dû faire avec lui : la théorie n'est pas vraie parce que la conséquence qu'on en tire est impossible ; il n'est pas matériellement admissible [cette phrase est soulignée par lui] qu'une masse de terrains chemine ainsi horizontalement à la surface, sans qu'on puisse invoquer même l'action de la pesanteur, et qu'elle puisse effectuer, sans se disloquer, un trajet de plusieurs kilomètres... ».
Les quelques semaines passées en 1891 en Provence ne seront qu'un entracte dans le programme « alpin » de Marcel Bertrand, que va couronner son double exposé de début 1894 à la Société géologique sur « les Alpes françaises ». On peut trouver l'état de ses pensées de 1890 sur la Provence dans son Mémoire sur les refoulements... (qui est cependant surtout consacré à un examen de ces phénomènes à l'échelle du globe et à toutes les époques géologiques). Avec Pierre Termier (1908), on regrettera que ce grand mémoire n'ait pas paru aussitôt écrit, car il aurait certainement eu un impact essentiel sur le développement international de la tectonique (quand il paraîtra en 1908, il sera dépassé par l'avancement prodigieux des recherches, dans les Alpes tout spécialement).
Une planche du mémoire précédent (Fig. 21) situe les nombreux exemples qu'il croyait en voir entre Marseille et Draguignan.
- Le « pli couché du Beausset » et sa prolongation sinueuse à l'est, dans les collines dominant Toulon, ont été définis en 1887, et Marcel Bertrand ne semble pas avoir changé d'avis à leur sujet par la suite. Tout au plus, la découverte en 1891 du chevauchement des « phyllades » paléozoïques sur le Permo-Trias littoral autour de Toulon lui permet d'ajouter un nouveau « pli-couché », plus méridional, poussant en quelque sorte l'arrière du « pli-couché » du Beausset.
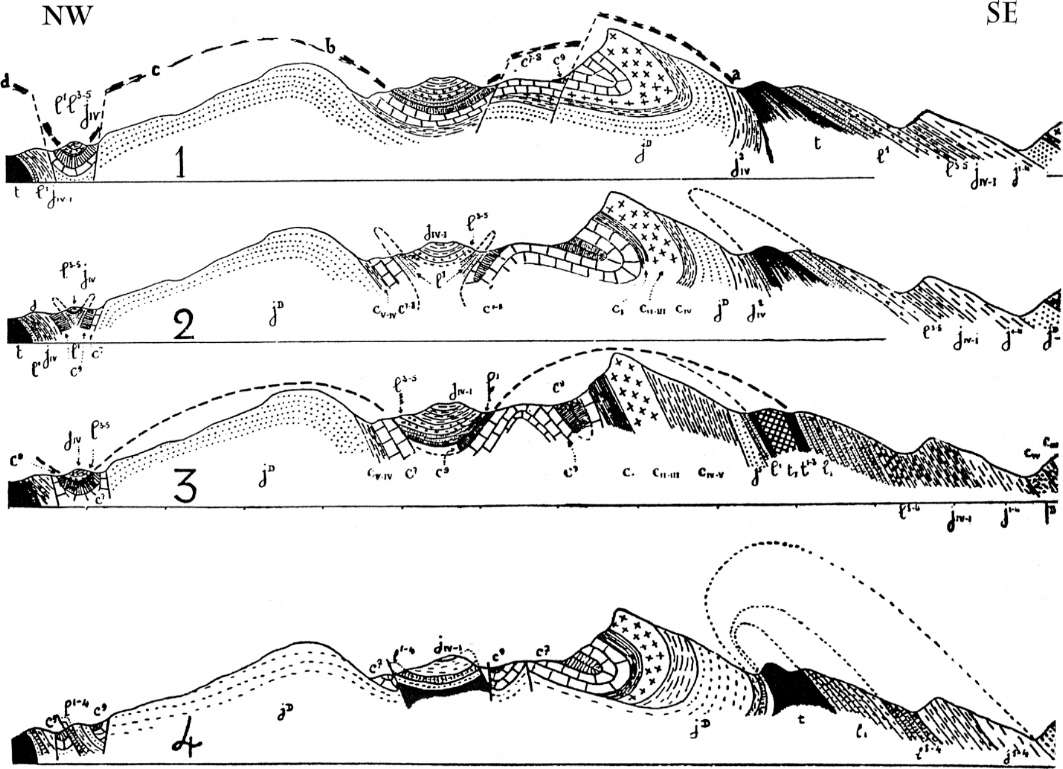
Fig. 25. Diverses coupes générales interprétatives à travers la Sainte-Baume. [Extrait de G. Corroy et G. Denizot, 1935, Guide géologique de la Provence occidentale, Marseille, pl. II].
Coupe 1 : M. Bertrand (nappe de charriage : a-b-c-d, base de la nappe replissée).
Coupe 2 : E. Fournier, 1900 (plis sinueux, en champignon).
Coupe 3 : J. Répelin, 1922 (nappe de charriage, cf. 1).
Coupe 4 : G. Corroy, 1939 (plis, failles, écailles).
t : Trias ; I1 à l3-5 : Lias ; J iv à J° (dolomies) : Dogger-Malm ; Cy à Ci : Crétacé inférieur (Cn-m : Urgonien calcaire) ; CT-2 à C9 : Crétacé supérieur.
- Le « pli-couché de la Sainte-Baume » (Fig. 25, coupe 1 de Marcel Bertrand), grand anticlinal à axe triasique, est défini en 1884. Son flanc inverse chevauche au nord le Crétacé du « synclinal du Plan d'Aups ». Comme nous l'avons vu, la définition en 1888 du prétendu « pli-couché » de Saint-Zacharie, poussé vers le sud et affrontant celui de la Sainte-Baume, poussé - lui - vers le nord, a été à l'origine de l'idée d'un « double pli provençal ». Constatant cependant la continuité cartographique, par l'ouest, des affleurements chevauchants des deux « plis-couchés », Marcel Bertrand suppose qu'il peut s'agir d'un unique « pli sinueux », ayant tourné de 180° autour du « bassin du Plan d'Aups » (Fig. 21). Cette interprétation de 1888 est rappelée dans le mémoire de 1890, mais aussitôt mise en doute (Bertrand, « 1890 »-1908, p. 113-117) : « il est probable, sans qu'on puisse l'affirmer, que le mouvement [de charriage] est seulement venu du Sud ». Dans ce cas, le « recouvrement anormal », depuis la Sainte-Baume jusqu'à Saint-Zacharie, atteindrait une dizaine de kilomètres. Ce ne sera toutefois qu'en 1900, dans le livret-guide de l'excursion en Provence du Congrès géologique international que Marcel Bertrand figurera, au nord immédiat de la Sainte-Baume, une bande charriée de Jurassique (de Roqueforcade au Vieux Nans) provenant du flanc normal chevauchant du pli-couché de la Sainte-Baume, qui a dépassé dans son déplacement vers le nord les couches du flanc renversé de ce pli.
- Les « plis-couchés » sinueux de Bras [Brignoles] et de Salernes, définis dans la zone de Draguignan d'après les levers de Zürcher, sont figurés (Bertrand, « 1890 »-1908) comme presque complètement refermés sur eux-mêmes, autour de leur centre, chevauché. Il a cependant manifestement changé d'avis à leur sujet en 1895. Tout en conservant l'idée de plis-couchés est-ouest amenant de larges « recouvrements » (par exemple celui de la Bouissière, au sud de Salernes), il ne parle plus de leur prolongation latérale en plis sinueux.
En 1890, il écrit que leur explication « reste à résoudre » (Bertrand, 1890, p. 119). Dans sa note de 1891 sur le massif d'Allauch, il parle de « l'anticlinal triasique de Saint-Zacharie » [le Trias de l'Huveaune] qui « se continue vers l'Est [et] va rejoindre la grande bande triasique de Rougiers et de Saint-Maximin. »
Le 15 mai 1893, à l'issue de « quelques observations récentes », Marcel Bertrand examine la région de Barjols et de Rians, c'est-à-dire la partie septentrionale de la Basse-Provence : le « bassin de Fuveau » [synclinal d'Aix-en-Provence] est ceinturé à l'est (Fig. 21) par un large demi-cercle d'une « grande bande anticlinale » triasique (Muschelkalk et Keuper marno-gypsifère). Celle-ci se décompose en trois parties élémentaires que séparent de courtes interruptions. La première, celle de l'Huveaune, se suit du nord-est de Marseille à Saint-Zacharie. La seconde, plus importante, va de Saint-Maximin jusqu'au nord de Barjols. La troisième, repliée vers l'ouest, est celle de Rians.
Ces bandes paraissent à première vue recouper les plis affectant les terrains jurassico-crétacés environnants. Cependant, en réalité, si le Trias des bandes est « presque partout » en contact anormal avec les terrains plus récents, les plis dans ces derniers « tantôt se raccordent avec elles [les bandes] d'une manière continue » (il doit vouloir dire qu'ils s'y parallélisent), « tantôt s'interrompent à leur approche comme s'ils avaient trouvé là un obstacle à leur propagation ». En conclusion, Marcel Bertrand voit dans ces bandes triasiques une « ligne de faiblesse, préparée par des circonstances antérieures qui restent à définir ». Autant dire que leur explication. « reste à résoudre » !
Quelle qu'elle soit, elle devra tenir compte de la position relativement anticlinale du Trias. Nous verrons qu'en 1899-1900 une solution diamétralement opposée - l'allochtonie du Trias -sera admise par Marcel Bertrand.
En 1895, Fournier - sans doute au grand dam de son patron Vasseur, en bons termes avec Bertrand - commence à contester vigoureusement la réalité des « recouvrements » du professeur parisien ! On sait que, auteur d'une thèse sur le Caucase central (que Marcel Bertrand commentera ironiquement à la suite de la visite qu'il fit de cette chaîne, lors du Congrès de 1897), Fournier deviendra professeur à la faculté des sciences de Besançon où il aura un rôle utile dans l'hydrogéologie karstique du Jura, tout en restant un farouche adversaire de la notion de charriage.
Jusqu'en 1895, Marcel Bertrand ne s'était heurté qu'aux réticences polies d'Aristide Toucas, dans le cas de l'îlot du Beausset : originaire du village, celui-ci avait pris l'attitude d'un « propriétaire » pensant connaître les lieux mieux qu'un étranger ! Le cas de Fournier est tout autre : le jeune homme, minutieux dans ses observations et très actif, n'a cure de déplaire à qui que ce soit. A partir de 1895, il va donc tout contester : le Beausset est un « pli en champignon » ; le Jurassique au nord de la Sainte-Baume (Fig. 25, coupe 2), que ce soit celui de la bande allant de Roqueforcade à Nans, ou celui des environs de Saint-Zacharie, s'enracine verticalement en s'extravasant vers le haut ; le Trias environnant le Crétacé d'Allauch, loin de représenter la base déformée d'une unité chevauchante, marque l'axe d'un pli sinueux, idée émise au moment où Bertrand l'abandonne. Ainsi, le pli de la Sainte-Baume est-il pour Fournier un grand pli sinueux, faisant par l'ouest le tour du « dôme » central de la Lare.
Selon Termier (1908), Marcel Bertrand, ébranlé par les attaques de « ce contradicteur redoutable », craignit de s'être « trompé du tout au tout sur la structure provençale ». Il décida de réexaminer le massif d'Allauch, Saint-Zacharie et le Beausset, et il en « revint rassuré » !
Il sera donc à même, en 1896, de répondre, dans un texte au ton modéré, que les « plis en champignon » invoqués par Fournier, tant au Beausset qu'à Allauch (colline du Collet Redon) lui « paraissent en principe une véritable impossibilité, au moins dans les conditions où on les invoque ».
Le ton change en 1898 : Marcel Bertrand réplique à deux notes agressives sur le massif d'Allauch et sur la Sainte-Baume, qui « inaugurent un système nouveau parmi nous », celui d'attacher une importance secondaire aux questions de priorité « et surtout de ne pas indiquer au lecteur où sont les arguments nouveaux et en quoi ils modifient l'état du problème à résoudre ». Il n'en reconnaît pas moins les faits originaux qui parfois modifient ses propres impressions, que Fournier vient d'apporter, « faits intéressants mais qui ne peuvent rien prouver pour la solution finale ». Il raille Fournier qui, dans la Sainte-Baume, « découvre, chemin faisant, la transgression du calcaire à hippurites [Crétacé supérieur sur le Jurassique], déjà si bien mis en lumière par M. Collot ; il découvre aussi la sinuosité des plis [...] ; la faille de décrochement à l'Ouest de la Sainte-Baume [...]. J'avais [ajoute-t-il] proposé et imprimé toutes ces hypothèses [...] ; j'ajoute, sans insister, que la continuation de mes études, comme je l'expliquerai prochainement, me les a toutes fait abandonner ». Et il ajoute férocement, à propos de la chaîne de l'Étoile, au nord de Marseille, dont Collot a levé « une carte très consciencieuse » : M. Fournier, qui la « cite à peine, n'a vu aucun des points oubliés sur cette carte et tout ce qu'il a ajouté est inexact ».
La réponse de Fournier n'est pas moins acide, d'autant plus qu'il vient d'être nommé chargé de cours à Besançon : « M. Marcel Bertrand a [...] émis dans ses notes sur la Provence un très grand nombre d'hypothèses sur l'explication de chaque phénomène et il est bien difficile d'en émettre une qu'il n'ait pas au moins entrevue ; je dis ceci uniquement pour montrer que je n'ai nullement l'intention de discuter sur des questions de priorité ; cette discussion serait d'autant plus oiseuse que M. Marcel Bertrand déclare lui-même qu'il a abandonné toutes ses anciennes hypothèses... »
L'avenir montrera, trois quarts de siècle plus tard, que Fournier a eu grand tort d'utiliser la notion des « plis sinueux » que Bertrand venait d'abandonner. On peut se demander si ce n'est pas la contestation maladroite - spécialement sur le Beausset - à laquelle s'est livrée Fournier qui, ramenant Bertrand en Provence, a conduit celui-ci à affirmer la structure en nappe de la Basse-Provence. Fournier eut cependant l'illusoire joie d'assister, au milieu du XXe siècle, à « la décadence du nappisme » (Fournier, 1929). Il disparut peu avant que cette notion, longtemps traitée de « théorie », devienne un simple « fait d'observation ».
Ce chaînon, dominant Marseille au nord, va apporter des éléments essentiels de réflexion à Marcel Bertrand, qui y avait fait en 1888 quelques courses avec Collot. Au début de l'hiver 1897-1898, la Compagnie des Charbonnages des Bouches-du-Rhône (exploitant les lignites du Crétacé terminal de Fuveau) voulut connaître l'opinion de l'illustre tectonicien sur le projet de « galerie à la mer » : celle-ci, déjà commencée, était destinée, sur un trajet de 14 km, à traverser en profondeur du nord au sud le massif de l'Étoile, afin d'assurer l'exhaure de l'exploitation de la mine de lignites.
Depuis 1884, Marcel Bertrand liait les « recouvrements » à des « plis couchés », tentant, parfois désespérément, de retrouver des restes de flancs inverses. Le voilà maintenant amené à prendre en considération les arguments d'A. Rothpletz qui, dans les Alpes de Suisse orientale, « a contesté depuis longtemps l'assimilation des grands chevauchements à des plis déroulés » (Bertrand, 1899). S'il n'avait pas été hésitant sur l'interprétation des Préalpes du Chablais, il aurait pu aussi citer Schardt, qui avait souligné avec force que ce massif résultait d'un charriage cisaillant, sans aucun flanc inverse de pli.
Marcel va donc battre sa coulpe : « Le massif de l'Étoile ne correspond pas à un pli anticlinal » et « le bord du massif [...] n'est pas un pli couché ; ce n'est même pas un pli d'aucune manière. Il est bordé par une faille qui plonge sous ce massif, et que surmonte une série normale, très étirée à sa base ». Sous ce large chevauchement de l'Étoile, s'enfonce une « nappe renversée », dite de Simiane : son matériel mésozoïque, couronné par du Trias en « discordance mécanique », est caractérisé par un Aptien spécial, à « faciès de Fontdouille ». La série renversée de la « nappe de Simiane » est intensément replissée, ce qui en rend parfois (quand elle est retournée !) l'interprétation délicate. Les travaux miniers (cf. Guieu, 1968-2002) ont conduit à diviser cette unité en plusieurs éléments, de polarité variée. La « nappe de Simiane » chevauche à son tour vers le nord, par la « faille du Safre », en « l'absence de tout pli », le « lambeau de Gardanne ». Cette « lame de charriage » monoclinale, traversée par la « galerie à la mer », est un épais copeau, issue de « rabotage et entraînement » de la « série fluvio-lacustre » autochtone (Sénonien supérieur du bassin de Fuveau). La série productive (lignites) est ainsi « doublée, non par un pli, mais par une faille très oblique », inclinée à 27°S, la « faille de la Diotte ».
Au front nord du « lambeau de Gardanne », enfin, les bancs calcaires de l'Éocène autochtone, formant obstacle, ont été - comme l'avait vu Vasseur - « retroussés » en donnant naissance au « pli de Bouc », exemple de « synclinaux de retroussement », qui n'ont pas d'anticlinaux complémentaires.
En conclusion de son travail, Marcel Bertrand prédit que la « galerie à la mer », alors en percement, passera certainement sous le Trias de « la Galère » (sommet de la « nappe renversée » de Simiane) - ce qui sera vérifié par la suite - et « presque certainement » sous l'Aptien de cette unité. Cette dernière prévision ne fut pas vérifiée. Fournier triomphera, mal à propos, car le niveau de la galerie semble avoir été un peu trop élevé pour s'en assurer.
Si le « lambeau de Gardanne » ne possède qu'une valeur locale, la « nappe de Simiane » se poursuit latéralement sur une trentaine de kilomètres. Vers l'est, elle passe « en tunnel sous une pointe du massif de l'Etoile, remonte et affleure de nouveau au Nord du massif d'Allauch ». La situation en fenêtre du Crétacé calcaire de ce massif est ainsi bien argumentée, ainsi que son enfoncement vers l'ouest sous la masse chevauchante de l'Étoile.
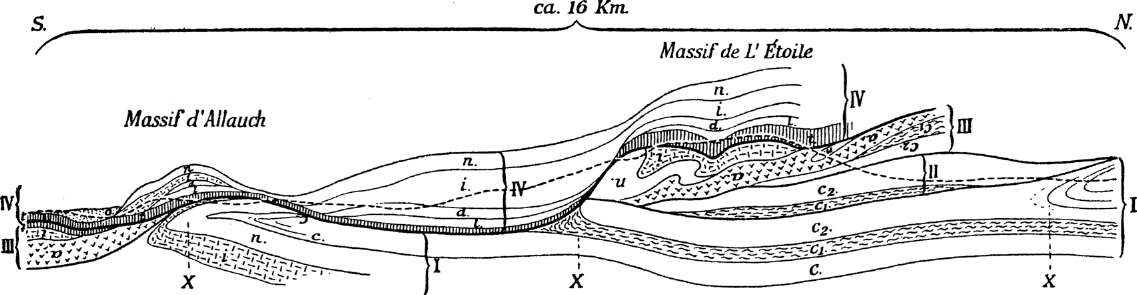
Fig. 26. Profil schématique des massifs d'Allauch et de l'Étoile dans la conception de Marcel Bertrand. Heutige Oberfläche : surface actuelle ; I : série normale et son renversement (X) ; II : lame de traînage ; III : unité en série inverse ; IV : nappe de l'Étoile, série normale. [Extrait de G. Steinmann, 1901].
Au XXe siècle, cette région a fait l'objet de nombreuses études, qui ont eu, pour la plupart, tendance à minimiser l'ampleur du chevauchement et à retrouver l'idée d'une structure en pli, plus ou moins complexe. Un historique détaillé en est donné par G. Guieu (1968-2002, p. 174181) dont les recherches ont abouti à « l'hypothèse selon laquelle l'ensemble de la chaîne est en recouvrement et qu'elle est constituée de plusieurs unités indépendantes qui, malgré toutes les arguties, ne composent ni un pli, ni un pli-faille, ni un pli couché ». On ne voit pas de différences essentielles entre la coupe de G. Guieu (1968-2002 : carte, « fig. 64 » ; section, « fig. 91 ») et celle de Marcel Bertrand (1900, fig. 4 de la planche en couleurs). G. Steinmann (1901), qui a participé à l'excursion du Congrès de 1900, a reproduit une partie de cette coupe de Bertrand. Le massif d'Allauch est replacé au sud du massif de l'Étoile (bien qu'il soit un peu latéral) : la portée totale du déplacement vers le nord de l'unité supérieure est d'environ 16 km. Sur cette coupe (Fig. 26), l'unité I est l'Autochtone de Fuveau, rebroussé dans son terme supérieur (le pli de Bouc) par l'avancée de l'unité II, qui correspond au Crétacé terminal de l'unité de Gardanne, l'unité III étant la « nappe de Simiane » en série inverse ; l'unité IV enfin correspond à la nappe supérieure de l'Étoile, en série normale.
Un problème se posait cependant : comment le grand chevauchement vers le nord de l'Étoile se poursuit-il vers l'ouest dans la Nerthe, massif qui, morphologiquement, en est la prolongation apparente ? Levant la feuille « Marseille », Bertrand (1890) avait noté, dans la partie littorale de la Nerthe occidentale, que des terrains crétacés relativement jeunes (Aptien à Turonien) apparaissent dans deux affleurements elliptiques (Valapoux et La Folie) entourés par l'Urgonien calcaire. Il y voyait alors deux bassins « d'affaissement ».
Revoyant la question, il conclut en 1899 qu'il s'agit de « deux trous, deux regards naturels » [= fenêtres] montrant le substratum tectonique, en série inverse, de l'Urgonien charrié. Refusant les objections de Répelin, il affirme que « les plateaux [urgoniens] de la Nerthe sont entièrement superposés au Crétacé supérieur, et font par conséquent partie d'une nappe de charriage, qui est la même que celle de l'Étoile ». La réalité des fenêtres de Bertrand a été longtemps niée au profit de l'idée de chevauchements indépendants et convergents. Elle est actuellement admise, en particulier à la suite d'un sondage de la Compagnie française des Pétroles réalisé en 1969. Cependant, si la Nerthe méridionale de Sausset montre bien deux unités superposées, le reste du massif, qui, plus au nord, en est séparé par une grande faille EW, apparaît être autochtone, les couches crétacées s'enfonçant vers le nord, vers la partie axiale du grand synclinal de l'Arc. Ainsi, la relation de l'unité chevauchante de la Nerthe méridionale (Sausset) avec le chevauchement oriental de l'Étoile, décalée par le jeu d'une grande faille SW-NE (de Graffiane) à jeu sénestre, pose toujours des problèmes. En 1899, Marcel Bertrand écrivant « je reprendrai cette question », avait présumé de ses forces...
Coupe de la Chaîne de la Sainte-Baume à la Bourine, d'après Marcel Bertrand (Lioret-guide des Excursions en France du VIII" Congrès Géologique International, Paris, 1900. XX, Basse-Provence, pl. finale, fig. 2).
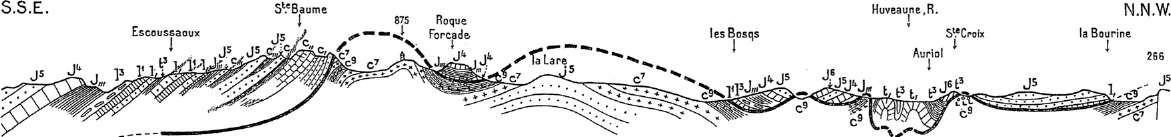
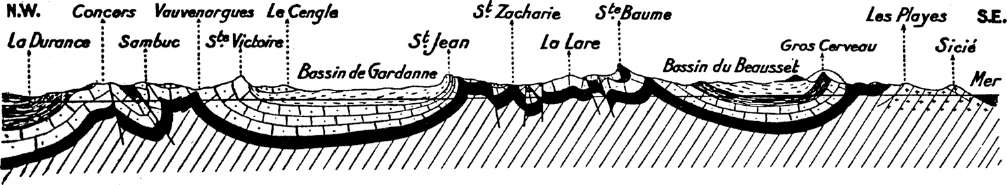
Fig. 27. Deux conceptions de la structure de la Provence. En haut : la « grande nappe de recouvrement de la Basse-Provence » selon M. Bertrand [Extrait du Livret-guide, Excursion XX du 8e Congr. géol. int., Paris, (M. Bertrand, 1900c), planche finale, fig. 2]. Longueur de la coupe : 20 km. En bas : interprétation autochtoniste [Extrait de G. Corroy & G. Denizot, 1935, fig. 13]. Longueur de la coupe : 65 km. Noter que les deux coupes ont une orientation inverse.
Les publications de 1898 annonçaient que Marcel Bertrand venait de changer d'avis sur l'interprétation générale de la structure provençale. Il abandonnait l'idée de la liaison obligatoire entre recouvrements et plis couchés. À des chevauchements indépendants allait se substituer la définition d'une unique grande nappe de charriage, déplacée du sud vers le nord. Pour bien saisir la pensée de Marcel Bertrand, il faut combiner la lecture de sa grande note de 1899 et celle du livret-guide, illustré par une belle planche de coupes, écrit pour l'excursion à l'automne 1900 du Congrès géologique international de Paris (Fig. 27, coupe du haut).
a) Dans l'introduction de la note de 1899, Marcel Bertrand explique pourquoi il a changé d'opinion. Il rappelle d'abord son ancienne hypothèse, celle de plis couchés. Leur manque de continuité latérale était expliqué par l'existence de « dômes en chapelet », partiellement enveloppés par des plis couchés périphériques (« sinueux »). Ces deux notions - dômes et chevauchements - paraissant antinomiques, Bertrand rappelle que son adversaire Fournier a privilégié l'hypothèse des dômes, considérant les chevauchements comme dus à des « plis en champignon ». Mais une telle structure lui paraît inadmissible. Si l'existence de certains dômes (comme la Lare) est certaine, Marcel Bertrand s'est assuré aussi, après avoir beaucoup hésité -dit-il - que les recouvrements qu'il avait précédemment décrits étaient bien réels.
Il considère maintenant qu'au lieu de chevauchements dispersés liés à des plis sinueux, « il a existé sur tout le Nord de la région [de la Basse-Provence] une grande nappe de terrains charriés horizontaux, et que cette nappe a été plissée postérieurement avec le substratum ». Le déplacement horizontal a été « d'au moins trente kilomètres ». Si l'imagination s'en effraie, on doit se souvenir qu'il existe des charriages de plus grande ampleur dans les Alpes suisses, en Scandinavie et ailleurs. « A mes yeux [ajoute-t-il] le plus ou moins grand nombre de kilomètres importe peu [...] du moment que le mécanisme même du phénomène ne suscite pas d'obstacles qui entravent sa marche. »
b) Argumentation du grand charriage. Marcel Bertrand (1899) s'étend à nouveau longuement sur le chevauchement de l'Étoile.
À l'autre extrémité de la Basse-Provence, la région de Draguignan ne sera pas abordée : il ne l'a pas ré-étudiée et il ne voit pas « encore se dégager une solution d'ensemble » : il envisage « un autre mémoire » dans l'avenir.
C'est donc la partie médiane, celle de la Sainte-Baume, qui va justifier la nouvelle interprétation. Il comptait, nous dit-il, joindre la description de ce massif à sa note (de 1899) : sa nouvelle étude, « à peu près terminée » doit « paraître prochainement ». De même, plus au nord, les massifs situés au sud du bassin de Fuveau (zone de Saint-Zacharie à Saint-Maximin), en particulier l'Olympe, « seront prochainement décrits en détail ».
Hélas, rien de tous ces projets ne se réalisera : les épreuves familiales et la maladie annihileront l'activité scientifique de Marcel Bertrand. Nous devons donc chercher l'argumentation en faveur de la « grande nappe » dans quelques phrases de la note de 1899, qu'heureusement complètent les coupes dessinées dans le livret-guide de 1900.
i) La Sainte-Baume. Le flanc renversé du pli-couché chevauchant possède un épais Crétacé inférieur (Urgonien et Aptien). L'Autochtone situé plus au nord montre la transgression du Crétacé supérieur sur le Jurassique, par l'intermédiaire de bauxites. Bertrand, autrefois hésitant, accepte maintenant l'observation de Collot à ce sujet et y trouve la preuve du « rapprochement mécanique de deux unités déposées à grande distance l'une de l'autre » : ce que Lugeon qualifiera un jour (in Fabre-Taxy et Gueyrard, 1950) de charriage de la « Provence à Urgonien » sur la « Provence à bauxites ».
ii) Les unités au nord de la Sainte-Baume. La continuité cartographique entre le Jurassique du flanc normal du pli-couché de la Sainte-Baume et la bande jurassique allant de Roqueforcade à Nans atteste qu'il s'agit de la même unité chevauchante : Marcel Bertrand s'en est assuré à nouveau. De même, 8 km au nord, les éléments jurassiques qui, de part et d'autre de l'Huveaune (en particulier les collines d'Auriol au nord), reposent sur le Crétacé supérieur, sont des témoins de la même grande nappe. Et selon Bertrand, au nord-est de là, le grand massif de l'Olympe serait lui-même en recouvrement. Bertrand l'avait suggéré dès 1890 dans son Mémoire sur les refoulements... : « il se pourrait que, près de Saint-Maximin, le petit affleurement crétacé [= Crétacé supérieur] de Berne [...] fût à considérer comme un regard ouvert sur le substratum des masses jurassiques [du massif de l'Olympe] ; mais en tout cas, à l'Oratoire Saint-Jean, à 12 km plus à l'Ouest, les preuves du recouvrement sont absolument nettes... ». Actuellement, si, en ce dernier point, le chevauchement vers le nord de l'Olympe est unanimement accepté, il n'en est pas de même pour étendre l'interprétation à la totalité du massif qui, pour beaucoup, serait autochtone, le Crétacé de Berne (et d'autres affleurements analogues) étant le résultat d'affaissements. Il faut cependant mentionner qu'en 1979, Gérard Guieu et Claude Rousset, changeant leur manière de voir, ont repris l'interprétation allochtoniste de Bertrand sur l'Olympe, portant ainsi la flèche de l'unité de la Sainte-Baume (s. l.) à une trentaine de kilomètres.
iii) Le problème des « fenêtres » au sud de la Sainte-Baume. Au pied sud de cette chaîne (à Chibron et près de Signes), Marcel Bertrand avait cartographié de petits affleurements de Crétacé terminal détritique, les interprétant d'abord (Bertrand, 1891, p. 1132-1134) comme jalonnant une ligne E-W de « bassins d'affaissements », limités par des failles verticales. En 1900 (Bertrand, 1900, pl. XII, fig. 1 et 6), il change d'avis : entre Signes et Méounes, ce Crétacé apparaîtrait en fenêtre, s'enfonçant avec des contacts redressés sous le Trias environnant, appartenant à l'Allochtone de la Sainte-Baume. Il étend cette interprétation plus à l'ouest, à Chibron, « à l'état d'hypothèse ». Les auteurs récents, ayant repris la cartographie détaillée de cette zone difficile, rejettent l'idée de fenêtres et privilégient la première option de Bertrand, celle de bassins d'effondrement.
iv) L'interprétation allochtone des « bandes triasiques ». En 1893 (voir plus haut), Marcel Bertrand s'interrogeait sur la signification, qu'il jugeait « anticlinale », de cette unité. En 1900, il affirme que « toute la bande triasique, de Marseille à Saint-Zacharie, et de Saint-Maximin à Barjols » appartient à sa « grande nappe de recouvrement », ou, plus précisément, à « une nappe indépendante, sujette à des renflements et à des étirements successifs, comme si elle avait, en certains points, comblé les inégalités du substratum ». Il appuie son interprétation sur deux affirmations : d'abord, malgré son intense plissement, le Trias ne montre pas le moindre affleurement d'un substratum paléozoïque ; ensuite, la bande triasique apparaît « comme un corps étranger » placé en travers des plis du Jurassico-Crétacé, à la manière d'« un terrain récent et discordant, comme l'Oligocène qui la surmonte ». Cette interprétation audacieuse l'amène à estimer à 40 km l'ampleur du charriage de la « grande nappe ». Elle n'a pas été acceptée par la suite. L'explication des bandes triasiques de Provence reste encore à trouver !
v) Le problème de la base sud-est de la « grande nappe ». Au-dessus du Permien transgressif sur le socle des Maures, les terrains secondaires ont glissé en un « mouvement d'ensemble, en se froissant et en s'accidentant ». Les synclinaux, formés de Jurassique, avec parfois des restes de Crétacé « s'arrêtent brutalement, limités comme à l'emporte-pièces, par une faille périphérique ». Marcel Bertrand s'est borné à cette constatation. Peut-être a-t-il exprimé son point de vue final dans une lettre adressée à Lugeon (datée par erreur du 6/11/1908 ! in Fabre-Taxy et Gueirard, 1950) : « J'ai revu la Provence et tiens bien maintenant la solution. C'est un peu moins que ce que je vous disais. La grande nappe ne vient pas de derrière les Maures, et elle est certainement continue avec le substratum du Beausset, mais c'est encore un joli morceau. »
vi) Le destin de la notion de « grande nappe de recouvrement ». Cette conception a été reprise par Émile Haug (1925) qui, à l'issue de longues recherches sur le fond topographique nouveau à 1/50 000, n'a pas, lui non plus, pu achever de publier ses résultats sur la tectonique provençale. Collaborateur puis successeur de Vasseur, Joseph Répelin, après maintes hésitations et sauf sur certains sujets (la Nerthe en particulier), a accepté le point de vue de Marcel Bertrand (Fig. 25, coupe 3). Après 1930, époque du reflux général et mondial de la théorie des charriages, la Provence a été présentée comme un pays de plissements réguliers, sauf le chevauchement local du Beausset et le pli-couché de la Sainte-Baume (Fig. 27, coupe du bas). Georges Corroy et Georges Denizot, professeurs à la faculté de Marseille, ont écrit (1935) dans le livret-guide d'une réunion interuniversitaire : « les plis de Provence occidentale correspondent à des plis de couverture dans une chaîne de fond », en se basant sur le modèle pyrénéen de l'époque. Et d'ajouter : « Nous sommes obligés de déclarer que le célèbre mémoire de 1899 [de Marcel Bertrand] sur "la grande nappe de recouvrement de la Basse-Provence" est une oeuvre regrettable ». À l'automne 1950, une réunion destinée à « commémorer le cinquantenaire des oeuvres de Marcel Bertrand » en Provence s'avéra surtout consacrée à soutenir la doctrine anti-nappiste : parmi les personnalités de divers pays invitées par Georges Corroy, il n'y eut guère que Maurice Lugeon et Sir Edward Bailey pour défendre les conclusions essentielles de Bertrand.
Le mouvement du pendule s'inversa quand Jean Aubouin (1962) et ses élèves retrouvèrent la plupart des recouvrements de Marcel Bertrand au nord de la Sainte-Baume et dans le massif d'Allauch, évitant cependant de parler de nappe et préférant user du terme de « chevauchement sud-provençal ». Sous l'impulsion de Gérard Guieu (1968-2002), les géologues de Marseille établirent par des levers détaillés que la plupart des conclusions de Marcel Bertrand se vérifiaient, à l'exception notable de celles sur la Nerthe et sur les bandes triasiques. Une Réunion extraordinaire de la Société géologique en 1985 à Marseille constitua le point d'orgue de la réhabilitation des idées de Marcel Bertrand.
Outre la mise en évidence de l'allochtonie de l'édifice sud-provençal, ce dernier a établi quelques faits essentiels : 1) Suess, suivant Saussure, avait considéré les Pyrénées comme une chaîne alpine isolée. Marcel Bertrand affirma dès le début que, par la direction de ses plis et l'âge de ces derniers, la Provence en était la suite, « sorte de trait d'union [entre] les Alpes et les Pyrénées » (Bertrand, 1890-1908). 2) L'âge moyen des grands mouvements de la Provence se place vers la fin de l'Éocène, comme dans les Pyrénées, mais la formation de ces structures « exige une durée très longue, correspondant au dépôt de plusieurs étages géologiques », écrit-il dès 1890. Il exprime en particulier l'idée de plis fini-crétacés, qui seront mis en valeur au XXe siècle par Léon Lutaud et ses émules. Si « le Rognac » apparaît généralement en concordance sur le Crétacé plus ancien, il note (d'après Collot) que, dans la Nerthe, ses couches sont discordantes sur le Jurassique : « Il faudrait en conclure que le pli de la Nerthe avait déjà commencé à s'accuser et même avait subi des dénudations avant la fin du Crétacé supérieur ». De même, à l'est de la Sainte-Baume, « les poudingues tertiaires » [il reconnaîtra en 1899 qu'il s'agit de Crétacé « à oufs de Reptiles»], recouverts tectoniquement par le Jurassique et par le Trias, « sont en certains points presque uniquement formés de gros fragments des terrains voisins, émergés : par conséquent un pli avait déjà commencé à se dessiner avant que le pli voisin ait commencé son mouvement de charriage ou de transport horizontal ».
Ces propositions se retrouveront sous la plume des successeurs de Marcel Bertrand en Provence. Il fut un grand précurseur, et l'on doit regretter qu'il n'ait pu nous délivrer sa synthèse finale.
Selon Pierre Termier (1908), la lecture de l'ouvrage de Suess sur la formation des Alpes (Die Entstehung der Alpen, 1875) jeta Marcel Bertrand « dans un enthousiasme sans bornes ». Le maître autrichien y affirmait l'unité de la chaîne alpine d'Europe, et l'importance des poussées tangentielles vers un avant-pays. Dès 1884, Marcel va s'en inspirer, en interprétant les coupes d'Albert Heim sur les Alpes de Glaris et en décrivant le pli-couché de la Sainte-Baume en Provence.
A partir de cette date, il va combiner ses recherches de terrain et des travaux de réflexion ou de synthèse sur les grands problèmes de la géologie. En voici les principaux stades :
-
- En 1887, dans La Chaîne des Alpes et la formation du continent européen, il commente le premier tome de Das Antlitz der Erde de Suess.
- En 1890, il termine son grand Mémoire sur les refoulements... que, insatisfait, il retire de l'impression. Les conclusions essentielles s'en retrouvent en 1892 (« Les récents progrès de nos connaissances orogéniques ») et en 1894 dans sa Notice de candidature à l'Académie des sciences.
- A partir de 1892, Marcel Bertrand commence à vouloir définir des lois des déformations de l'écorce terrestre. En 1894, au Congrès de Zurich, il prononce sa célèbre conférence, à propos des Alpes françaises, sur la « récurrence de certains faciès sédimentaires » dans les orogènes.
- Au début de 1900, faisant intervenir le principe de l'isostasie, il essaye de trouver les lois cinématiques régissant la formation des chaînes de montagne.
Les conclusions de Marcel Bertrand paraissent banales aujourd'hui, ce qui atteste leur succès. On doit se souvenir qu'elles ont été proposées il y a 125 ans et, pour beaucoup d'entre elles, s'ajoutant à l'oeuvre d'Eduard Suess, elles représentaient alors une véritable révolution conceptuelle.
La notion de compression latérale, entraînant la production de terrains « charriés », est utilisée dès ses premiers travaux (Bertrand, 1884) sur le Jura externe, où il s'agit d'accidents à portée hectométrique. La même année, il trouve la solution élégante d'une « masse de recouvrement » unique pour remplacer l'idée du « double-pli » de Glaris, mais il conserve l'idée d'un pli couché, héritée de Heim. De 1884 à 1898, il va être prisonnier de la relation, qu'il juge obligatoire, entre « recouvrements » et « plis couchés ». La découverte du pli-couché de la Sainte-Baume en 1884 puis, en 1887, celle du pli dont émanent les « îlots de recouvrement » du Beausset en sont deux illustrations, qu'il généralisera à tort.
Rappelant les exemples de Glaris, des Alpes vaudoises (Renevier) - dans la chaîne alpine -, du bassin houiller franco-belge à l'Hercynien et de l'Écosse au « Silurien », Marcel Bertrand (1887a) souligne que « au moins à trois époques différentes de l'histoire du globe », les « refoulements » sont « comme une phase normale des grands recouvrements orogéniques ». Le 14 mai 1888, apprenant que des « recouvrements » viennent d'être signalés dans les Rocheuses et dans l'Himalaya, il triomphe : « je tiens [...] à noter la rapidité inespérée avec laquelle se vérifient mes prévisions sur la généralité de ces phénomènes ».
Une autre notion, celle-là malheureuse, est développée en 1888 : celle des « plis sinueux », chaque pli anticlinal se déversant sur le synclinal qui le borde. Rendant un singulier hommage au promoteur de la « théorie des soulèvements », Bertrand ajoute, pour défendre sa thèse sur les plis couchés, que « l'indication première du phénomène se retrouve implicitement dans les pages célèbres où Élie de Beaumont a formulé ses idées sur le soulèvement des montagnes. « L'écorce de la planète - dit-il - tend à diminuer son ampleur incommode par la formation d'une sorte de rempli. L'expression est vague, mais M. de Chancourtois en a précisé [en 1871] le sens dans une figure schématique, qui ne laisse place à aucune ambiguïté : le pli couché avec recouvrement... » On veut bien le croire !
C'est surtout le mémoire de 1890 (imprimé en 1908) qui permet de connaître les idées principales de Marcel Bertrand :
1. Fait de base : « ce sont les refoulements horizontaux qui ont formé les chaînes de montagne ». Si elle est « l'origine la plus vraisemblable des tensions et compressions développées dans l'écorce », « la thèse du refoulement latéral n'est pas liée d'une manière nécessaire à celle du refroidissement de notre planète » (Bertrand, 1890, p. 236).
2. Les refoulements résultent du développement horizontal de grands plis couchés : « Le point de départ du phénomène est donc partout un paquet de couches amenées en saillie et repliées sur elles-mêmes » (Bertrand, 1894b). Confronté au chevauchement de l'Étoile en Provence, ses yeux se dessilleront en 1898 : il constate là qu'aucun pli n'est à l'origine de ce considérable charriage. Il aurait pu être ébranlé, l'été 1891, par ce que lui montrèrent les géologues d'Écosse : les surfaces de chevauchement (Thrust Planes), en particulier la supérieure - celle du Moine - ne montrent aucune trace de couches renversées : Bertrand suppose bizarrement que cela peut s'expliquer par l'ancienneté de la chaîne calédonienne, la différence de plasticité des roches, « brisées » et non « plissées », pouvant être due à la moindre épaisseur des couches superposées.
3. L'amplitude des déplacements « atteint certainement quinze km, et l'on peut présumer qu'en bien des points elle a été beaucoup plus grande encore ». En 1894, il remarque que les chiffres sont « des minima », que - si l'on accepte son hypothèse de Glaris - la portée peut atteindre 50 km ; et que, en Scandinavie, Tornebohm a pu parler de 100 km (Bertrand avait longtemps été réservé sur ce charriage).
4. Des étirements considérables, voire l'ablation occasionnelle de certaines couches dans les flancs inverses des plis couchés, sont fréquents, du fait que les surfaces de stratification sont des surfaces de glissement faciles. Ils peuvent être à l'origine du détachement de « lambeaux de poussée » (terme de Gosselet). L'étirement des couches peut également s'observer dans les flancs normaux des plis couchés. Quand tel ou tel niveau manque dans la succession stratigraphique, Marcel Bertrand a une tendance systématique à y voir le résultat d'un décollement avec élimination tectonique locale. Nous savons qu'il fut long à admettre (seulement en 1898) qu'au nord de la Sainte-Baume (massif de la Lare), le contact direct du Crétacé supérieur sur le Jurassique correspondait à une surface de transgression, comme Collot l'avait affirmé. À Allauch (Bertrand, 1891c), il observe un phénomène analogue : le Crétacé supérieur à hippurites repose directement sur les calcaires néocomiens. À première vue, dit-il, on ne semble pouvoir interpréter ce fait que comme résultant de « lacunes de sédimentation » (cf. Collot, en 1889-1890). Cependant, au terme d'une discussion filandreuse, il lui semble « plus vraisemblable d'y voir le résultat de glissements postérieurs » à la sédimentation. Une fois de plus, il privilégie à tort l'hypothèse tectonique à l'observation stratigraphique...
5. Dans les « masses charriées », on peut observer des « trouées ou échappées sur le substratum », qu'il nomme ailleurs « regards » (ce sont nos « fenêtres »). Inversement des « îlots de recouvrement » - tels ceux du Beausset - représentent des éléments résiduels des « masses de recouvrement ». Bertrand les compare explicitement aux « Klippen » des Alpes suisses qui, à ses yeux, peuvent avoir la même origine.
6. Les idées de « rabotage » des séries chevauchées et de charriage sur relief émergé sont proposées à propos du Beausset, où le Trias charrié repose sur divers niveaux du Crétacé sous-jacent (Bertrand, 1890, impr. 1908, p. 80) : « Il faut donc [...] en conclure que le rabotage [il souligne !] de la surface sur laquelle a été effectué le glissement a été irrégulier. Ou, peut-être encore, que cette surface avait déjà été exposée à des dénudations atmosphériques avant le complet déroulement du pli ». Répelin et Lutaud qui, par la suite, se disputeront en Provence la priorité de l'idée, savaient-ils que Marcel Bertrand y avait pensé longtemps avant eux ?
7. S'il s'accorde avec Suess sur bien des conclusions, il en discute certaines autres. Ainsi considère-t-il (Bertrand, 1887a) que les affaissements - dont Suess fait grand cas - ne sont prouvés que dans les zones où des sédiments déposés à faible profondeur s'accumulent sur de grandes épaisseurs. Et il demande à Albert de Lapparent (qui critiquait Suess à ce sujet) d'être « au moins indulgent pour ceux qui voient dans les affaissements le plus important des mouvements de l'écorce » !
8. En 1887, Bertrand approuve la règle de Suess sur la dissymétrie des chaînes de montagne : « le mouvement de plissement [...] a certainement été progressif, se propageant de la zone centrale [des Alpes] vers le Nord », sans cependant qu'on puisse savoir si le mouvement a été unique, continu et régulier, ou s'il se décompose en une série de mouvements relativement brusques (cf. les futures « phases » de Stille). En 1888, sa pensée a évolué : il privilégie l'idée de « saccades », mais les mouvements se propagent de l'axe « vers les parties périphériques, c'est-à-dire vers les deux bords septentrional et méridional [des Alpes] ». Il exprime cette idée, alors qu'il n'a pas encore abordé l'étude des Alpes cottiennes dont la « structure en éventail », affirmée en 1892, « semble de plus en plus la structure normale des grandes chaînes ». Et cela bien qu'il existe « presque toujours une dissymétrie marquée des deux versants [de la chaîne] ». Il note aussi que, si une grande chaîne se divise en deux rameaux divergents, séparés par un « îlot d'ancienne consolidation », chacun des rameaux n'est « qu'une moitié de chaîne » : il fait allusion au couple Carpathes-« Alpes illyriennes » (Dinarides), séparées par ce qui sera nommé un jour « Massif médian » (Zwischengebirge).
On doit à Suess la définition des trois grandes chaînes du continent eurasiatique, d'après la continuité des zones de plissement et non par leur direction, qui est variable. Ces chaînes se succèdent du nord au sud dans l'hémisphère nord.
Le 21 mars 1887, Marcel Bertrand va présenter à Paris et commenter les propositions que vient de faire Suess dans le premier tome de l'Antlitz.
-
a) La « chaîne alpine » (Bertrand, 1888). Le « système des Alpes » défini par Suess (dont l'existence avait été soupçonnée par Ami Boué, de l'Europe à l'Himalaya) a été défini d'abord de la Suisse à la Roumanie. L'unité de cette chaîne est mise en lumière par la continuité, au nord de l'édifice montagneux - et chevauché par lui - d'un « canal » de flysch « à Fucoïdes » (Crétacé supérieur-Éocène) qui, lui-même, chevauche vers le nord des terrains miocènes transgressifs sur l'avant-pays. En 1888, Bertrand étendra le terme de « chaîne alpine » : « celle des grands mouvements tertiaires [qui] embrasse presque toute la région méditerranéenne au Sud des Pyrénées, des Alpes, des Carpathes et des Balkans ».
b) La « chaîne hercynienne » (Bertrand, 1887). Il réunit sous ce terme l'édifice où Suess a distingué un « arc armoricain » nord-ouest / sud-est et un « arc varisque » sud-ouest / nordest. Cette chaîne est définie, à cette époque, au moins de la Bretagne à la Silésie (à la fin de sa vie, Suess l'étendra en Asie, qualifiant l'ensemble d'« Altaïdes »). Dans son cours à l'École des mines, Bertrand parlait de « chaîne houillère », avant de proposer le regroupement des deux « arcs » de Suess en une « chaîne hercynienne », conscient cependant que cette appellation avait été pré-employée dans un sens différent par Leopold von Buch. Si l'édifice est « anté-permien » pour Suess, Bertrand remarque que les mouvements ne se sont pas arrêtés avant la fin du Permien.
c) La « chaîne calédonienne » (Suess, 1886) montre en Écosse, où elle a été définie, le chevauchement vers le nord-ouest, dans la région du Moine, de gneiss sur le Silurien à graptolites. Bertrand en prolonge la direction dans les « Alpes scandinaves » dont il pensait en 1887 que le déplacement s'était fait vers le nord-ouest, comme en Écosse.
d) Le bord septentrional de la chaîne calédonienne chevauche un « continent arctique » (ou « continent archéen ») « sans doute [...] résultant de ridements plus anciens ». La « chaîne huronienne » (Bertrand, 1888), définie d'après le lac Huron, serait une « quatrième zone » de plissements, plus ancienne et plus septentrionale que les autres, allant du Canada au nord de la Chine. Elle montrerait plusieurs discordances, dont deux surtout semblent générales et importantes : la première entre les « gneiss » profonds et « le Précambrien » [l'actuel Protérozoïque] ; la seconde entre ce « Précambrien » et les terrains à « faune primordiale » [Cambrien p. p.]. Le terme « huronien » a perdu son intérêt, du fait de la multiplicité, constatée au milieu du XXe siècle, des orogenèses antécambriennes.
e) La liaison entre chaînes d'Europe et chaînes d'Amérique du Nord, sous l'Atlantique, a été concrétisée par une célèbre figure (Bertrand, 1887a, fig. 5). La chaîne calédonienne d'Écosse se retrouverait dans les « Montagnes vertes » (Green Mountains), partie nord des Appalaches, où le Silurien est « plissé avec failles et renversements ». Les plissements hercyniens du sud de l'Irlande se retrouveraient dans les Alleghanys, au sud des Appalaches, où les terrains primaires - dont le Carbonifère - sont plissés. Il en va différemment pour la chaîne alpine : l'arc de Gibraltar (convexe vers l'ouest) et l'arc des Petites Antilles (convexe vers l'est) se tournent le dos : il n'y a « sans doute » pas de prolongation sous-marine entre ces deux chaînes d'âge « alpin ».
Les propositions de Marcel Bertrand, concernant les orogènes calédonien et hercynien, restent valables, évidemment en tenant compte de l'écartement ultérieur des deux « plaques » suivant un mécanisme « wegenerien ».
f) La reconstitution géographique - à partir des documents connus à l'époque - des « zones successives de plissement en Europe » fut l'objet de tentatives concurrentes de Suess et de Bertrand. De ce dernier, un premier essai, sommaire (Bertrand, 1887a, fig. 4) est inspiré par la lecture de l'Antlitz. Par la suite (Bertrand, 1888a, fig. 1), dans un dessin plus élaboré, le parcours sinueux de la « zone alpine » est parfaitement dessiné. Deux longues « apophyses hercyniennes » (l'ibérique ; et celle allant des Alpes carniques au Rhodope) séparent deux rameaux : le rameau nord va des Pyrénées au Caucase, par la Provence, les Alpes, les Carpathes et la chaîne du Balkan ; le rameau sud, bouclé à l'ouest à Gibraltar (cf. Suess) réunit chaîne bétique, Atlas d'Afrique du Nord, lié à l'Apennin par l'arc calabro-sicilien, fait le tour de l'Adriatique, se prolonge dans les Dinarides, le sud de la Turquie et le Zagros. Un siècle plus tard, cette figure garde sa pertinence.
g) Étonnante prescience que celle de Marcel Bertrand en 1892, quand il conclut de l'importance des phénomènes de charriage des Alpes et de la Provence : « On ne saurait plus contester que, pour former les Alpes, l'Afrique ne se soit rapprochée du Sud de l'Europe ; les déplacements horizontaux constatés entre les mâchoires de ce gigantesque étau ne sont évidemment qu'une fraction de leur rapprochement total... »
Plus problématique est sa prévision (Bertrand, 1887a) d'une nouvelle chaîne, au sud des trois précédentes : « Il est probable qu'on doit s'attendre aujourd'hui à voir une quatrième vague se former en arrière des Alpes, c'est-à-dire dans la région méditerranéenne [...] mais nous ne saurons jamais si l'attente [.] sera réalisée ou déçue ».
Les lectures de Marcel Bertrand l'ont amené, une fois la suite des grandes chaînes établie, à étudier leur évolution, magmatique comme sédimentaire. Et il conclut que celle-ci se retrouve d'un édifice à l'autre : c'est « l'orogenèse programmée » (Ellenberger, 1982).
-
a) Les « relations des phénomènes éruptifs avec la formation des montagnes »
(Bertrand, 1888a). On supposait jusque-là qu'une série « ancienne » de roches éruptives se distinguait d'une série « récente ». Bertrand pense que les roches éruptives sont les mêmes dans toutes les chaînes plissées, et qu'elles apparaissent toujours dans le même ordre, leur composition et leur structure ne variant pas globalement d'une chaîne à l'autre, avec succession de trois stades : a) stade initial : montée de granites dans la partie axiale de la chaîne (là où débutent les mouvements tectoniques) ; b) stade ultérieur : éruptions « porphyriques », alternativement acides et basiques, dans une zone centrale mais avec un léger recul ; c) stade final, postérieur aux derniers mouvements : éruptions basiques (trapps et diabases).
Marcel Bertrand hasarde une explication pour cette évolution : dans les profondeurs de la croûte, des « silicates fondus » occuperaient de « vastes lacs » (à la manière des laccolites américains) qui alimenteraient une série d'éruptions. Leur refroidissement progressif et leur solidification épuiseraient d'abord la potasse (dans les granites) puis la silice (dans les « porphyres » acides). Deux catégories de roches éruptives échappent au groupement précédent (Bertrand, 1894b). Ce sont d'abord les traînées volcaniques de l'Atlantique et de l'océan Indien, « qui ne se relient à aucun plissement connu et semblent seulement en rapport avec le bord des grandes dépressions océaniques ». Ce sont aussi « les roches basiques qui accompagnent le premier remplissage des géosynclinaux (orthophyres du Culm, pietre verdi des Alpes, serpentines et euphotides du Flysch) ». Nous savons que ces deux dernières catégories font partie, dans les Alpes et les Apennins, des ophiolites jurassiques, antérieures au début du phénomène orogénique.
Ainsi Marcel Bertrand a-t-il affirmé que, dans chaque grande chaîne, les phénomènes magmatiques suivent le progrès du plissement en se différenciant progressivement. « Il est étrange - a souligné François Ellenberger (1982) - que le mérite de cette conception soit communément attribué à Hans Stille, en omettant toute référence à Marcel Bertrand, qui avait exprimé des idées analogues 52 ans avant lui ». En 1988, W. E. H. Carlé a pris connaissance avec surprise de l'article d'Ellenberger. Il a reconnu la priorité de Bertrand (« eine zeitliche Aufeinanderfolge, die genau derjenigen von Stille entspricht »).
b) La cyclicité des venues métallifères. Dans le même article, Marcel Bertrand étend sa conclusion aux gisements de métaux. Ceux-ci présenteraient également une certaine cyclicité, qui se reproduit d'un orogène à l'autre. Ainsi les venues cuprifères importantes se rencontrent dans les grès terminant chaque cycle orogénique : grès « archéens » du lac Supérieur ; Vieux grès rouges d'Écosse ; grès permiens d'Allemagne.
c) La cyclicité des types sédimentaires. Le 1er septembre 1894, Marcel Bertrand consacre une conférence de clôture du Congrès de Zurich à ce sujet, éblouissant Suess, le jeune Lugeon ayant de son côté ressenti « une réelle extase en écoutant le grand maître » (in Fabre-Taxy et Gueyrard, 1950) ! Pour illustrer les stades de sédimentation dans la chaîne alpine qui va lui servir de guide, il utilise ses récentes observations dans les Alpes cottiennes et les données de divers auteurs, de Suess en particulier (Suess dont il se proclame « l'élève »).
Les premiers dépôts se font au-dessus d'un terme « A », transformé en « gneiss », terminant le cycle précédent : ainsi, dans les Alpes, la gneissification affecte jusqu'au Permien, inclusivement. « Un grand géosynclinal » se crée ensuite, dans lequel se dépose un épais « Flysch fin » (qui, dans la chaîne alpine, correspond aux schistes lustrés triassico-jurassiques (terme B). Une saillie centrale émerge et divise le géosynclinal : elle va séparer deux cuvettes plus étroites, sur les bords de la chaîne, qui vont se remplir d'un « Flysch grossier », d'âge Crétacé-Éocène (terme C). Les « mouvements plus énergiques » qui suivent donnent naissance à de grands « plis couchés » [= édifices charriés] que l'érosion va attaquer, donnant naissance à des poudingues et grès grossiers, d'âge oligo-miocène : c'est le faciès « grès rouge » (terme D), que l'on rencontre aux pieds de la chaîne.
La « chaîne houillère » (Bertrand reprend son vieux terme) montre une évolution semblable. Le Culm peut être l'équivalent des schistes lustrés alpins : ce « Flysch fin » aurait rempli un premier géosynclinal central. Le terme détritique houiller est assimilé à un Flysch grossier. Et les grès rouges permiens terminent le cycle orogénique. Pour la chaîne calédonienne, Bertrand fait quelques propositions plus problématiques.
Il admet que la récurrence du Flysch dans les chaînes alpine et « houillère » manque de base certaine. Mais celle des grès rouges est évidente, de même que celle des gneiss à la base de chaque cycle n'est pas moins claire. Il exprimera sa pensée d'une manière plus lapidaire dans sa Notice (1894c) : « Chaque chaîne a son flysch schisteux, chaque chaîne a son flysch grossier, chaque chaîne a ses grès rouges, et ces types, quatre fois répétés, embrassent toute l'échelle des terrains sédimentaires. »
La conférence de Zurich se termine ainsi : « Je crois fermement [...] à la liaison ordonnée de tous les phénomènes, tectoniques, sédimentaires et éruptifs autour des différentes phases de l'histoire des chaînes de montagne [qui sont] les quatre unités de l'histoire du globe ». Et, convaincu que ce serait « une erreur profonde de croire que notre globe [est] entré dans une phase de repos » (Bertrand, 1894b), il va se lancer dans la prévision d'une nouvelle chaîne ! En 1887, il la voyait dans l'espace méditerranéen. En 1894, il est plus sensible aux gneiss et granites traversant le Mésozoïque des cordillères nord-américaines : « de tout ce que nous connaissons sur le globe, cette région [côtière du Pacifique] est celle qui présente le plus d'analogies géologiques avec les séries passées et avec l'emplacement possible d'une chaîne future, en voie actuelle de formation. » S'il revenait parmi nous, nul doute que Marcel Bertrand serait un adepte enthousiaste des subductions péri-pacifiques !
Marcel Bertrand (1897b) affirmera, dans la préface qu'il donna à La Face de la Terre, que « l'observation de détail sur le terrain restera la condition première et l'élément essentiel du progrès » en géologie. C'est l'avis du « critique infiniment prudent, avisé et sévère » que nous décrit Termier (1908). Une autre face est celle du « prophète emporté par l'inspiration et incompris comme tous les prophètes ». Un siècle après sa mort, il est loisible d'apprécier ses intuitions, parfois géniales - comme la cyclicité des phénomènes orogéniques -, mais aussi ses spéculations aventurées, comme celles qu'il hasarda à la fin de sa vie scientifique.
-
a) La déformation de l'écorce terrestre. De 1892 à 1894, il revient à plusieurs reprises sur la définition d'un « réseau » de déformation du globe, qu'il visualise par une carte pour le territoire français. Le problème le plus délicat est de retrouver les directions de mouvements dans les régions apparemment non plissées. Zürcher a parlé, en 1895, lors de la réunion de la Société géologique dans les Basses-Alpes, de « la méthode de M. Bertrand [...] consistant à indiquer sur une carte les divers terrains qui forment le substratum d'un étage déterminé, et à coordonner ensuite ces indications pour en déduire [...] la topographie géologique du fond de la mer à l'époque du dépôt des couches de l'étage considéré ». Haug lui rétorqua que cette « méthode » [celle de « l'écorché » !] n'avait rien de nouveau, que Suess et lui-même l'avaient utilisée, et, ironiquement, le rugueux Alsacien rendit hommage à Bertrand, qui en a fait « un instrument classique de travail ».
Marcel Bertrand (1892b) affirme que « le ridement de l'écorce terrestre se fait d'une manière continue, et [...] toujours aux mêmes places ». D'après une carte de Dollfus, les ondulations de la craie du bassin parisien se placeraient dans la prolongation des plis hercyniens. « La Terre se déforme progressivement, en se ridant suivant un réseau de courbes orthogonales : les premières circumpolaires, les secondes convergeant vers les régions polaires ». Les zones de sédimentation s'aligneraient aussi suivant les lignes ondulées de ce réseau.
Par contre, la formation des chaînes de montagne « est un épisode spécial et exceptionnel de la déformation de l'écorce » : leurs lignes directrices, dont on connaît le tracé sinueux, « épousent alternativement et en zigzag des courbes de l'un et de l'autre réseau ». Dans des cas particuliers, le réseau primitif peut être gravement déformé : ainsi « entre la double sinuosité des Alpes cottiennes et des Alpes maritimes, les plis de la Provence se sont trouvés écrasés dans une sorte de cul-de-sac, qui fait comprendre la cause de leur complication exceptionnelle » (Bertrand, 1894c). Cependant, « les pôles de ce réseau ne coïncident pas exactement avec ceux de la rotation actuelle », étant plutôt ordonnés « autour des pôles magnétiques » (Bertrand, 1892b). Termier (1908) traitera de « systématisation un peu chimérique » ce réseau de déformation dont Bertrand ne parlera plus après 1894.
b) Essai d'une théorie mécanique de la formation des montagnes. À partir de l'exemple du bassin houiller du Gard, dont il vient d'étudier les charriages (Bertrand, 1900a) et d'observations dans les Alpes et en Provence, il va élaborer une « théorie mécanique ». Alors que Suess « nie l'existence [de l'isostasie] comme contraire à nos notions de mécanique », Marcel Bertrand s'en empare. Le changement de position des masses lourdes profondes est à l'origine de la succession des phénomènes suivants : 1) formation d'une cuvette géosynclinale, au-dessus d'une zone à excès de pesanteur et dont le fond s'affaisse, en partie par le poids des sédiments qui s'accumulent ; 2) formation d'un « bourrelet » sur un bord de la cuvette, à la suite du déplacement des masses lourdes du fond de celle-ci ; 3) « descente » (pesanteur et tensions) de ce bourrelet, sans cesse formé et renouvelé, au-dessus du remplissage de la cuvette, sous forme de grands charriages horizontaux ; 4) enfin élévation en masse de l'édifice sous-marin précédent, du fait que les roches légères ont remplacé la zone profonde lourde du début.
Au total, les grands charriages seraient liés à la sédimentation, et ils entraînent dans leur mouvement une couche sphérique plus profonde de l'écorce. « La Terre serait comparable à une orange dont, par une pression de la main, on arriverait à faire tourner l'écorce tout d'une pièce sans déplacer le fruit ». Ceci serait lié au déplacement des pôles.
L'idée que les forces de compression, à l'origine des plissements, se limitent aux couches superficielles du globe (« un petit nombre de kilomètres, sans qu'on puisse préciser ce nombre ») était déjà exprimée dans le mémoire écrit en 1890.
c) L'impasse tétraédrique. Le Britannique Lowthian Green, en 1873, avait considéré que les grands ensembles terrestres se disposaient géographiquement sur un tétraèdre dont le sommet était au pôle sud, les faces et les arêtes étant assez courbes pour s'écarter très peu de la sphère terrestre. Michel-Lévy, en 1898, reprit l'idée en situant les fractures qui sont à l'origine des alignements de roches volcaniques tertiaires, sur les arêtes d'un tétraèdre presque régulier, d'un type comparable à celui de Green, mais le centre n'était plus au pôle sud.
À cette époque, le petit groupe parisien des géologues polytechniciens s'amusait avec le tétraèdre. Lugeon séjournait à Paris où il suivait les leçons de l'École des mines. Il rapporte (in Fabre-Taxy et Gueyrard, 1950) que, dans la « petite chambre » du Service de la Carte géologique, boulevard Saint-Michel, Michel-Lévy et Bertrand « que séparait un antagonisme notoire [...] à propos d'histoire du tétraèdre terrestre », avaient de vives discussions. S'en mêlait aussi Albert de Lapparent, depuis longtemps attaché aux idées géographiques de Lowthian Green. Il critiqua un texte de son camarade Bertrand, qui se hérissa et défendit la thèse du « tétraèdre volcanique » : celui-ci doit pouvoir - ajoutait-il - se concilier avec celle du « tétraèdre géographique », mais il n'est « pas préparé à traiter immédiatement la question »... Cet échange entre Lapparent et Bertrand eut lieu à l'Académie des sciences le 5 mars 1900. Ce fut le dernier texte imprimé de Marcel. Albert de Lapparent en 1908, Michel-Lévy en 1911 le suivirent dans la tombe. Avec eux, la tentation du tétraèdre aura vécu. Disciple du second, Louis de Launay - pourtant issu du même moule que son maître - pourra écrire en 1913 : « Presque dans les dernières années de sa vie, Michel-Lévy continuera à subir cette fascination qui l'animera, après de Lapparent et Marcel Bertrand, autres disciples du même maître [Élie de Beaumont !] à s'enthousiasmer [à cause de son apparence de rigueur géométrique] pour un réseau tétraédrique dont je m'abstiendrai de parler... ». Pierre Termier (1908), lui, verra dans ces « pages [de Marcel Bertrand] splendides et comme semées d'éclairs, mais chaotiques et confuses », « le premier symptôme d'une redoutable maladie ».
La lecture de l'oeuvre permet de se faire une idée de l'homme, qui nous paraît marqué par deux caractéristiques opposées, l'audace et l'inquiétude. La certitude enthousiaste quand il propose une interprétation originale d'un problème difficile, contraste avec la crainte, souvent exprimée, de s'être trompé. Dans les problèmes abordés, sa pensée a évolué et il l'avoue sans honte : la première interprétation, souvent intuitive, est généralement la bonne ; le doute le saisissant peut entraîner de véritables ratiocinations, le ré-examen final le ramenant, après de longues vérifications, à l'impression première.
En lisant ses lettres à la minuscule écriture décidée, on ressent la netteté de la pensée, le goût de l'organisation, un certain dirigisme qu'atténue le ton cordial d'un homme de bonne volonté et pacifique que seul le ton insolent de Fournier fera sortir de ses gonds.
Nous avons le témoignage de ses contemporains. Son collaborateur Lucien Cayeux (1907) décrit un homme « plein d'entrain et d'une humeur primesautière [...] à l'esprit alerte, vibrant ». Pierre Termier (1908) avait trente ans quand il rejoignit Bertrand dans les Alpes cottiennes : ce fut seulement là, en 1890, que, lors d'une nuit glaciale dans une cabane en ruine de la Vanoise, il découvrit enfin la riche personnalité d'un homme qui, jusque-là, l'intimidait par sa réserve naturelle. Il décrit le marcheur infatigable au tempérament frugal, d'une incomparable simplicité, d'une gaieté imperturbable, ne sachant pas dissimuler sa pensée mais toujours bienveillant. À côté de cela, Termier insiste sur sa « tendance invincible à l'épigramme », due à son esprit moqueur, tendance que corrigeait « sa douceur et son bienveillant sourire ».
Maurice Lugeon avait de 20 à 30 ans quand il connut Bertrand, sur le terrain et à Paris. Un demi-siècle après (in Fabre-Taxy et Gueyrard, 1950), il rappelle sa grande gaieté, sa tendance à lancer des boutades, son espièglerie (« son caractère de gamin, dirai-je même »). Il nous décrit le géologue sur le terrain, avec un matériel « aussi réduit que possible, un marteau de grandeur moyenne, un crayon à peine taillé, ou plutôt un bout de crayon, pas de gomme... ». Confiant dans sa « mémoire extraordinaire, pas de notes sur le terrain, de temps en temps, le soir, il dessinait ses contours géologiques ». Et de conclure : « Ce n'est vraiment pas un exemple à suivre » ! Il le dépeint avec « l'éternelle cigarette qui ne quittait pas la bouche », utilisant un minuscule verre (« afin de multiplier les occasions de le vider ») pour boire le vin rouge de sa gourde. L'image fournie par Termier est analogue, ajoutant l'habitude de Bertrand de toujours déclamer des vers ! En voyageant avec lui sur le terrain, « on le trouvait amusant et étrange [...] parlant tout le temps à mi-voix ou à voix haute et discutant toujours... » Il ajoute : « Après cinq ou six jours [...] de course, ses vêtements [...] avaient pris un aspect lamentable. Il ne s'en souciait guère [et] il continuait d'aller, imperturbablement, pareil à un chemineau grandiloquent et misérable, parlant seul, tout haut, le long des routes ou dans les rues des villages [...] au grand trouble des paysans ou des boutiquiers » ! À Grindelwald en 1896, Lugeon le décrit mimant les plis du paysage par ses gestes, entraînant « la joie ou plutôt l'étonnement des passants ». S'ils le surent, ses confrères académiciens des bords de Seine durent en frémir.
Au début de 1900, l'activité de Marcel Bertrand est encore considérable. Après avoir exposé à l'Académie ses trois ultimes notes synthétiques, il engage, le 5 mars, une discussion avec Albert de Lapparent sur « le tétraèdre ». Il présente aussi, au rythme habituel, divers textes au nom de leurs auteurs. Après le 16 avril s'effectue une brutale interruption. Les derniers jours de son père et son décès le 3 avril n'avaient pas modifié ses venues quai Conti. Il avait dû assister sans faiblir à la débauche de discours élogieux célébrant les mérites du célèbre Secrétaire perpétuel.
Le 16 avril suivant, jour de Pâques, Marcel va promener sa famille au bois de verrières, près de Bièvres. « Non loin de lui, et surveillé par lui, mais, hélas ! trop distraitement, un groupe d'enfants, où sont ses filles, joue dans une sablière ouverte récemment » (Termier, 1908). Et c'est la catastrophe, et des cris. Jeanne, sa fille aînée très aimée, 13 ans, « vient d'être renversée et ensevelie par un éboulement du sable », et on ne dégage, trop tard, qu'un cadavre. « De tant de chagrin, et d'une telle épouvante, Marcel Bertrand ne devait jamais guérir. À partir de ce mois d'avril, il nous parut complètement changé. Sa douceur était restée la même, et il avait toujours son bienveillant sourire d'autrefois ; mais rien ne l'intéressait plus... » (Termier, 1908).
Dans le registre des présences aux séances hebdomadaires de l'Académie, sa signature a disparu après le 9 avril et elle ne réapparaîtra que le 12 novembre. L'élection d'Eduard Suess, le 30 avril, au titre suprême d'Associé étranger, se fera sans lui, son ami.
1900, c'est l'année du 8e Congrès géologique international de Paris, année aussi de l'Exposition universelle. Aux côtés de l'illustre Albert Gaudry, qui le préside, Michel-Lévy et Marcel Bertrand sont vice-présidents. Le 16 août, l'après-midi, à l'Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, la Société géologique inaugurait son nouveau siège. Albert de Lapparent, son président annuel, recevait l'élite de la géologie européenne. Peut-être Marcel Bertrand se sentit-il obligé d'y venir. À l'issue des séances du Congrès à Paris, vont se dérouler les grandes excursions. Il va diriger une bonne partie de deux d'entre elles : d'abord dans les Alpes françaises (voir chap. VII), ensuite en Provence (voir chap. IX) du 23 septembre au 3 octobre. Il en sera le principal leader. Après Zürcher qui montre les chevauchements autour de Toulon, l'itinéraire passe par Le Beausset, la Sainte-Baume, Allauch et l'Étoile, afin d'argumenter en faveur de la « grande nappe de recouvrement de la Basse-Provence ».
Le 12 novembre, Marcel Bertrand peut assister à la première séance de la Société géologique dans son nouveau local. Il a en tout cas repris le chemin de l'Académie des sciences au cours du dernier trimestre 1900 ainsi qu'en 1901, où il s'absente cependant entre début mai et début octobre. C'est sans lui que Lugeon va diriger, du 3 au 11 septembre, une Réunion extraordinaire dans le Chablais, où il expose ses idées sur la structure en nappes de la Savoie aux Grisons. En effet, Marcel se trouve en famille à Saint-Jean-de-Luz : le 26 septembre, c'est de là qu'il écrit à Révil qu'il est chargé de demandes d'enquêtes pour diverses communes de Savoie.
Jusqu'à cette époque, il donnait son cours à l'École des mines mais au cours de l'année scolaire 1901-1902, il n'en assure plus qu'une partie. Son état ne résulte pas d'une simple dépression, mais plutôt d'un affaiblissement mental permettant toutefois d'expliquer la régularité de sa venue à l'Académie. Lucien Cayeux, devenu « chef de travaux », doit le remplacer et il est de 1904 à 1907 nommé « professeur suppléant », avant de succéder (1907-1912) à son maître disparu.
L'été 1902, Pierre Termier « tente de lui redonner un peu de vigueur » et l'invite à « une course de quelques jours en pays Basque, entre Roncevaux et Saint-Jean-Pied-de-Port, mais la marche en montagne lui était très pénible, et les problèmes géologiques, après l'avoir un instant amusé, le rebutaient bien vite. Ce fut alors que je perdis tout espoir » (Termier, 1908).
Sa promotion, le 9 juillet, comme officier de la Légion d'Honneur (il était chevalier depuis le 7 juillet 1885) doit cependant le satisfaire, à en juger par le visage réjoui que montrent quelques clichés de l'époque, avec la « rosette » à la boutonnière (Fig. 28).

Fig. 28. Marcel Bertrand en 1902 [Collection Société géologique de France].
S'il a abandonné toute recherche, Marcel ne cesse pas cependant, à l'Académie, d'être cité comme membre de diverses commissions ni de présenter de nombreuses notes de Kilian, de Lugeon (sur le massif du Simplon), de Bresson (annonçant la découverte de la nappe de Gavarnie), de Cayeux (révélant les charriages de Crète). En décembre va se poser le problème du remplacement du minéralogiste Hautefeuille, décédé. Vont être candidats Alfred Lacroix et Munier-Chalmas. Michel-Lévy (lettre du 18/12/1902 à Lacroix, Arch. Acad. Sci., dossier acad. Michel-Lévy) est déchiré d'avoir à choisir entre son « meilleur élève » et un de ses « meilleurs amis ». Il tente de dissuader Lacroix de cet affrontement car « Marcel Bertrand et de Lapparent sont chauds pour Munier ». Malgré la maladie, Marcel est donc encore actif, à l'Académie. On l'aperçoit encore à la Société géologique, et cela jusqu'en 1904, « mais taciturne déjà, et déjà indifférent à la vie de la science » (Termier, 1908). Ce désintérêt est compensé par une passion, celle de jouer aux cartes. Sa dernière intervention orale mentionnée est du 6 avril 1903, à propos du pays Basque. À l'Académie, le 18 mai, il écrit le rapport de présentation de la première candidature de Pierre Termier. Le texte, conservé dans son dossier aux Archives de l'Académie, montre des repentirs dans l'écriture et se termine par une phrase où, manifestement, il ne s'engage pas pour son meilleur disciple : il ne pouvait pas en effet ne pas voter pour son pittoresque vieux camarade de la Société géologique, Munier-Chalmas (qui fut élu, mais mourut trois mois après !). Marcel s'absente ensuite, du 15 juin au 27 octobre.
Une deuxième tentative de Termier (qui sera élu en 1909) amène une nouvelle page de présentation par Marcel Bertrand, le 2 mai 1904, complétant de quelques mots son texte de 1903. À partir de janvier 1905, les notes envoyées par ses fidèles - même Argand et Lugeon -vont passer par le canal de Michel-Lévy ou de Lapparent. Seul Lucien Cayeux obtient, le 26 juin, que Marcel Bertrand (qui va quitter Paris jusqu'à la mi-octobre) présente une note, portant sur un sujet mineur, l'Argile plastique d'Ivry.
En 1906, ce doit être dans une brume de l'esprit que Marcel peut apprendre, à l'Académie, les propositions de Lugeon et Argand sur les nappes de Sicile et Calabre. Sauf un bref séjour parisien fin juin, il sera absent de début avril jusqu'à fin octobre. Peut-être est-ce cet été-là que, comme l'a révélé Lugeon (in Fabre-Taxy et Gueyrard, 1950), « on le conduit en Suisse. Au retour, il passe me voir à Lausanne, et moi, sans penser à mal, je lui conte mes nouvelles trouvailles. Alors cet homme retrouvant sa lucidité fut pris de sanglots, en ayant encore la délicatesse de m'encourager tout en se plaignant de son état. »
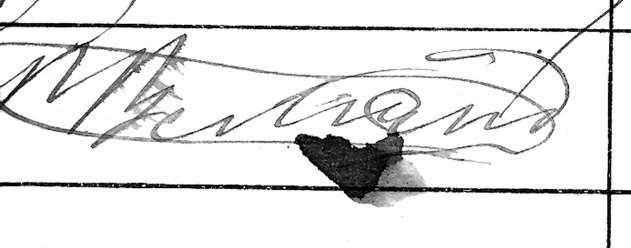
Fig. 29 La dernière signature de Marcel Bertrand apposée le 4 février 1907 sur le registre des séances de l'Académie des sciences.
En janvier 1907, on remarque curieusement que sa signature figure parmi celles des premiers arrivés en séance, ce qui est inhabituel chez lui. Le 28 janvier, la signature est tremblée. Le 4 février - date de sa dernière venue - il a manifestement de la peine à la tracer (Fig. 29). À côté du paraphe, une main (l'huissier ?) a porté un petit cercle. Que signifie-t-il ? Un malaise ou un départ précipité ?
La fin approche. Le 13 février, Marcel Bertrand s'éteint à son domicile, 75 rue de Vaugirard. Les obsèques de cet homme - qu'on peut penser avoir été, comme son père, agnostique ou au moins indifférent aux croyances religieuses -, auront lieu à l'église Notre Dame des Champs, avant l'inhumation au cimetière de Montparnasse.
Sa mort est annoncée le 18 février par Henri Becquerel, président en exercice de l'Académie, dans une allocution émue qui retrace bien la personnalité du disparu :
-
« Digne héritier d'un nom illustre [.] non seulement il l'avait porté sans défaillance, mais il avait réussi à y ajouter un nouvel éclat. Il restera une des gloires les plus pures de la Géologie française. De brillants travaux, où le raisonnement et l'esprit géométrique le plus affiné ont eu autant de part que l'observation, avaient fait de lui le chef incontesté des tectoniciens. Les idées géniales qu'il avait développées dès 1884, pour avoir été lentes à germer, n'en ont paru que plus brillantes lorsqu'on a vu depuis cinq ans les géologues alpins s'en inspirer avec tant de succès et se plaire à lui en rapporter le mérite initial.
La découverte de la généralité et de l'amplitude du phénomène des nappes de recouvrement dans les plissements des montagnes est de tout premier ordre. Elle a déjà permis de comprendre la structure de la chaîne des Alpes maritimes jusqu'aux Carpathes.
M. Marcel Bertrand n'a pas voulu que des discours fussent prononcés sur sa tombe. Nous ne saurions cependant reprendre le cours de nos travaux sans adresser un dernier adieu au Confrère éminent et aimé que nous perdons et sans évoquer le spectacle touchant de ses dernières années, quand il venait chaque lundi parmi nous, comme pour oublier un mal implacable dans la sérénité de la science. »
Créateur initial dans la chaîne alpine et généralisateur dans le cadre mondial de ce qui fut, à la charnière des XIXe et XXe siècles, la « nouvelle tectonique » mobiliste des charriages, Marcel Bertrand a - dans la vingtaine d'années de sa carrière scientifique - réalisé une oeuvre exceptionnelle et tenté de retrouver, comme Suess, les stades de l'évolution des chaînes plissées. Très grand savant, que les plus illustres tectoniciens ont considéré comme leur « chef » ou leur guide, Marcel Bertrand était resté dans la vie quotidienne - et en cela il peut nous toucher profondément - un homme simple et droit, une « âme pure » (Termier) ayant échappé aux agitations habituelles du monde scientifique.
Remerciements. - À Jean Gaudant (Paris), qui a suggéré cette étude et en a beaucoup aidé la réalisation ; à Mmes Marie-Noëlle Maisonneuve (École des mines, Paris) et Reffay (Saint-Claude), aux professeurs J. Philip (Marseille), R. Schroeder (Francfort-sur-le-Main) et R. Trumpy (Zurich), à P. Rossi (Orléans), pour la communication de divers documents ou leur critique du texte, à Mmes Greffe et Pouret (Archives de l'Académie des sciences) et à Mme Appia (Société géologique de France) pour leur aide.
-
(1881). Failles de la lisière du Jura entre Besançon et Salins. Bull. Soc. géol. Fr., (3), X, p. 114-127.
(1883). Le Jurassique supérieur et ses niveaux coralliens entre Gray et Saint-Claude. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XI, p. 164-191.
(1884a). Rapports de structure des Alpes de Glaris et du bassin houiller du Nord. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XII, p. 318-330.
(1884b). Failles courbes dans le Jura et bassins d'affaissement. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XII, p. 452-463. (1884c). Coupes de la chaîne de la Sainte-Baume (Provence). Bull. Soc. géol. Fr., (3), XIII, p. 115-130.
(1886). Notice de la feuille « Toulon » à 1/80 000. Service de la Carte géologique de France.
(1887a). La chaîne des Alpes et la formation du continent européen. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XV, p. 423447.
(1887b). Îlot triasique du Beausset (Var). Analogie avec le bassin houiller franco-belge et avec les Alpes de Glaris. Bull. Soc. géol. Fr, (3), XV, p. 667-702.
(1888a). Sur la distribution des roches éruptives en Europe. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XVI, p. 573-617.
(1888b). Nouvelles études sur la chaîne de la Sainte-Baume. Allure sinueuse des plis de la Provence. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XVI, p. 748-778.
(1888c). Plis couchés de la région de Draguignan. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XVII, p. 234-246.
(1889a). (en coll. avec W. KILIAN). Études sur les terrains secondaires et tertiaires dans les provinces de Grenade et de Malaga, in « Mission d'Andalousie ». Mém. Savants Etrangers, Acad. Sci. Paris, XXX, (2), p. 377-579.
(1889b). Eloge de M. Ch. Lory. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XVII, p. 664-679.
(1890a-impr. 1908). Mémoire sur les refoulements qui ont plissé l'écorce terrestre et sur le rôle des déplacements horizontaux. Mém. Acad. Sci. Paris, 50, 263 p.
(1890b). Notice de la feuille « Marseille » à 1/80 000. Service de la Carte géologique de France.
(1891a). Sur la coupe du sommet de l'Ouarsenis. C. R. somm. Soc. géol. Fr., (3), XIX, p. 67-68.
(1891b). (en coll. avec P. ZÜRCHER). Sur un témoin d'un nouveau pli couché près de Toulon ; phyllades superposées au Trias. C. R. Acad. Sci. Paris, 112, p. 1083-1086.
(1891c). Sur le massif d'Allauch. C. R. somm. Soc. géol. Fr., (3), XIX, p. 102-105.
(1891d). Compte Rendu de la Réunion extraordinaire de la Société géologique de France au Beausset. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XIX, p. 1051-1162.
(1892a). Les récents progrès de nos connaissances orogéniques. Rev. génér. Sci. pures appl., III, n° 1, p. 3-12.
(1892b). Sur la déformation de l'écorce terrestre. C. R. Acad. Sci. Paris, 14, p. 402-406.
(1892c). Les montagnes de l'Ecosse. Rev. génér. Sci. pures appl., III, n° 23, p. 817-824.
(1892d). Le Môle et les collines de Faucigny (Haute-Savoie). Bull. Serv. Carte géol. Fr., IV, n° 32, p. 345393.
(1894a). Etudes dans les Alpes françaises. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XXII, I, p. 69-118 ; II, p. 129-162.
(1894b). Structure des Alpes françaises et récurrence de certains faciès. C. R. 6e Congr. géol. int. (Zurich), p. 161-177.
(1894c). Notice sur les travaux scientifiques de M. Marcel Bertrand, Ingénieur en Chef des Mines. Gauthier-Villars, Paris, 35 p.
(1896). (en coll. avec E. RITTER). Sur la structure du Mont-Joly près Saint-Gervais (Haute-Savoie). C. R. Acad. Sci. Paris, 122, p. 289-293.
(1897a). (en coll. avec H. GOLLIEZ). Les chaînes septentrionales des Alpes bernoises. Bull. Soc. géol. Fr, (3), XXV, p. 568-595.
(1897b). Préface. in E. Suess, La Face de la Terre, t. I.
(1898). La nappe de recouvrement des environs de Marseille. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XXVI, p. 632-652.
(1899). La grande nappe de recouvrement de la Basse-Provence. Bull. Serv. Carte géol. Fr., X, n° 68, p. 397-467.
(1900a). Essai d'une théorie mécanique de la formation des montagnes. Déplacement progressif de l'axe terrestre. C. R. Acad. Sci. Paris, 130, p. 291-298.
(1900b). Déformation tétraédrique de la Terre et déplacement du pôle. C. R. Acad. Sci. Paris, 130, p. 449464.
(1900c). Livret-guide du 8e Congrès géologique international. Excursion n° XX, p. 7-44. Une liste complète des publications de Marcel Bertrand est donnée par P. Termier (1908).
-
AUBOUIN, J., MENNESSIER, G. (1962). Essai sur la structure de la Provence. Livre à la mémoire du Prof. Paul Fallot, Mém. h.s. Soc. géol. Fr., t. 2, p. 45-98.
BAILEY, E. B. (1935). Tectonic Essays, mainly Alpine. Oxford, Clarendon Press, 200 p.
BONNIN, J., DURAND-DELGA, M., MICHARD, A. (2002). La « Mission d'Andalousie », expédition géologique de l'Académie des sciences de Paris à la suite du grand séisme de 1884. C. R. Geoscience, 234, p. 795-808.
BOURGEAT, E. (1887). Recherches sur les faciès coralligènes du Jura méridional (Thèse Doct. Paris). Lille, impr. Lefort, 186 p.
CORROY, G., DENIZOT, G. (1935). Guide géologique de la Provence occidentale. Marseille, Impr. Marseillaise, 172 p.
ELLENBERGER, F. (1958). Étude géologique du Pays de Vanoise. Mém. Serv. Carte géol. France, 562 p.
ELLENBERGER, F. (1982). Marcel Bertrand et « l'orogenèse programmée ». Geol. Rdschau, 71, p. 463474 (+ Erratum : 72, 1983, p. 757).
ELLENBERGER, F. (1987). Un centenaire à commémorer : la découverte des charriages de Provence par Marcel Bertrand. Trav. Comité fr. Hist. géol., (3), I, p. 49-56.
FABRE-TAXY, S., GUEYRARD, S. (1950). Réunion géologique en Provence pour commémorer le cinquantenaire des oeuvres de Marcel Bertrand (28 sept.-6 oct. 1950). Ann. Fac. Sci. Marseille, XXI, p. 1-150.
FOURNIER, E. (1896a). Note sur la tectonique de la chaîne de l'Etoile et de Notre-Dame des Anges. Bull. Soc. géol. Fr, (3), XXIV, p. 255-266.
FOURNIER, E. (1896b). Sur l'interprétation du massif du Beausset-Vieux. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XXIV, p. 709-711.
FRANKS, S., TRÜMPY, R. (2005). The Sixth International Geological Congress Zürich, 1894. Episodes, 28, n° 3, p. 187-192.
GEIKIE, A. (1908). The Anniversary Address of the President. Proc. Geol. Soc. Lond., 64 (cf. p. L-LIV).
GUIEU, G. (1968 ; réimpr. 2002). Étude tectonique de la région de Marseille. (Thèse Univ. Marseille, 1968). 2 t., 397 p., 139 figs.
HAUG, E. (1925). Les nappes de charriage de la Basse-Provence, 1e partie (Historique ; La région toulonnaise). Mém. Expl. Carte géol. Fr., 304 p.
HEIM, A. (1878). Untersuchungen über den Mechanismus der Gebirgsbildung... Schwabe, Basel, 2 t. + Atlas, 346 + 246 p.
HEIM, A. (1891). Geologie der Hochalpen zwischen Reuss und Rhein ; Beitr. z. Geol. Karte d. Schweiz in 1 :100.000, 25, 503 + 76 p.
MASSON, H. (1976). Un siècle de géologie des Préalpes : de la découverte des nappes à la recherche de leur dynamique. Eclogae geol. Helvetiae, 69/2, p. 527-575.
MONTERO, A., DIEGUEZ, C., SEQUEIROS, L. (2003). El viaje de M. Bertrand y W. Kilian (Mission d'Andalousie) por Andalucía Oriental en 1885 y sus recolectas de fósiles. Ejemplares del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC). Miscelánea en Homenaje a Emiliano Aguirre. Paleontología, 18, Madrid, p. 321-327.
MURCHISON, R. I. (1848). On the geological structure of the Alps. Quart. J. Geol. Soc., Lond., 5 (1-2), p. 157-312 (cf. p. 246-250).
PHILIP, J. (1967). Modalités et importance de la transgression du Sénonien inférieur dans la région de Saint-Cyr-sur-Mer (Var). C. R. Acad. Sci. Paris, 265, p. 1883-1886.
REFFAY, A. (2005). Le chanoine Bourgeat de Valfin-lès-Saint-Claude, géologue (1849-1926). Les Amis du vieux Saint-Claude, n° 28, p. 38-49.
SCHARDT, H. (1893). Sur l'origine des Préalpes romandes. Arch. Sci. phys. nat., Genève, 3, 30, p. 570583.
STEINMANN, G. (1901). Das tektonische Problem des Provence. Centrbl. f. Mineralogie..., Stuttgart, p. 449-463.
SUESS, E. (1875). Die Entstehung der Alpen. Braumüller, Wien, 168 p.
SUESS, E. (1885-1909). Das Antlitz der Erde. Tempsky, Prag et Freitag, Leipzig [trad. : La Face de la Terre].
SUESS, E. (1886). Ueber unterbrochene Gebirgsfaltung. Sitz. k. Ak. Wiss. Wien, Math-natur. Cl., 94, Abt. 1, p. 111-117.
SUESS, E. (1904). Sur la nature des charriages. C. R. Acad. Sci. Paris, 139, p. 714-716.
TERMIER, P. (1908). Eloge de Marcel Bertrand (1847-1907). Bull. Soc. géol. Fr., (4), VIII, p. 163-204.
TOUCAS, A. (1873). Mémoire sur les terrains crétacés des environs du Beausset, Var. Mém. Soc. géol. Fr, (2), IX, n° 4, 65 p.
TOUCAS, A. (1896). Révision de la Craie à Hippurites. Bull. Soc. géol. Fr., (3), XXIV, p. 602-645.
TRÜMPY, R. (1991). The Glarus nappes: a controversy of a century ago. In: Controversies in Modern Geology, McKenzie et Müller éd., Acad. Press, p. 385-404.
TRÜMPY, R., LEMOINE, M. (1998). Marcel Bertrand (1847-1907), les nappes de charriage et le cycle orogénique. C. R. Acad. Sci. Paris, Sci. Terre-Planètes, 327, p. 211-224.
TRÜMPY, R., OBERHAUSER, R. (1999). Zu den Beziehungen zwischen österreichischen und schweizerischen Geologie: die Tektonik des Alpen, 1875-1950. Abh. Geol. B.-A., Wien, 56/1, p. 1328.
TRÜMPY, R., WESTERMANN, A. (2008). Albert Heim (1849-1937): Weitblick und Verblendung in der alpentektonischen Forschung. Vierteljahrschrift Naturforsch. Ges. in Zürich, 153(3-4), p. 67-79.
WILCKENS, O. (1909). Zur Erinnerung an Marcel Bertrand. Zentralbl. f. Mineralogie..., 1909, p. 499-501.