

Né le 10 juillet 1921 à Grenoble. Décédé le 28 juin 2012. Cérémonie religieuse de décès le 3 juillet 2012 en l'église Saint-Thomas d'Aquin. Inhumé à Cannes, au cimetière du Grand Jas.
Epoux de Janine, née Robert, architecte. Père de Philippe (marié à Carine ; 4 enfants).
Ancien élève de l'Ecole polytechnique (promotion 1939) et de l'Ecole des mines de Paris (entré en 1942, diplômé en 1947 avec effet rétroactif). Corps des mines.
Commandeur de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du Mérite.
Vous trouverez sur ce site :
|
|
Souvenirs d'un parcours professionnelpar Paul Gardent, ingénieur général des mines, conseiller d'Etat
Sommaire
|
Prologue : Une scolarité mouvementée
Après des classes secondaires et deux années de préparatoire au lycée Condorcet, j'entrai à l'X en septembre 1939. Au même moment, la guerre éclata. L'X étant une école militaire, nous avons été incorporés, mobilisés pour la durée de la guerre. Mais la promotion 1939 subit une scission. Nous avions entre 18 et 21 ans, compte tenu des règles d'âge régissant le concours d'entrée. La haute administration décida que les admis de 20 et 21 ans, âge normal pour la mobilisation en situation de guerre, partiraient immédiatement, sous l'appellation de demi-promotion A, pour les écoles militaires d'application d'où, après une période de formation de six mois, ils seraient affectés dans les unités combattantes. Les plus jeunes, de 18 et 19 ans, demi-promotion B, devaient rester six mois à l'X avant de succéder à leurs camarades dans les écoles militaires. Cette décision, évidemment nuisible à l'unité d'esprit de la promotion, fut par la suite assez critiquée.
Resté rue Descartes avec les plus jeunes, j'ai donc suivi les cours allégés des professeurs habituels. Je me rappelle Paul Lévy, professeur d'analyse très scrupuleux, nous disant, après avoir dû simplifier la démonstration d'un théorème assez subtil: "Cette démonstration n'est pas rigoureuse, mais vous admettrez, pour la durée de la guerre, que le résultat est pourtant exact." Nous bénéficiions aussi d'exercices de préparation militaire. Je me revois démontant et remontant laborieusement une mitrailleuse Hotchkiss. Nous faisions de la manoeuvre à pied sous les ordres d'un adjudant-chef qui, pour nous expliquer les finesses du "Présentez armes", nous prescrivait: "L'épée verticale, mais pas trop!" Nous suivions des séances d'équitation à la caserne des Célestins où, cavaliers novices pour la plupart, nous avions bien du mal à maîtriser nos chevaux, excités par un hiver rigoureux.
En mars 1940, nous sommes partis pour les écoles militaires, avec le grade d'aspirant. Ayant choisi l'artillerie, je me suis retrouvé à l'école de Fontainebleau, où notre groupe a été réparti en quatre brigades, d'une vingtaine d'élèves chacune. L'artillerie faisait alors sa mutation du cheval à l'engin motorisé,et les élèves officiers en formation étaient normalement répartis en brigades à cheval et brigades motorisées. A titre d'expérience, nos brigades polytechniciennes furent traitées en brigades mixtes, et nous avons été initiés aussi bien aux mises en batterie au galop qu'au maniement des tracteurs. Nous suivions des cours théoriques, faisions des exercices de tir aux canons de 75, de 155 et de 120 de Bange (Ce dernier était un ancien canon fort précis; mais tirer un coup en moins d'une minute était un record). Nous participions à des exercices en campagne, ce qui comportait de longs et agréables déplacements à travers la forêt. Nous faisions aussi beaucoup de cheval en manège ou en forêt.
Mais notre formation d'artilleur tourna court. Au début de mai, les blindés allemands envahirent la Belgique, et la désastreuse campagne de France commença. Quand la région parisienne fut directement menacée, le repli de l'école d'artillerie sur Poitiers fut décidé, où nous fûmes provisoirement installés dans un casernement momentanément désaffecté. On s'y efforçait sans beaucoup de conviction de poursuivre notre instruction. On imagina aussi de nous faire participer à la défense du territoire en nous postant, par petits groupes, équipés de quelques mitrailleuses, en garde d'un dépôt, près d' une route nationale, où les chars allemands pouvaient déboucher à tout moment. Mais ce simulacre de défense parut bientôt absurde et fut interrompu. Nous avons subi peu après un assez lourd bombardement par des avions italiens maquillés aux couleurs allemandes, l'Italie n'étant pas encore en guerre. Le parc de Blossac, notre tout proche voisin, fut particulièrement éprouvé, avec de nombreuses victimes parmi les mères de famille et les enfants en promenade en ce début d'après-midi.
Mais l'invasion se poursuivait inexorablement, et ce fut pour nous un deuxième repli qui aboutit en Haute-Vienne à St-Laurent sur Gore, dans la ferme du Garou. L'armistice intervint avant que les troupes allemandes nous rejoignent de nouveau. Nous étions installés dans une immense grange, où nous bivouaquions dans le foin. Nous préparions nous-mêmes nos repas, par brigades, et les prenions en plein air, sous le soleil immuable de ce solstice de juin. Le ravitaillement était satisfaisant, la riche campagne alentour n'étant pas encore soumise aux réquisitions qui devaient intervenir par la suite.
Au bout de deux à trois mois, le commandement trouva que ce bivouac campagnard avait assez duré, et décida de nous envoyer, avec le grade de sous-lieutenant dans les troupes en voie de reconstitution en zone libre. La France était en effet partagée en zone occupée par les troupes allemandes et zone libre, conformément à l'accord d'armistice. Cependant on nous offrit, sur choix individuel, une autre option: participer à la mise en place des chantiers de jeunesse en voie de création, sous la direction du général de la Porte du Theil, et destinés à l'origine à accueillir les jeunes en déshérence à la suite de la démobilisation, et particulièrement les Alsaciens qui, au moins temporairement, ne pouvaient rejoindre l'Alsace, soumise par les Allemands à un régime d'occupation particulièrement sévère, qui couvrait visiblement une volonté d'annexion. La vie plutôt morne des casernes de l'armée d'armistice ne me tentant pas particulièrement, j'optai pour les chantiers de jeunesse, qui offraient un certain parfum d'aventure, et qui n'étaient pas encore soumis, comme ils le furent plus tard, à l'encadrement idéologique du régime de Vichy.
Je me trouvai affecté, avec quelques camarades, au chantier de Rumilly, en Haute-Savoie. Huit camps se répartissaient à la lisière de la forêt. Leur mission, après avoir monté des baraques en bois, dites baraques Adrian, qui devaient offrir aux jeunes embrigadés un abri moins précaire que les tentes de l'armée implantées initialement, était de produire du charbon de bois dans les forêts voisines. Etant officier d'active, on me confia la direction d'un des camps, de préférence à quelques élèves-officiers de réserve qui, sans être très âgés, avaient tout de même quelques années de plus que moi, d'où quelques susceptibilités. J'avais dix-neuf ans et une expérience des hommes bien courte pour diriger un camp, composé principalement d'Alsaciens démoralisés tant par la défaite que par l'impossibilité de regagner leur région et leur famille. Je ne pense pas que ma période de commandement ait laissé un souvenir impérissable. Mais au bout de quelques semaines, on me demanda de participer à une petite équipe qui devait organiser, dans les divers camps, les activités culturelles. Je me sentis plus à l'aise dans ces nouvelles fonctions.
Au début de novembre, je fus convoqué, ainsi que mes camarades, à l'école polytechnique qui rouvrait ses portes. Mais cette reprise s'effectuait dans des conditions inhabituelles. Au lieu de regagner la rue Descartes, il était décidé de placer l'école en zone libre. L'école de santé militaire nous offrait l'hospitalité d'une partie de ses locaux à Lyon. L'X était démilitarisée. Nous étions démobilisés. Le général commandant l'école perdait son titre pour celui de gouverneur. Les officiers d'encadrement devenaient des chefs de groupes. La demi-promotion B retrouvait la demi-promotion A, ou du moins ce qui en restait disponible, car elle avait perdu cinq morts pendant la campagne et une soixantaine de prisonniers. Il fut d'ailleurs décidé, les cours reprenant en faisant abstraction de l'enseignement reçu pendant six mois par notre demi-promotion, que celle-ci ayant néanmoins un avantage au départ en raison de cet enseignement, il y aurait deux classements distincts pour les deux demi-promotions. L'école de santé ne disposait pas d'amphi d'une taille suffisante. Nos cours avaient lieu dans une salle de cinéma voisine, au milieu des photos de stars.
Je suis sorti dans le corps des mines, et je regagnai Paris au cours de l'été 1942, pour y suivre, en principe pendant deux ans, les cours de l'école des mines. La scolarité s'y est déroulée normalement pendant l'année scolaire 1942-43. Nous suivions, mes camarades du corps et moi, des cours de technologie industrielle: exploitation des mines, électricité, métallurgie, mécanique, chimie, et des cours de sciences naturelles: géologie; minéralogie, paléontologie. Ces derniers, qui s'accompagnaient de manipulations dans les collections de l'école et de quelques voyages d'exploration, nous apportaient un changement complet par rapport aux disciplines purement abstraites abordées à l'X.
Mais le déroulement scolaire fut brutalement interrompu en juin 1943. Le pavé de la capitale était devenu brûlant pour les classes d'âge auxquelles nous appartenions. Le service du travail obligatoire (STO) risquait d'un moment à l'autre de nous envoyer en Allemagne pour y travailler dans les usines d'armement du Reich. Les travailleurs des mines échappaient au STO en Allemagne, en raison de l'appétit des occupants pour la production de charbon, dont ils accaparaient une bonne part. Il fut donc décidé de nous placer en stage de longue durée dans les houillères.
Au mois de juillet, je me retrouvai ainsi à Bruay-en-Artois, ingénieur de la compagnie des mines de Bruay. Je fus d'abord affecté à un siège d'exploitation, auprès du chef de siège et de son adjoint. J'accompagnai ce dernier dans se visites de chantier, pour m'initier à la conduite des travaux, et j'étais chargé de quelques tâches d'une modeste technicité.
Au bout de quelques mois, je changeai d'affectation, et fus intégré dans une équipe de quelques ingénieurs, chargés de mettre en oeuvre la méthode Bedaux pour le paiement des ouvriers à la tâche. Il s'agissait de suivre un mineur pendant toute la durée de son poste, de décomposer son travail en gestes élémentaires, de mesurer la durée de chacun de ces gestes, et de lui attribuer un coefficient d'activité, caractérisant la célérité avec laquelle il était accompli.
L'ensemble de ces mesures, toutes corrections faites pour ramener les durées à un coefficient d'activité considéré comme standard, permettait de déterminer le temps conventionnel pour l'accomplissement d'une tâche précise, par exemple abattre une tonne de charbon dans une certaine veine, et en conséquence la rémunération de cette tâche. L'appréciation des coefficients d'activité parait a priori très subjective. Mais on arrive cependant assez vite à un étalonnage convenable, par confrontation avec un chronométreur expérimenté. Ceci étant, la méthode Bedaux estimée humiliante par les ouvriers, fut abandonnée dès la libération, à la fin de la guerre.
A la fin de l'année 1943, la direction de l'école des mines de Paris découvrit une solution ingénieuse pour nous faire accomplir, au moins nominalement, notre deuxième année d'école, tout en continuant à nous préserver du STO en Allemagne. C'était de nous envoyer à St Etienne, où se trouvaient présentes une école des mines et des houillères. Je me trouvai affecté, dès le début de janvier 1944, aux mines de Roche-la-Molière. Deux jours par semaine, nous suivions, mes camarades et moi, des cours à l'école. Le reste du temps, nous travaillions à la mine. Ma tâche fut, cette fois, une enquête sur le développement, les heurs et malheurs de l'électrification du fond. Car l'électricité se substituait progressivement à l'air comprimé pour le fonctionnement des machines du fond, avec les problèmes de sécurité au regard du grisou que cela soulevait.
Au début de juin, réputés avoir accompli une deuxième année d'école, à raison de deux jours par semaine pendant cinq mois, on décida que notre scolarité se terminerait après quelques vagues examens, et un voyage d'étude qu'il nous appartenait d'organiser nous-mêmes.Je partis, avec mon camarade Paul Jean, pour la Lorraine, où nous projetions de visiter des aciéries, des mines de fer, et des installations chimiques. Notre voyage fut soumis à d'étranges vicissitudes. Loin de se dérouler suivant une programmation préétablie, nos visites suivaient les aléas des transports ferroviaires, en voie de désorganisation avancée en cette fin de guerre. Notre programme cependant à peu près réalisé, j'ai regagné Paris au hasard de quelques convois qui circulaient encore.
Ma première obligation fut de me rendre chez le directeur des mines, au ministère de la production industrielle, qui était mon patron, puisque j'étais dorénavant ingénieur ordinaire des mines, le premier grade après celui d'ingénieur-élève. Le directeur des mines devait me donner une affectation. Je fus reçu par son adjoint, Pierre Couture. Les postes dans le Nord et le Pas-de-Calais, habituellement assez recherchés, l'étaient peu en cette période de guerre, et plusieurs étaient vacants. Je fus donc affecté, dans l'arrondissement minéralogique de Lille, au sous-arrondissement de Valenciennes.
L'Arrondissement minéralogique de Lille
Le départ tardif, la lenteur du cheminement sur des routes en piteux état, nous amenèrent en pleine nuit à Lens, terminus du camion, dont le chauffeur nous abandonna, sans autre formalité, au centre de la ville ou de ce qui en restait, car elle avait lourdement souffert des bombardements. Ayant découvert un poste de police, nous y avons appris que les hôtels de la ville étaient tous détruits ainsi que le centre de refuge qui fonctionnait encore peu auparavant. Notre seule ressource était de passer le reste de la nuit dans un abri antiaérien ouvert à proximité.
Nous y étions depuis une heure ou deux, lorsque surgit une patrouille de la Gestapo, qui nous soumit à un interrogatoire et une fouille en règle, ainsi que nos bagages, détail particulièrement plaisant lorsqu'on est nanti d'une grosse valise bourrée à mort. Après quelques heures, surgit une nouvelle patrouille, qui cette fois nous emmena à la kommandantur, pour un nouvel interrogatoire, plus serré encore, et une nouvelle fouille. Il s'agissait surtout de savoir ce que nous venions faire dans la région. Par chance, nous connaissions les noms des titulaires précédents des postes que nous venions occuper, ce qui eut un certain effet apaisant. Mais lors de la fouille, on trouva dans ma valise un dictionnaire franco-anglais, qui souleva une vive suspicion de mes interlocuteurs. J'eus beaucoup de mal à en justifier le besoin pour la lecture de documents techniques en langue anglaise. Ayant finalement admis que je n'étais pas un espion de l'intelligence service, ils nous laissèrent regagner notre inconfortable, mais providentiel abri, où nous avons passé sans autre alerte le reste de la nuit.
Après un morne dimanche passé à Lens sans moyen de transport, je pus enfin, le lendemain lundi, gagner Douai, où je devais rencontrer mon collègue Jean Chenevier, ingénieur en service dans cette ville, et qui avait assuré l'intérim du poste de Valenciennes en attendant mon arrivée. Je trouvai enfin une chambre d'hôtel, mais pas pour longtemps. Le lendemain en effet, nous devions aller à Lille, J. Chenevier et moi, pour y rencontrer le chef de l'arrondissement minéralogique, l'ingénieur général Duhameaux. Au retour vers Douai, nous avons entendu, tout le long du trajet, le grondement d'un bombardement, pour découvrir, en arrivant, que c'était la ville de Douai elle-même qui avait été la cible. Les dégâts étaient très importants et les victimes nombreuses, en particulier dans un abri de la SNCF qui s'était effondré sous les bombes. L'hôtel où je logeais était presque entièrement détruit, et je me résignais déjà à la perte de ma valise, lorsqu'il apparut qu'une aile avait été épargnée, celle précisément où se trouvait ma chambre. Il n'y avait plus d'escaliers, mais à l'aide d'une échelle, je pus me hisser en deux volées jusqu'à ma chambre au deuxième étage, où je pénétrai par la fenêtre. Je pus ainsi récupérer mes bagages, couverts d'une couche inimaginable de poussière, mais indemnes. Un camarade polytechnicien m'hébergea obligeamment pour les deux nuits que je passai encore à Douai.
Aussitôt après, je me trouvai à Valenciennes, en compagnie de J. Chenevier, venu m'installer dans mon poste. Nous étions au début de juillet. Tout le centre de la ville avait été rasé par les bombardements. Il ne restait plus qu'une ceinture d'immeubles bourgeois, sans doute plus solides, de part et d'autre des boulevards extérieurs.
Le service des mines occupait un de ces bâtiments, bd Carpeaux, réquisitionné à cet effet. J'avais comme collaborateurs quatre ingénieurs TPE, qui se partageaient, sous mon autorité, le contrôle des mines de charbon du secteur, principalement les mines d'Anzin, et deux petites compagnies, Thivencelles et Crespin. Ils assuraient aussi les autres activités du service des mines: réception des camions soumis à contrôle technique, contrôle des appareils à pression, surveillance des carrières. Je disposais aussi d'un adjoint technique et de trois secrétaires, dont le chef de bureau, Mlle Dupont, qui était la mémoire du service. Son bagout était intarissable, notamment sur les habitudes et manies de mes prédécesseurs. Elle en a, je le suppose, raconté autant sur moi à mes successeurs.
Je n'avais au départ aucun logement. Un ingénieur en chef des mines d'Anzin, René Tacquet, dont la famille était réfugiée dans le midi, et qui occupait donc seul une grande maison, m'offrit l'hébergement. Le jour, nous vaquions chacun à nos occupations, et nous retrouvions le soir pour dîner. Je n'ai disposé d'une voiture de service qu'un peu plus tard. Ma maison d'accueil étant située à Haveluy, commune assez éloignée de Valenciennes, je circulais par le chemin de fer d'Anzin à la frontière belge, petit chemin de fer minier partiellement affecté au service public, et je terminais mon parcours en bicyclette.
Ce premier contact avec le le Nord, occupé par les Allemands, ne dura qu'une courte période. Si le contrôle de la population relevait de la Gestapo, les mines étaient placées sous la surveillance et le contrôle d'un fonctionnaire économique qui, par chance, se trouvait être un homme francophile et compréhensif, l'oberbergrat doctor Schensky, qui cherchait à éviter les incidents, et avec qui les mineurs français purent renouer après la guerre des contacts cordiaux.
Mais dès la fin Août, nous apprenions la libération de Paris, et à peu près dans le même temps, les troupes allemandes commencèrent à évacuer la région du nord. Ce n'était plus la glorieuse armée de 1940. Elles étaient très démunies en moyens de transport, et faisaient main basse sur tout ce qui pouvait subsister comme véhicules dans la région, non seulement les voitures laissées imprudemment en état de marche, mais jusqu'aux bicyclettes. La mienne était camouflée en lieu sûr, et pendant quelques jours j'ai beaucoup marché. Les résistants, dont l'activité avait été discrète pendant cette période finale de l'occupation, firent une apparition bruyante, prirent possession des mairies, créèrent des comités provisoires de libération. Le retour à une administration plus normale ne tarda cependant pas très longtemps.
La guerre était finie pour nous...Pas tout à fait cependant. Des armes de la résistance traînaient dans la région, et tombaient souvent aux mains de citoyens dont les objectifs n'avaient plus rien de libérateur. Un dimanche après-midi, pendant que R. Tacquet et moi lisions paisiblement dans le salon de notre demeure, nous vîmes surgir avec stupeur un individu en cagoule, et porteur d'un fusil, dont les intentions n'avaient visiblement rien d'amical. En nous enfermant à la cave, il nous soulagea de nos portefeuilles et de quelques objets, à vrai dire peu nombreux, car la maison n'était pas, en cete fin de guerre et en l'absence de la plupart de ses occupants normaux, richement équipée. Très penauds, nous sommes allés porter plainte à la gendarmerie et à la police. Durant les jours suivants, la gendarmerie s'agita beaucoup, sans résultats. Ce fut la police, apparemment très passive, qui mit pourtant la main sur le cambrioleur, sur dénonciation, solution visiblement plus efficace qu'une vaine agitation. Nous avons récupéré nos portefeuilles à peine allégés. L'individu n'avait pas eu le temps de dépenser, ni de planquer la plus grande partie des sommes contenues.
Peu de temps après, j'ai bénéficié d'un logement plus commode que la lointaine maison d'Haveluy. D'honorables bourgeois de Valenciennes, M. et Mme Raguin, habitant par chance une maison épargnée sur les boulevards, acceptèrent de mettre une grande chambre à ma disposition. Il s'avéra qu'un de leurs neveux était un de mes anciens condisciples du lycée Condorcet, Jacques de Chalendar, avec qui j'avais gardé des relations amicales, bien qu'espacées. A vrai dire, l'offre de M. et Mme Raguin ne fut pas le fruit de cette circonstance, mais d'une considération beaucoup plus prosaïque. Le charbon domestique était encore rare et contingenté, même pour les habitants de la région minière. En tant qu'ingénieur des mines, j'avais droit à des fournitures de charbon des mines d'Anzin, qui alimenteraient le chauffage central de mes hôtes.
Peu après, je fus muni d'une voiture de service un peu essoufflée, et dont les pneus avaient souvent des problèmes, mais qui me permettrait de circuler pour exercer mes fonctions. Encore me fallait-il avoir le permis de conduire. J'avais bien conduit quelques voitures militaires à Fontainebleau, mais je n'avais pas mon permis civil. Une disposition réglementaire habilitait les chefs d'arrondissements minéralogiques, sans doute en raison de leurs attributions en matière de contrôle des véhicules, à décerner le permis de conduire à leurs subordonnés. Je demandai donc à l'ingénieur général Duhameaux de me faire passer mon permis. Il accepta sans difficulté de me décerner ce permis, mais sans consentir, vu ses occupations absorbantes, à me faire passer le moindre examen. Ce fut donc après une pratique militaire très modeste, et avec une conduite un peu hésitante au début, que je me risquai sur les routes de l'arrondissement.
En dehors des occupations habituelles d'un ingénieur ordinaire des mines, la sortie de la période de guerre générait quelques tâches inhabituelles:
Les directeurs de ces compagnies étaient tous évincés, quel qu'ait été leur comportement sous l'occupation, même si certains avaient eu une attitude nettement résistante. Michel Duhameaux, l'ingénieur général déjà plusieurs fois cité, devenait directeur général des Houillères nationales. Les directeurs de groupes étaient des hommes nouveaux. Les mines du secteur de Valenciennes formaient un seul groupe. Le directeur choisi pour ce groupe était Jacques Walch, que je ne connaissais pas encore, mais dont j'avais entendu parler à Bruay, quand je m'occupais du système Bedaux, car c'était lui, en tant que directeur de la SOTRAM, une société de conseil, qui avait été le promoteur de ce système dans toutes les compagnies minières qui l'appliquaient.
L'arrondissement minéralogique hérita d'un nouvel ingénieur en chef, Paul Baseilhac, qui était en même temps, es qualité, commissaire du gouvernement auprès des Houillères nationales. Ses collaborateurs, les ingénieurs ordinaires, dont moi-même, reprirent les tâches normales du service, la surveillance des exploitations minières étant la principale. Il s'agissait essentiellement de contrôler l'observation de règles de sécurité, codifiées dans le solennel règlement général d'exploitation des mines, et les textes subséquents. Plus heureux que la plupart des ingénieurs du corps, qui n'ont normalement sur la mine, lorsqu'ils débutent, que des connaissances surtout théoriques acquises à l'école, j'avais la chance d'avoir bénéficié d'un an d'exercice pratique grâce au STO, ce qui me donnait un minimum d'assurance dans mes fonctions de contrôle.
J'étais naturellement assisté par les ingénieurs TPE, qui avaient une expérience beaucoup plus longue que la mienne. Un jour l'un d'eux me remit un rapport au vitriol sur les problèmes de sécurité d'une fosse qu'il venait de visiter. Je transmis, peut-être avec un certain manque de nuances, à la direction du fond du groupe d'exploitation. Naturellement l'ingénieur responsable se fit sérieusement chapîtrer. Je n'avais décidément pas de chance, c'était un ami de R. Tacquet, qu'il avait hébergé après moi.
Il y avait encore à l'époque de nombreux accidents mortels dans la mine (de grands progrès ont été faits par la suite). L'enquête sur de tels accidents était diligentée par le service des mines qui proposait, suivant ses conclusions, des mesures administratives, le plus souvent le renforcement de certaines dispositions de sécurité, et parfois des poursuites judiciaires, lorsque de graves négligences étaient relevées. Des ingénieurs avec lesquels j'avais par ailleurs de bonnes relations, pouvaient à l'occasion être mis en cause. Cela ne m'arriva heureusement que rarement, mais une fois à la charge du directeur d'un groupe d'exploitation autre que Valenciennes, que je me trouvais contrôler par intérim.
Le service des mines avait aussi le contrôle des carrières. A Valenciennes, il s'agissait surtout de carrières souterraines de calcaire, avec des champs d'exploitation assez anciens. Il n'existait souvent pas de plans précis de leur localisation, et parfois l'une d'elles se manifestait à l'improviste par un éboulement souterrain, suivi d'un puits à l'emporte-pièce dans le champ qui la surplombait. On racontait qu'un laboureur et son attelage avaient un jour disparu dans un tel puits formé sous lui. Je n'ai heureusement pas eu à instruire d'événement aussi dramatique.
Nous recevions assez souvent la visite de l'ingénieur général le Sueur, chargé, entre autres, d'inspecter l'arrondissement minéralogique de Lille. Il était assez pointilleux, mais bienveillant. Plus sourcilleux que nous, qui acceptions sans scrupules les invitations des dirigeants des houillères, surtout depuis qu'elles étaient nationalisées, il n'acceptait jamais, même après une descente de mine, de déjeuner avec ceux-ci, pour ne pas compromettre sa position de contrôleur à contrôlé. Par contre, il acceptait, à l'occasion, de déjeuner chez les Chenevier.
Parfois les problèmes miniers à traiter étaient l'occasion de voyages distrayants. Ainsi il se produisit dans un puits, pendant mon séjour à Valenciennes, un dégagement instantané de grisou. Ce phénomène, jusque-là inconnu du bassin, se traduit, comme son nom l'indique, par une émission quasi explosive et très dangereuse de grisou, accompagnée par la projection d'une masse importante de poussier de charbon, généralement à la suite d'un tir de mine. Les houillères des Cévennes sont particulièrement exposées à ces dégagements, qu'elles savent prévenir et maîtriser par des tirs préventifs, appelés tirs d'ébranlement. Nous avons donc entrepris, avec Jacques Walch et quelques ingénieurs, une expédition en voiture à Alès, avec passage à la station d'essais des houillères à Montluçon, pour étudier le phénomène, et élaborer les consignes utiles pour le bassin du Nord.
Les problèmes politiques touchaient de nouveau le bassin. Nous étions au temps des gouvernements tripartites, associant MRP, socialistes et communistes. Au début de 1946, après la démission du général de Gaulle, le ministère de la production industrielle fut occupé par Marcel Paul, électricien d'origine cégétiste et communiste, qui fut assisté par un secrétaire d'Etat chargé des mines, Auguste Lecoeur, enfant du bassin minier. Un beau jour, parut à l'improviste au JO un arrêté destituant les trois directeurs généraux adjoints, choisis par M. Duhameaux pour leurs connaissances minières et leurs capacités de gestionnaires, et nommant à leur place trois nouveaux venus: Jean Armanet, ingénieur du corps des mines, professeur d'exploitation des mines, d'ailleurs compétent, dont j'avais suivi les cours à Paris, qui s'était inscrit à la CGT à la fin de la guerre; Jean Dumay, bon exploitant minier, mais qui, ayant une femme sarroise, n'avait pu éviter d'accueillir des officiers allemands pendant la guerre, et avait cru devoir se dédouaner à la libération, en s'inscrivant lui aussi à la CGT; et enfin Léon Delfosse, secrétaire général de la fédération CGT du sous-sol.
Ces trois personnages, chacun dans son style, n'étaient pas sans qualités, mais étaient visiblement mis en place, de manière parfaitement contestable juridiquement, pour assurer l'encadrement idéologique du bassin. M. Duhameaux, dont le caractère se manifestait particulièrement lorsqu'il devait résister, réagit en refusant toute délégation de pouvoir à ces adjoints imposés. Ceux-ci étaient reçus poliment dans les groupes d'exploitation, mais éconduits dès qu'ils tentaient d'intervenir dans la gestion. Cette situation ne facilitait évidemment pas les relations entre le service des mines et les Houillères.
Mais les choses évoluèrent de nouveau assez vite. En mai 1946, une nouvelle loi nationalisait cette fois l'ensemble des houillères françaises, créait les Charbonnages de France, CDF, chargés de diriger et coordoner l'ensemble, et adaptait, sous le nouveau nom de Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, HBNPC, la situation administrative des Houillères nationales créées antérieurement par l'ordonnance de décembre 1944. M. Duhameaux quittait l'établissement pour rejoindre les Charbonnages de France, et J. Armanet était nommé, cette fois par un décret tout à fait régulier, directeur général des HBNPC.
Il n'assura pas très longtemps une gestion paisible. Au printemps 1947, Robert Schuman élimina les communistes du gouvernement. Ceux-ci, encouragés par les communistes italiens qui, à l'approche des élections législatives dans ce pays, s'étaient sentis très proches du pouvoir, développèrent en France une forte agitation économique et sociale. Dans le Nord et le Pas-de-Calais, on était bien loin des discours de Maurice Thorez qui, un an encore auparavant, invitait les mineurs à la bataille du charbon. A l'automne 1947, la CGT déclenchait dans l'ensemble du bassin une grève extrêmement violente La CFTC était contre la grève, mais les piquets de grève entravaient toute liberté du travail.
Contrairement aux traditions minières, les mesures de sécurité n'étaient plus assurées, ou menaçaient de ne plus l'être, notamment l'exhaure, c'est à dire le pompage de l'eau au fond des exploitations, pour éviter l'ennoyage des puits. Pour pallier de telles carences, le service des mines dispose de pouvoirs de réquisition au titre de la législation minière, et je dus m'employer à mettre en oeuvre cette procédure. Mais ces pouvoirs ne peuvent s'exercer que par l'intermédiaire des maires qui, communistes pour beaucoup, se refusaient naturellement à toute intervention. Il fallait alors substituer à leur autorité celle du préfet. Pour porter la situation à son paroxysme, le gouvernement fut renversé au milieu de cette grève, qui dura plus d'un mois. L'ordre public était difficilement assuré. A tout moment la grève risquait de devenir insurrectionnelle.
Pourtant, comme toute grève, celle-ci finit par s'épuiser, mais rebondit à l'automne 1948 pour une nouvelle période d'un mois. Entre temps, J. Armanet, dont le manque de caractère pour affronter de telles épreuves s'était manifesté au point de l'avoir vu disparaître, au coeur de la grève, pour un refuge clandestin, avait démissionné et avait été remplacé par P. Baseilhac. Cette fois, en 1948, sous l'énergique autorité du ministre de l'intérieur, Jules Moch, le gouvernement prit de sérieuses mesures pour assurer l'ordre public. Le bassin fut investi non seulement par les CRS, mais par la troupe. Je fis connaissance, à cette occasion, d'officiers qui devaient,, par la suite, faire parler d'eux en Algérie, tels le colonel Massu, le colonel Bigeard, etc. Ils faisaient preuve de détermination et d'efficacité, mais confondaient un peu leur intervention avec de grandes manoeuvres. Quand on les entendait discuter de sièges miniers pris, évacués et repris, il fallait leur rappeler gentiment que l'objectif n'était pas de jouer à la petite guerre, mais de remettre les mineurs au travail.
Du côté du préfet de région [qui ne s'appelait d'ailleurs pas encore ainsi, mais IGAME (inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire)], l'énergie était beaucoup moins grande. Je me rappelle avoir assisté avec consternation à une réunion dans son bureau pour examiner la nécessité de faire évacuer un établissement minier en état de quasi insurrection. Le général commandant la région demanda calmement si ses hommes, armés de mousquetons, devraient avoir des munitions dans leurs cartouchières. Le préfet blêmit et s'écria: "Messieurs, vous ferez ce que vous voudrez. Moi, je ne veux rien décider; je ne suis qu'un employé, l'employé du gouvernement !"
Un épisode beaucoup plus pittoresque fut l'initiative d'A. Lecoeur qui, pour venir en aide aux familles des mineurs, privés de leur paie, émit et distribua, au nom de la CGT, des coupures pseudo-monétaires, immédiatement baptisées "bons Lecoeur", et que les commerçants devaient accepter à leur corps défendant jusqu'à un remboursement ultérieur et problématique par la CGT. Le plus drôle était que les juristes du ministère des finances restaient perplexes sur les moyens légaux de mettre un terme à cette émission, qui n'était pas vraiment de fausse-monnaie, mais de reconnaissances de dettes. Cette grève se termina elle aussi et la vie du bassin reprit un cours plus normal.
Après le départ de P. Baseilhac aux HBNPC, J. Chenevier était devenu chef de l'arrondissement minéralogique. Cette fonction était associée à la direction de l'école technique des mines de Douai, qui forme, entre autres, les futurs ingénieurs TPE des mines. J'étais moi-même, depuis mon affectation à Valenciennes, professeur de physique dans cette école, et associé à sa direction. Il arriva qu'un "comité de la hache", créé au ministère de finances pour promouvoir des économies budgétaires, décida que, jusqu'à nouvel ordre, les fonctionnaires et agents publics quittant leurs postes ne seraient remplacés que sur autorisation expresse. L'école de Douai utilisait les services de quatre femmes de ménage, personnel assez volatil. Précisément pendant cette période, une, puis deux, puis trois, et finalement la quatrième femme de ménage quittèrent l'école sans pouvoir être remplacées, malgré les demandes de plus en plus énergiques formulées à l'occasion de chacun des départs.
Nous avons alors décidé la fermeture de l'école jusqu'à ce que son entretien puisse être de nouveau assuré. Naturellement cette décision provoqua dans la région une forte émotion, qui remonta jusqu'au niveau politique. La direction du budget, responsable de cet état de choses, eut l'audace de demander au ministère de l'industrie, tuteur de l'école, des sanctions, évidemment refusées, contre sa direction, mais dut finalement consentir au remplacement de deux des femmes de ménage. Pour tout avouer sur les turpitudes des fonctionnaires des services extérieurs, parfois inévitables pour survivre administrativement, nous avions pourtant, dans l'intervalle, conservé les services d'une femme de ménage, rémunérée grâce à de fausses factures de viande, avec la complicité d'un boucher.
J'eus à peu près dans le même temps, un problème à Valenciennes pour l'installation de mon service. Le texte qui avait permis la réquisition de l'immeuble où il siégeait fut abrogé, sans que le gouvernement se préoccupe beaucoup apparemment du devenir de ceux de ses services extérieurs devenus ainsi occupants sans titre. Le propriétaire de mon siège demanda d'abord poliment de substituer à l'indemnité de réquisition assez maigre dont il bénéficiait, un loyer plus normal. Devant le refus désinvolte de l'aministration générale du ministère, il demanda et obtint, par voie judiciaire, l'expulsion de mon service. J'obtins seulement un délai de grâce pour me reloger. Ce fut finalement le groupe de Valenciennes des HBNPC qui implanta bénévolement à mon intention un chalet en bois sur un terrain appartenant à la ville, et dont celle-ci, également bienveillante, acceptait l'occupation.
En dehors de mes fonctions à l'arrondissement de Lille, j'avais accepté d'être enquêteur au comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics. Cet organisme, comme le comité de la hache, mais avec des procédés moins brutaux, avait pour mission le dégraissage et la rationalisation des services publics. Sa particularité était d'utiliser des fonctionnaires chargés d'enquête dans des secteurs autres que leur propre administration. C'est ainsi que je fus chargé, sous l'autorité de l'inspecteur général des ponts et chaussées Wahl, d'une enquête sur la direction de l'aéronautique au ministère de l'armement, et les sociétés de construction aéronautique.
Le ministre de l'armement Charles Tillon, communiste, n'appréciait pas cette enquête. (Les communistes étaient encore au gouvernement au momemt où fut lancée la mission). Quand je me rendis à l'usine des Mureaux, le président Pissavi, ami de Tillon, me reçut d'abord assez mal, puis se montra progressivement plus coopératif, et m'offrit même, à la fin de mon passage, un baptême de l'air par un pilote d'essais. Je n'avais bien entendu jamais volé pendant la guerre. Le pilote me fit faire quelques rase-mottes, sans doute pour éprouver mon sang-froid, mais n'alla pas jusqu'au looping.
Mon enquête me conduisit aussi au siège de la direction ministérielle de l'aéronautique. Dans mes investigations sur les problèmes commerciaux, j'eus quelques surprises, par exemple de découvrir qu'un avion se vendait au kilo, comme des pommes de terre. J'eus aussi une expérience piquante. Les bureaux ouvraient à 9h. Le directeur de la production aéronautique, avec qui j'avais rendez-vous un jour à 9h, me fit attendre une heure, en raison d'une obligation imprévue et fort légitime. Pendant que j'étais en salle d'attente, je vis le personnel de sa direction arriver petit à petit, et à 10h le flux n'en semblait pas tari. Quand le directeur me reçut enfin, il m'expliqua laborieusement qu'il manquait de personnel pour assumer ses tâches, ce que j'eus quelque mal à croire, après avoir observé l'assiduité dudit personnel.
Au milieu de cette enquête, Albin Chalandon, inspecteur des finances, futur ministre, qui faisait partie de la même mission que moi, et qui soignait déjà son image de marque, publia à l'improviste, et sans en référer au chef de mission, un rapport au vitriol sur les sociétés de production aéronautique qui, sans être des modèles de gestion, n'en méritaient pas tant. C'était visiblement une opération anticommuniste. L'affaire se traduisit par une interpellation à la Chambre. Charles Tillon prononça un discours ironique, qui commençait en ces termes: "M. Chalandon, inspecteur des finances, sait de quel côté sa tartine est beurrée..."
Ma mission me conduisit enfin en Afrique du Nord, pour une inspection des ateliers d'entretien aéronautique en Algérie et au Maroc.C'était naturellement mon premier contact avec l'Afrique du Nord, qui m'impressionna beaucoup. Mon voyage fut marqué par un petit incident. Tandis que je me rendais d'Alger à Rabat dans un avion monomoteur Nord 1000, en compagnie du seul pilote militaire, le moteur unique soudain crachota, puis se tut, dans la zone la plus escarpée entre l'Atlas et le Rif, sans grand espoir d'atterrissage de fortune. En pareil cas, on se dit que le pilote doit savoir quoi faire. Mais dans ce petit avion, j'étais assis juste derrière le pilote, et je voyais bien qu'il tripotait nerveusement ses commandes d'une manière peu rassurante. Enfin il tourna une manette avec un large sourire. Il avait seulement oublié de passer d'un réservoir sur l'autre.
A Rabat, en dehors de l'objet propre de mon voyage, j'étais chargé par P. Baseilhac d'une mission auprès de Jean Couture, alors directeur de la production industrielle dans le protectorat. Nous étions en 1948. P. Baseilhac, qui n'avait pas encore accepté la direction générale des HBNPC, pensait que J. Couture ferait un meilleur candidat, et m'avait chargé de le pressentir. Mon intervention fut suivie en effet, peu après, de l'arrivée de J. Couture aux HBNPC, mais comme directeur général adjoint. Il avait convaincu P. Baseilhac que c'était à lui de prendre la direction générale.
Lors de ma visite à J. Couture à Rabat, je fus témoin d'un incident amusant et caractéristique. Pendant que nous déjeunions, on sonna à l'entrée, et je pus apercevoir un mitron porteur d'une superbe tarte, que J. Couture renvoya sèchement. Il m'expliqua aussitôt l'épisode. Le pâtissier, producteur et envoyeur de la tarte, désirait une voiture neuve. J. Couture était répartiteur de ces engins, encore rares après la guerre. Tous les dimanches, le pâtissier essayait, sans se décourager, de gagner les bonnes grâces du répartiteur, par l'envoi d'une tarte régulièrement refusée.
Vers la fin de l'année 1948, J. Chenevier me demanda de devenir son adjoint direct à la direction de l'arrondissement minéralogique, avec résidence à Lille, et supervision de l'ensemble des activités du service. En dehors de mes compétences antérieures, j'exerçais un contrôle, purement administratif celui-là, sur l'industrie sidérurgique de la région. La direction des mines était devenue direction des mines et de la sidérurgie, et exerçait sur cette dernière activité une tutelle, surtout consacrée aux répartitions de matières premières, spécialement le coke, qui étaient encore en vigueur à cette époque.
J. Chenevier quitta son poste dans le courant de l'année 1949, pour pantoufler dans une entreprise pétrolière au nom suranné, la Société générale des huiles de pétrole, mais qui reçut bientôt le nom plus commercial de Société française des pétroles BP, filiale du groupe anglais du même sigle. J'exerçai pendant quelques mois l'intérim du chef d'arrondissement.
J'eus à mon tour, pendant cette période, l'occasion de décerner un permis de conduire, à mon successeur à Valenciennes, Michel Collas. Mais plus consciencieux que l'ingénieur général Duhameaux, ou surtout moins occupé, je fis réellement passer un examen à l'intéressé. A la fin de l'épreuve, je lui dis que, pour ne pas risquer de remonter en voiture sous sa conduite, je lui donnais son permis ! C'était bien sûr une plaisanterie.
Un nouvel ingénieur en chef arriva bientôt, Pierre Robert, avec qui je coexistai peu de temps, car, peu après, je quittai moi-même l'administration.
Du CERCHAR au cabinet du ministre de l'industrie
Le CERCHAR se consacrait essentiellement à des recherches techniques, pour lesquelles je n'étais pas particulièrement préparé. Mais Raymond Chéradame qui le dirigeait alors, souhaitait innover avec des investigations sur les méthodes d'exploitation minière, et me chargea d'une étude sur l'évolution de ces méthodes dans les pays étrangers. Je fis à cet effet un certain nombre de voyages dans des bassins houillers britanniques, le Midland et Edimbourg, en Sarre et en Ruhr.
A Essen, en dehors de visites minières, je pris contact avec l'organisme interallié de contrôle de la Ruhr, qui avait été installé aussitôt après la guerre, et qui occupait la villa Hügel, l'ancien siège de Krupp. Nous étions en période hivernale, et une caractéristique me frappa aussitôt. A partir de 17h, les bureaux des Anglosaxons étaient tous éteints, leurs occupants ayant gagné le bar. Seules les fenêtres des Français restaient allumées, témoignant de leur mauvaise habitude de travail tardif. Le directeur de la section française de l'organisme interallié, Georges Parisot, me reçut aimablement, et me donna des informations intéressantes.
Après ces voyages européens, je m'apprêtais à partir aux USA, en compagnie de Jean Audibert, un camarade de corps de la promotion 1941, fils du président des CDF, qui venait d'entrer aux HBNPC. Mais une proposition inattendue vint contrarier ce programme. Les socialistes venaient de quitter le gouvernement de Georges Bidault. Jean-Marie Louvel, MRP, remplaçait en conséquence Robert Lacoste, socialiste démissionnaire, comme ministre de l'industrie. Il me demandait d'entrer dans son cabinet. J. M. Louvel était, à cette époque, maire du Vésinet. Il connaissait bien mon père. S'il désirait avoir un ingénieur des mines à son cabinet, c'était donc mon nom, plus que ma modeste réputation qui avait dicté son choix.
J'étais assez ignorant de ce qu'était un cabinet ministériel, et restais donc fort perplexe. J'allai demander conseil à Jacques Desrousseaux, alors directeur des mines au ministère, qui m'assura que la présence d'un ingénieur des mines au cabinet était très utile....et pourquoi pas moi ! C'est ainsi que, remettant à plus tard un voyage aux USA, j'entrai au début de 1950 au cabinet du ministre de l'industrie.
J'étais chargé principalement de suivre les activités de la direction du gaz et de l'électricité et de la direction des mines au ministère, et les affaires des grandes entreprises énergétiques, nationalisées en 1946, EDF,GDF,CDF.
La direction du gaz et de l'électricité était assurée par un ingénieur général des ponts et chaussées, Henri Varlet, que je voyais assez peu . J'étais surtout en relation avec son principal adjoint, Ambroise Roux, devenu plus tard une notabilité industrielle. Notre principale préoccupation, sur instruction du ministre, était la mise en place des établissements publics de distribution d'EDF. La loi de nationalisation avait en effet prévu, pour éviter la centralisation excessive d'EDF, la création d'établissements autonomes, bien que dans une certaine dépendance de l'établissement central, et chargés de la distribution. Roger Gaspard, directeur général d'EDF, assez autoritaire, redoutait de perdre, dans cette opération, une partie de son pouvoir et de son prestige, et tous ses efforts tendaient à la faire échouer. J'avais par contre pour allié la fédération des autorités concédantes, groupant les communes intéressées et assurant notamment la gestion du fond d'électrification rurale. Cette fédération aurait bénéficié de sièges dans les conseils d'administration des nouveaux établissements.
Les actions de lobbying se développaient de part et d'autre. J'avais souvent à discuter avec le cabinet du ministre des finances, Maurice Petsche. Un jour, je me fis dire, à ma grande fierté: "On ne peut plus discuter avec vous. Votre mauvaise foi égale celle des inspecteurs des finances" . Mon interlocuteur, avec qui j'avais d'ailleurs d'excellentes relations, était bien entendu lui-même un inspecteur des finances.
Mauvaise foi ou pas, R. Gaspard, qui avait l'oreille de M. Petsche, finit par le convaincre que la mise en place des nouveaux établissements se traduirait par des coûts supplémentaires élevés, et finalement l'opération n'aboutit pas, malgré les dispositions fort précises de la loi. On peut le regretter. Notamment, à l'heure de la dérégulation, l'existence des établissements autonomes de distribution aurait été un facteur de protection des intérêts français.
Une autre affaire importante d'EDF a nécessité mon intervention. La construction du barrage de Tignes commençait, ainsi que les négociations sur l'indemnisation des propriétaires expropriés. Sous la pression de ceux-ci, les montants envisagés avaient atteint des niveaux sensiblement trop élevés par rapport aux normes habituelles. EDF, pour qui ces montants représentaient peu de choses au regard du coût de l'ouvrage, se défendait très mollement; risquant de créer un assez fâcheux précédent.
Je dus reprendre l'affaire en mains. Mes efforts pour faire baisser le niveau des indemnités générèrent bien entendu une certaine tension. J'avais droit aux admonestations téléphoniques d'un sénateur de la Savoie, défenseur du faible et de l'opprimé, qui finit par me déclarer, à l'avance, responsable de l'envoi inévitable des CRS à Tignes. Cette menace ne m'impressionnait guère, car j'avais assez vite repéré que mes interlocuteurs les plus acharnés étaient les Tignards de Paris, pour qui leur expropriation à Tignes devait être une affaire aussi juteuse que possible, mais qui n'avaient pas la moindre intention de venir sur place affronter les CRS. L'affaire se termina en effet sans violence et sans CRS, avec des niveaux d'indemnités plus acceptables. EDF ne parut pas me savoir gré de l'économie que je lui avais procurée.
Avec GDF, le premier problème que je dus affronter fut celui du prix du gaz. Pour des raisons plus ou moins démagogiques, ce prix avait été maintenu à un niveau si bas qu'il rendait impossible une gestion financière autonome de l'établissement. Aussi bien, cette gestion était provisoirement assurée par EDF, et GDF ne pouvait prétendre à l'indépendance prévue par la loi. Il fallait sortir de cette situation, et le gouvernement finit par décider courageusement une augmentation massive du prix du gaz. Il y eut, comme souvent, une fuite avant la sortie de la décision, ce qui permit à France-Soir de titrer en grosse manchette: "Le prix du gaz augmente de 60 %".
J. M. Louvel fut agacé de cette annonce prématurée. Il bloqua le texte de la décision, et me chargea d'en préparer une nouvelle, d'où ne ressorte pas aussi clairement le taux de l'augmentation. Je concoctai donc une formule quelque peu sophistiquée, et d'ailleurs légèrement différenciée par régions, qui fut celle publiée. Le journaliste de France-soir, vexé à son tour d'être pris à contre-pied, titra cette fois: "Avec un atlas et une table de logarithmes, vous pourrez connaître le prix du gaz"; une note ajoutait: "Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à M. Gardent, Tel..." J'en fus quitte pour condamner mon téléphone pendant quelques jours.
Un autre problème important mit aux prises mon camarade Jean Sabatier, mon prédécesseur à Valenciennes, devenu directeur des industries de la houille aux Houillères du bassin de Lorraine, les HBL, et Georges Combet, directeur général de GDF. Les HBL développant leurs cokeries, les usages régionaux devenaient insuffisants pour écouler l'importante production de gaz. Il fut décidé de construire un gazoduc (on disait "feeder gazier" à l'époque) , pour faire participer ce gaz à l'alimentation de la région parisienne. Un contrat commercial devait donc être conclu entre HBL et GDF. Les négociations entre les deux établissements s'avérèrent difficiles, et je fus chargé d'un arbitrage, qui m'amena à convoquer à plusieurs reprises les deux protagonistes dans mon bureau au ministère. Les échanges d'arguments étaient parfois sans aménité. Un jour, J. Sabatier taxa un propos de G. Combet de jésuitisme, allégation d'autant plus mal venue que ce dernier était protestant. L'intéressé, furieux, sortit de mon bureau en claquant la porte, et je dus lui courir après dans le couloir, pour apaiser son ire et le ramener à la table des débats. Je finis laborieusement par faire accepter aux deux intéressés un compromis, qui permit effectivement l'acheminement du gaz lorrain vers Paris.
Dans le secteur du charbon, j'eus peu de problèmes avec J. Desrousseaux, directeur des mines, qui me transmettait pour signature du ministre des textes parfaitement préparés. J'avais surtout des relations avec Roger Cadel, directeur général des CDF. Il avait longtemps dirigé les mines de Petite Rosselle en Lorraine, et était auréolé d'une réputation de grand technicien, mais aussi de terreur. La légende disait que lorsqu'au fond de la mine, un cheval se montrait rétif, il suffisait au conducteur de lui murmurer à l'oreille, dans son patois lorrain: "Der Herr Cadel kommt" (Monsieur Cadel arrive), pour qu'immédiatement le cheval file doux.
R. Cadel aurait préféré la direction générale des HBL, pour rester plus près des exploitations, mais ce poste avait été dévolu à M. Duhameaux, et c'est ainsi qu'il se retrouva aux CDF, avec une humeur un peu morose, dans un poste peut-être plus honorifique, mais plus loin du tas. Les observateurs de la profession se demandaient avec curiosité comment il accrocherait avec un interlocuteur comme moi, de profil bien différent du sien. En réalité, nous nous sommes tout de suite bien entendus. Très rapidement il me demanda d'entrer aux CDF, plutôt qu'aux HBNPC, quand je quitterais le cabinet du ministre.
Nos principaux contacts concernaient les négociations des CDF avec les organisations syndicales minières. Elles étaient fréquentes et souvent laborieuses, et aucun accord ne pouvait être conclu sans l'aval du ministre. Un jour, R. Cadel passa outre. J. M. Louvel, qui ne plaisantait pas avec les règles administratives, parlait de le révoquer, heureusement sans suite. R. Pleven, alors président du conseil, lui prescrivit plus de circonspection. Dans des évolutions salariales compliquées et incessantes du fait de l'inflation, R. Cadel appréciait les tableaux que j'établissais sur les situations comparées des différentes catégories d'emploi, qui étaient plus clairs, me disait-il, que les documents élaborés par ses services.
Il y avait aussi les problèmes de grands travaux. La plupart des grands ensembles nécessaires pour remettre en état et moderniser les houillères, après les dommages et les lacunes de la guerre, avaient été lancés. Le ministre des finances devenait plus réticent pour financer les investissements encore nécessaires. Un épisode assez typique marqua cette situation. Un groupe électrique avait été commandé pour Messex, une petite mine de l'Allier. Mais aussitôt après, il apparut que la production de Gardanne, en Provence, ne pouvait être entièrement écoulée sans accroissement de la puissance électrique installée dans ce bassin. Il n'était pas possible d'obtenir rapidement le financement d'un nouveau groupe pour Gardanne. Les CDF décidèrent donc que celui commandé pour Messex serait envoyé à Gardanne, où il consoliderait un volume d'emploi beaucoup plus important; alors que Messex pouvait à la rigueur s'en passer.
Les parlementaires de l'Allier s'insurgèrent bien entendu contre le dépouillement de leur département. J. M. Louvel, qui aimait se rendre compte par lui-même, passa par Messex, en ma compagnie, lors d'un voyage dans la région. Cela lui permit, lorsqu'il fut interpellé à l'Assemblée sur le "démantèlement" de la centrale de Messex, de répondre qu'il était allé sur place et que le prétendu démantèlement se limitait à l'abandon de 50 m de route d'accès, sans qu'aucun travail n'ait débuté sur le terrain. Cela mit fin à l'interpellation.
Le ministre n'avait pas l'habitude de partir tôt le soir. S'il n'avait pas eu le temps de vous recevoir das la journée, son bureau était facilement accessible après 20 h, ce dont je profitais largement, puisque, célibataire, je n'étais pas non plus pressé de partir. Il était alors très cordial. Souvent nous prenions l'apéritif, en discutant les affaires pendantes, et en préparant les prochaines séances à l'Assemblée.
Il m'arrivait assez souvent de l'y accompagner, comme commissaire du gouvernement. Cette fonction autorisait à s'asseoir derrière le banc du gouvernement, dans le dos du ministre, et à lui glisser des petits papiers pour faciliter ses réponses sur des questions dont il ne connaîssait pas forcément tous les détails. La tâche du commissaire du gouvernement ne se limitait pas à ce rôle de souffleur. Il devait corriger les épreuves du compte-rendu analytique, sténotype en séance. Au début, je me contentais timidement de corriger les fautes de français. Puis je me permis de substituer à quelques passages des tournures plus élégantes. Enfin je m'enhardis à certaines corrections sur le fond, lorsqu'elles me paraissaient mieux traduire la politique du ministre et du gouvernement.
Dans les articles des journalistes parlementaires, on pouvait assez bien distinguer les zélés qui avaient pris des notes en séance, et ceux qui s'étaient contentés de lire après coup le compte-rendu analytique. Un jour, je me risquai à faire dire au ministre, un peu abusivement au regard du discours prononcé, qu'il se proposait de contrôler et orienter la politique des entreprises nationales, mais non de se substituer à elles dans leurs actes individuels de gestion. Le lendemain, je découvris dans la presse le titre suivant: "Le ministre de l'industrie définit une nouvelle doctrine de la tutelle des entreprises publiques" . Je ne sais pas si le ministre en demandait tant.
Au milieu de mon séjour au cabinet, intervinrent les élections législatives de 1951. J. M. Louvel devait défendre son siège de député du Caivados. J'étais conseiller technique du ministre, et n'avais pas de raison de m'occuper de ce scrutin, qui n'aurait dû intéresser que le versant politique du cabinet. Mais je réalisai que c'était sans doute la dernière occasion qui me serait offerte dans ma vie, de participer à une campagne électorale, ce en quoi l'avenir me donna raison. J'eus envie de faire l'expérience, et partis pour Caen avec mon ministre....ou plutôt mon candidat, et une petite équipe du cabinet.
Le matin, nous lisions la presse et préparions les actions nécessaires. L'après-midi, je faisais des visites, pour vanter les mérites de J. M Louvel, au long d'un parcours redoutablement arrosé de calvados. On me disait parfois gentiment: "Nous votons plus à droite, mais vous nous avez fait découvrir les mérites du MRP et de votre candidat". Le soir était le moment le plus excitant de la journée. J'allais porter la contradiction dans les réunions électorales du candidat RPF, Triboulet, homonyme du célèbre fou du roi, le plus redoutable de nos adversaires. Je le faisais de bon coeur, car je n'avais qu'assez peu de sympathie pour le programme RPF lancé par le général de Gaulle. A la première de ces réunions, Triboulet, qui n'avait l'expérience que de la contradiction des militants locaux, fut assez déconcerté par mon argumentation. Aux réunions suivantes, il avait bien entendu préparé des répliques mordantes à mes propos, et nous avions tout de deux pugilistes sur le ring. La campagne s'acheva, et J. M. Louvel fut élu; Triboulet aussi du reste, malgré le système ingénieux d'apparentements imaginé par les partis gouvernementaux pour faire barrage au RPF.
Je rentrai à Paris, et fus très occupé par un tout autre problème. Robert Schuman avait lancé sa proclamation européenne, et il convenait de préparer et négocier la mise en place de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA. Jean Monnet, commissaire général du Plan, avait été chargé de cette mission pour la partie française. Il devait être assisté dans cette tâche par des représentants des ministères intéressés, au premier rang desquels le ministère de l'industrie. J. M. Louvel me désigna à cet effet.
Nous avons tenu de très nombreuse réunions avec J. Monnet. Il devait apprécier mon concours, car lorsqu'il devint le premier président de la Haute Autorité de la CECA, il tenta de m'attirer auprès de lui, en m'offrant une direction dans la toute jeune administration de ce premier organisme européen. Je récusai cette offre, de contenu d'ailleurs difficile à apprécier, puisque j'étais orienté vers les CDF. Pendant les négociations, je tenais bien entendu mon ministre au courant de leur avancement. Il n'était pas toujours d'accord, mais assurait que la concertation en était au niveau des experts, et que lorsqu'elle en viendrait au niveau politique, il pourrait faire valoir son point de vue. J'étais très sceptique à ce sujet. J. Monnet était une trop forte personnalité pour que le gouvernement puisse largement modifier le projet qu'il aurait préparé et négocié.
J'avais également à tenir au courant et convaincre, si possible, les dirigeants des deux industries concernées. Je ne rencontrais pas trop de difficultés du côté des CDF, n'était une méfiance antigermanique viscérale de R. Cadel. La Chambre syndicale de la sidérurgie était plus radicalement hostile, et je dus négocier avec elle, et faire accepter par J. Monnet, puis par ses interlocuteurs allemands, divers amendements au texte en préparation, pour neutraliser son opposition. A la fin des travaux, G. Bidault devenu ministre des affaires étrangères, me fit l'honneur de me demander mon avis sur le projet. Je lui répondis que tout dépendrait des hommes qui auraient la charge de le mettre en oeuvre, réponse qui parut lui convenir.
J. M. Louvel me nomma administrateur, représentant le ministère de l'industrie, dans un certain nombre de sociétés: HBL, GDF, SN. Repal, Houillères du sud-oranais. Ma nomination aux HBL n'était qu'une anticipation de mes futures fonctions aux CDF. A GDF, en dehors des problèmes propres à la gestion de rétablissement, j'eus surtout la préoccupation qu'il n'abandonne pas trop vite le charbon, encore consommé dans les cokeries gazières et les usines à gaz.
La société nationale des pétroles algériens, SN. Repal, filiale du Bureau de recherche de pétrole, BRP, avant la création d'Elf-ERAP, et les Houillères du sud-oranais me donnèrent une vue assez large des problèmes algériens. Je me rendis à plusieurs reprises à Hassi-Messaoud et à Hassi-R'mel, assistant aux premières découvertes de pétrole et de gaz naturel au Sahara. Les mines de charbon de Kenadza, près de Colomb-Béchar, me firent découvrir la tension qui existait déjà entre l'Algérie et le Maroc, bien que tous deux sous autorité française. A titre d'exemple, les cartes d'état-major de ces deux pays, toutes établies par des géographes français, ne traçaient pas de la même manière la frontière algéro-marocaine, laissant une large bande frontalière contestée.
J'eus un aperçu du confinement de la main d'oeuvre algérienne dans des tâches subalternes. Un jour, je demandai au directeur du personnel de la SN. Repal, ancien officier des affaires indigènes, intelligent et compétent, pourquoi tous les chauffeurs de la société étaient français. "J'ai bien essayé de prendre des chauffeurs algériens, me dit-il, mais comme pour eux ce métier est une promotion rare, ceux qui y accédaient étaient tellement plus intelligents que les chauffeurs français que même ceux-ci s'en apercevaient, et que l'entente était impossible." Ce bref dialogue me laissa mal augurer de l'avenir de la présence française en Algérie.
J.M.Louvel entreprit lui-même un voyage en Algérie et au Maroc pendant mon séjour au cabinet, et je l'accompagnai. Il fut assez fraîchement accueilli à Alger par le gouverneur général Naegelen, ancien ministre socialiste. Non seulement il ne nous attendait pas à l'aérogare, mais notre avion étant un peu en avance, les collaborateurs chargés de nous y accueillir ne s'y trouvaient pas encore, et nous firent attendre un moment sur le trottoir.
D'Alger nous nous sommes rendus à Colomb-Béchar, où le ministre voulait se rendre compte des perspectives d'un gisement de cuivre récemment découvert à proximité. L'armée avait mis à notre disposition un bimoteur Siebel. Un des moteurs présentait quelques signes inquiétants pendant le trajet. A Colomb-Béchar, nous avons conféré avec les représentants du Bureau de recherche minière en Algérie, que le ministre incita à pousser rapidement la prospection du gisement de cuivre (Il devait malheureusement s'avérer rapidement inexploitable).
Nous devions ensuite gagner le Maroc avec le même avion. Il avait bien entendu été expressément demandé au pilote de faire vérifier le moteur douteux. Cependant au décollage, l'avion fit un cheval de bois. C'est l'équivalent d'un tête-à-queue pour une voiture, mais c'est beaucoup plus méchant. Le train d'atterrissage est cisaillé par flambage; l'avion pique du nez; les hélices accrochent la piste et se mettent en croix; éventuellement les réservoirs sont crevés et l'avion prend feu. Pour notre chance, l'avion s'immobilisa avant ce dernier épisode, et nous en avons été quittes pour sortir précipitamment par une porte dont le seuil se trouvait curieusement au ras du sol, et voir arriver en trombe la pompe à incendie, l'ambulance, et le colonel commandant la place, pâle comme un mort dans sa jeep.
Après quelques heures d'attente, on put nous procurer un nouvel avion, toujours militaire, un Léo 45, qui nous conduisit sans encombre au Maroc. Cependant le pilote atterrit par erreur à Port-Lyautey, alors que notre destination était Rabat, et que les officiels, mal informés par Alger, allaient nous attendre à Casablanca. J. M. Louvel, un peu las de ces péripéties aériennes, songeait à gagner Rabat en voiture. Mais le pilote, très vexé de sa méprise, tint à redécoller et à nous poser enfin à Rabat, où on nous attendait cette fois. J'ai déduit de ces aventures que la République était parfaitement inconsciente en confiant la personne de nos excellences à des pilotes militaires.
Pour le retour sur Alger, le général Juin, résident général au Maroc, et sur le pont d'être fait maréchal, mit à notre disposition son avion personnel, un confortable avion-salon. Le retour à Paris se fit par Air-France. Mais comme le voyage ne pouvait décidément pas se terminer dans le calme, l'avion dans le brouillard à Orly faillit se poser à côté de la piste, et dut reprendre à deux fois sa procédure d'atterrissage (L'atterrissage sans visibilité n'était pas encore parfaitement au point à cette époque).
Ma présence au cabinet s'accompagna, à l'automne 1951, d'une occupation d'un autre genre. En 1948, avait été créé l'Institut de hautes études de défense nationale. On demanda aux CDF de proposer la nomination d'un membre de leur état-major comme auditeur de l'Institut. Compte tenu de mon arrivée prochaine dans la maison, les CDF avancèrent mon nom, et c'est ainsi que je fus nommé auditeur dans la 4ème session, 1951-52, de l'Institut. L'activité y durait un an, à raison de trois séances d'une demi-journée par semaine, et d'un peu de travail personnel, ce qui restait compatible avec la vie professionnelle. Les auditeurs se partageaient entre officiers, fonctionnaires civils, et dirigeants ou cadres supérieurs d'entreprises, cette variété d'origines assurant des contacts intéressants. Ainsi dans ma session figurait Edgard Pisani, alors préfet de la Haute-Marne, futur ministre, avec qui j'eus par la suite plusieurs occasions de rencontre.
La tâche de l'Institut était d'initier un nombre suffisant de cadres civils et militaires aux problèmes de la défense, et réciproquement de fournir au gouvernement conseils et recommandations émanant de personnes exerçant des responsabilités de niveau national, et réfléchissant ensemble sur les problèmes d'actualité. L'activité se partageait entre conférences et réflexions en groupes sur des thèmes donnés au début de l'année. Ainsi à cette époque, j'eus à travailler sur les problèmes de la guerre froide, du blocus de Berlin, et sur la situation au Vietnam. Ma scolarité à l'Institut se prolongea quelques mois à mon arrivée aux CDF, puis se termina, au bout de l'année prévue, par ma promotion au grade de capitaine, ou plutôt de chef d'escadron, selon la terminologie de l'artillerie.
Premier passage aux CDF
J'entrai donc à ce moment-là, comme ingénieur en chef, aux CDF où R. Cadel me pressait de venir depuis un certain temps. Je devais prendre en charge les relations avec la CECA, pour lesquelles j'étais assez bien préparé, et créer un service économique qui n'existait pas aux CDF, alors qu'EDF par exemple disposait déjà d'un tel service fortement charpenté. Quelques mois après mon arrivée, le président E. Audibert et R. Cadel me firent part de leur intention de constituer en direction mes services encore à l'état naissant, et de me nommer directeur. A leur demande, je définis donc, sous l'intitulé de direction des études générales et du marché commun, les missions de la nouvelle direction.
Cette création déplut fortement à J. Thibault, un camarade de l'X beaucoup plus ancien que moi, qui dirigeait le service commercial et celui des industries de la houille, et qui comptait prendre sous sa coupe le secteur qui m'était confié, en me considérant seulement comme son adjoint. Je découvris alors ce qu'innocemment je n'avais pas soupçonné, que ma promotion aussi rapide au rang de directeur était effectivement destinée à faire barrage à J. Thibault, dont les ambitions dans la maison paraissaient trop envahissantes. Peu de temps après, l'intéressé, ayant lui-même compris qu'il n'était pas personna grata, quitta les CDF pour la Chambre syndicale de la sidérurgie.
Mais les hommes allaient beaucoup bouger dans la profession au cours des années suivantes. Dès l'automne 1952, R. Cadel quittait la direction des CDF pour prendre la présidence des HBNPC, où il ne resta qu'un an avant de revenir aux CDF comme président en 1953, à la mort d'E. Audibert. Il mourut lui-même en 1956, et fut remplacé par Alexandre Verret qui lui avait d'abord succédé aux HBNPC. C'était un fonctionnaire du ministère des affaires économiques, mais un vétérinaire d'origine. Il disait avec humour: "C'est curieux, je suis vétérinaire, et on m'a nommé président de houillères au moment où on remonte les derniers chevaux de mine". On était en effet aux derniers jours de la traction animale au fond.
Quand R. Cadel quitta la direction générale des CDF, il fut remplacé par P. Baseilhac, qui laissa la direction des HBNPC à Pierre Signard, mais emmena avec lui aux CDF J. Couture, comme directeur général adjoint. A ce titre, J. Couture coiffait les anciens services de J. Thibault et ma direction, ce que n'avait pu obtenir ce dernier. Je n'y voyais nul inconvénient, ayant de bonnes relations avec J. Couture.
Le traité de Paris, créant la CECA, avait été ratifié en décembre 1951, et les institutions de celle-ci mises en place en août 1952. Elles incluaient un comité consultatif, concernant les deux industries du charbon et de l'acier, et composé par tiers de représentants des producteurs, des travailleurs et des utilisateurs. Je fus rapidement nommé membre du comité, comme représentant des producteurs français de charbon. Les séances du comité, à Luxembourg, siège de la Haute Autorité, permettaient de rencontrer les membres étrangers, notamment les producteurs allemands de charbon. Ils soignaient ostensiblement leur réputation d'honorabilité. L'un d'eux put être élu comme premier président du comité, la présidence devant tourner chaque année entre les trois catégories de représentants.
Les délibérations du comité portaient sur les projets de décisions que la Haute Autorité devait prendre en application du traité. Les premières de ces décisions concernaient les conditions de concurrence et les modalités de formation des prix. Celles-ci interdisaient notamment les discriminations entre acheteurs, clause qui représenta un handicap pour le charbon dans sa concurrence avec les produits pétroliers; non soumis à de telles contraintes, et fut une des causes de la trop rapide expansion de ceux-ci.
La Haute Autorité devait, aux termes du traité, établir des programmes prévisionnels de production, de consommation et d'échanges extérieurs. Ces programmes, soumis au comité consultatif, donnaient lieu à des délibérations souvent ardues. La Haute Autorité pouvait procéder à des emprunts et consentir des prêts aux entreprises. Les producteurs allemands se heurtaient, dans les années suivant la guerre, à de sévères difficultés de financement de leurs investissements; ils étaient donc particulièrement demandeurs de tels prêts, dont les conditions étaient aussi examinées par le comité.
La mise en place du marché commun nécessitait, outre les délibérations du comité consultatif, des négociations directes avec les services de la Haute Autorité, qui m'amenaient à de fréquents déplacements à Luxembourg, où j'avais un représentant permanent. Un débat difficile porta sur le régime des charbons belges. Les mines belges, particuliérement peu productives, devaient bénéficier, pendant la période de transition de cinq ans, d'un système de péréquation à la charge des autres producteurs, pour leur permettre d'abaisser leurs prix de vente. Ce régime n'était évidemment pas favorable aux HBNPC, soumises directement à la concurrence du charbon wallon. Les discussions avec Luxembourg sur cette question furent particulièrement laborieuses.
Un autre sujet de débats, mais plus serein, concerna l'établissement des tarifs de transport européens. Tous les réseaux de chemin de fer pratiquaient des tarifs de transport de marchandises dégressifs en fonction de la distance. Mais avant l'établissement du marché commun, il y avait discontinuité tarifaire aux frontières, ce qui, pour une même distance, pénalisait les transports internationaux par rapport aux transports intérieurs de chaque pays. Sous l'impulsion du Français Roger Hutter, qui avait été chargé de la direction des transports à Luxembourg, des tarifs directs internationaux furent institués pour mettre un terme à cette discrimination.
Les producteurs de charbon européens éprouvèrent le besoin de s'associer, pour présenter un front commun dans les débats avec la Haute Autorité. Mais cela ne se fit pas sans hésitations initiales. La pupart des producteurs allemands et belges voulaient une association sous le signe de la libre entreprise, c'est à dire limitée aux entreprise privées, ce qui aurait écarté les CDF, et subsidiairement les mines d'Etat du Limbourg néerlandais. Heureusement R. Cadel avait dans les mines belges quelques anciennes relations, qui purent convaincre leurs collègues que les mineurs français, bien que nationalisés, n'avaient pas de couteau entre les dents, et que leurs préoccupations étaient tout à fait comparables à celles des mines privées des pays voisins. L'association regroupa donc, sous le nom de Comité d'études des producteurs de charbon d'Europe occidentale, CEPCEO, tous les producteurs de la CECA, sans que jamais, par la suite, le régime de propriété des entreprises cause le moindre problème. Le CEPCEO comportait, outre un comité central et diverses commisions, un bureau, dont j'étais le membre français, qui préparait les séances.
Un problème préoccupa assez vite les producteurs du CEPCEO. La Haute Autorité était habilitée à distribuer des aides à la recherche technique, mais elle devait financer ces aides, non par emprunt, comme le concours aux investissements, mais sur ses fonds budgétaires Or, contrairement à ce qui devait être ultérieurement le cas pour la CEE et l'Euratom, dont le budget est crédité de contributions des Etats, le budget de la CECA est alimenté par des prélèvements sur les entreprises productrices de charbon et d'acier. Toute initiative de la Haute Autorité en matière de financement de la recherche devait donc se traduire par une augmentation du prélèvement. Les producteurs, considérant qu'on les invitait à financer sur leurs propres deniers les "cadeaux" envisagés par la Haute Autorité, convinrent de boycotter les offres d'aide à la recherche. Ils ne purent tenir sur cette position, car il y eut naturellement quelques lacunes dans le boycott, et des demandes émanant d'autres chercheurs, notamment dans le monde universitaire. Changeant leurs batteries, les producteurs décidèrent de présenter des demandes, mais de les étudier et de les coordonner entre eux avant leur présentation, ce qui leur donnait l'assurance d'un ensemble de recherches cohérent et admis par tous les bénéficiaires de l'aide.
Le CEPCEO manifesta donc son utilité pour la concertation des producteurs. Mais il organisait aussi quelques activités plus aimables. Une fois par an, à l'occasion de l'assemblée plénière, l'association invitait ses membres, accompagnés de leurs épouses, à une réunion dans un site touristique de la communauté, successivement dans chacun de ses pays. La réunion était assortie d'une excursion de la journée dans la région et d'une soirée dansante. C'est ainsi que pendant cette première période, des réunions eurent lieu à Bad Bertrich sur la Moselle, à Tours, à Bruges et à La Haye. Nous regrettions seulement que l'Italie n'ait pas de mines de charbon, et qu'aucune réunion n'ait lieu dans ce beau pays.
Le service économique des CDF, que je constituai dans le même temps était fort léger au départ, puisque je ne disposais que d'un adjoint, Michel Toromanoff qui partit bientôt à GDF, puis Jacques Lesourne, qui devait lui-même quitter ensuite les CDF pour fonder, dans l'orbite de Paribas, la société d'économie et de mathématiques appliquées, la SEMA, puis se faire connaître par diverses activités pédagogiques et littéraires.
La première activité du service était de suivre la conjoncture charbonnière et de préparer les réactions des CDF. L'année 1951 avait été marquée par la conjoncture dite coréenne, consécutive au déclanchement de la guerre de Corée. Les besoins d'acier, et partant de coke, étaient très élevés. Je me rappelle un sidérurgiste me disant d'un air faussement naïf: "On n'a peut-être pas tout à fait tort de nous appeler marchands de canons". Mais dès 1952 les besoins en charbon faiblissaient. Pourtant les CDF étaient encore encouragés à maintenir, voire à accroître leur production, quitte à ce que soient réduites les importations élevées des dernières années. Dans le cadre européen, J. Monnet, généralement mieux inspiré, proposait d'accroître de 30 Mt la production de la CECA, pour se substituer aux importations de charbon américain, encore plus cher que les charbons européens, mais plus pour longtemps.
Les années 1953 à 1955 furent marquées par un succession d'hivers doux et une forte hydraulicité, réduisant les besoins en charbon des foyers domestiques et d'EDF. La SNCF décida un programme d'électrification et de dieselisation, qui devait progressivement supprimer tout recours au charbon. Le gaz naturel commençait sa percée, diminuant les besoins en charbon de GDF. Enfin on assistait à une forte poussée des importations et de la consommation de produits pétroliiers.
Les CDF réagirent. Sous leur pression, le gouvernement réduisit les importations de charbon, et institua en 1954 une taxe sur le fuel lourd. En 1955, il intervint auprès d'EDF et de la SNCF, pour freiner leur accroissement de consommation de fuel. Il provoqua une négociation entre les CDF et la Chambre syndicale des producteurs pétroliers, pour obtenir de celle-ci une limitation volontaire des ventes de fuel léger aux foyers domestiques. Chargé de négocier pour les CDF, j'obtins un engagement de limitation, que le conseil d'administation des CDF trouva insuffisant, mais dont nous aurons néanmoins beaucoup de mal à obtenir le respect les années suivantes.
Parallèlement à ces mesures, le gouvernement demanda aux CDF d'étudier la réduction des productions les plus déficitaires, principalement dans les mines du centre et du midi. Malheureusement, en 1956, la conjonction d'un hiver particuliérement rigoureux et d'une pénurie pétrolière aussi soudaine que peu durable, née de la crise de Suez, inspira aux responsables la crainte d'une pénurie générale de combustibles, et un regain d'optimisme parfaitement artificiel quant aux perspectives du charbon. Les importations remontèrent fortement. Par malchance, les négociations franco-allemandes sur le retour de la la Sarre à l'espace allemand arrivaient à leur conclusion. Les négociateurs français, malgré les expresses réserves des CDF, crurent réaliser une bonne affaire en obtenant la garantie de fourniture pendant 25 ans, assortie de l'obligation d'enlèvement, du tiers de la production des mines sarroises. Ce malheureux tiers sarrois devait représenter un poids très lourd sur notre marché pendant la plus grande partie des années suivantes.
Le gouvernement créa un établissement public, COVESAR, pour gérer l'écoulement du tiers sarrois, dont une partie importante dut souvent être stockée. Le conseil était présidé par Jean Picard, président de l'ATIC, organisme qui avait eu le monopole de l'importation du charbon en France jusqu'à la création de la CECA, et qui conservait ce monopole pour les charbons des pays tiers. Je siégeais au conseil de COVESAR, comme représentant de CDF, et m'efforçai de limiter au mieux les dégâts causés par le charbon sarrois sur notre marché, dès que celui-ci faiblissait
A peu près dans le même temps, les sidérurgistes français décidèrent d'acquérir une mine de charbon à coke dans la Ruhr, pour consolider leur approvisionnement en coke. Ils demandèrent aux CDF de participer à l'opération, ce que ceux-ci acceptèrent, avec l'accord du gouvernement. C'était pour eux un moyen supplémentaire de participer au contrôle des importations de charbon. Le choix se porta sur la Harpener Bergbau, appartenant au groupe Flick, un des plus puissants de la Ruhr, après le groupe Krupp. La sidérurgie et les CDF devinrent actionnaires majoritaires de Harpen et créèrent en France une société, SIDECHAR, pour gérer en commun leur participation dans cette mine allemande. Je devins aussi administrateur de SIDECHAR.
Les hivers qui suivirent l'année 1956 furent doux. L'hydraulicité se renforça vite. Les importations de produits pétroliers remontèrent rapidement La poussée du gaz naturel s'accentua, à la suite du rapide développement du gisement de Lacq. Je fus amené à participer à un groupe de travail, présidé par Bouteville, ancienne personnalité de l'industrie électrique, chargé d'étudier les zones d'écoulement souhaitables de ce gaz hors de la région productrice elle-même. Je pus obtenir que cet écoulement ne soit pas limité à la région de St Etienne, comme cela avait d'abord été imaginé au grand dam des Houillères du bassin de la Loire, mais soit étendu jusqu'à la région parisienne.
Dès 1958, il devint impossible de se dissimuler que la crise charbonnière en Europe n'était plus conjoncturelle, mais structurelle. Le gouvernement français demanda aux CDF l'étude d'une réduction de production de 10%. C'était le début d'une régression, lente au départ, qui devait se poursuiivre les décennies suivantes, et qui provoqua dans la profession minière de profonds remous sociaux. J'étais membre de la comission de l'énergie au Plan, et je m'efforçais de défendre au mieux les positions du charbon, surtout la nécessité d'étaler dans le temps cet inévitable recul.
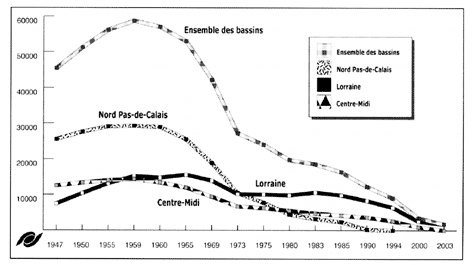
En dehors des problèmes de marché, le service économique s'intéressait à l'étude de rentabilité des investissements, et aux perspectives économiques des exploitations. Pour les calculs de rentabilité, les Houillères n'avaient jusqu'ici appliqué que la méthode simpliste consistant à déterminer le ratio des recettes escomptées, diminuées des dépenses d'exploitation, au montant des investissements. Cette méthode ne convient plus dès que les investissements s'étalent sur une longue période, et que les recettes et les dépenses prévues ne sont pas régulières dans le temps. J'ai donc introduit la méthode d'actualisation des recettes et des dépenses, que j'avais apprise par les travaux de J. Desrousseaux. Cette méthode permet de calculer, pour un taux d'intérêt donné, le revenu global actualisé, ou de déterminer le taux de rentabilité, c'est à dire le taux d'intérêt pour lequel le revenu actualisé s'annule.
Sous l'impulsion de J. Lesourne, nous avons aussi développé les applications de la recherche opérationnelle. Cette méthodologie nouvelle, hermétique aux non-initiés, avait reçu la définition d'un humoriste: "La recherche opérationnelle, c'est ce dont s'occupent les chercheurs opérationnels." Les critiques, quant à eux, accusaient ces chercheurs de prétendre traiter par les mathématiques tous les problèmes de gestion des entreprises. En réalité, la recherche opérationnelle, apparue au Pentagone pendant la guerre, se proposait plus modestement de résoudre certains problèmes spécifiques par des méthodes scientifiques appropriées. Par exemple:
Les sessions de la Conférence sont toujours suivies de voyages postcongrès, mi-professionnels, mi-touristiques. Après la session de Rio, j'ai pu participer à l'un de ces voyages, qui me conduisit à Salvador ou Bahia-de-tous-les- saints, et à Saô Paulo. Deux ans après, j'ai assisté à une nouvelle session de la Conférence à Vienne, ville réputée pour les congrès, suivie d'un voyage à travers l'Autriche. Depuis, j'ai participé souvent aux sessions de la Conférence à travers le monde.
Dans le courant de 1957, j'avais participé avec le conseil d'administration des HBL, à un déplacement dans le midi, pour visiter notamment une colonie de vacances sanitaire que ces Houillères géraient à Cannes. J'y ai rencontré une jeune architecte, Janine Robert, qui avait dû interrompre précipitamment un séjour à Harvard en 1954, à la suite du décès accidentel de son père, et reprendre à l'improviste l'agence d'architecture de celui-ci à Cannes. Elle fut ainsi conduite, entre autres, à s'occuper de la colonie de vacances que nous visitions. Nous nous sommes revus depuis, avec un plaisir croissant...et le 28 juin 1958, nous nous sommes mariés à Cannes en l'église du Suquet, entourés d'une riche assistance familiale et amicale, y compris de fidèles amis parisiens qui avaient fait l'effort de venir jusque là, et d'une fanfare de collègues de Janine, saluant la sortie de l'église sur l'air du casque de pompier. Nous avons fait notre voyage de noces en Scandinavie, Suède et Finlande, puis avons regagné Paris, mais plus pour longtemps.
Les Houillères du Bassin de Lorraine
Les HBL étaient donc dirigées par P. Signard, et avaient pour président un ingénieur, Olaf Lecarpentier, qui quitta ce poste peu après. Le nouveau président fut Louis Armand qui, après avoir dirigé la SNCF, avait pris la présidence d'Euratom, mais n'y était pas resté longtemps, n'appréciant pas la machinerie administrative mise en place dans ce nouvel organisme. L. Armand, malheureusement trop tôt décédé depuis lors, était un personnage fascinant par sa culture, sa clarté d'exposition et son humour. Quand on avait la chance de voyager avec lui de Lorraine à Paris, on ne s'ennuyait pas.
Nous avons donc, Janine et moi, quitté Paris au début de l'automne 1958, pour aller nous installer en Lorraine. Après de courtes investigations, nous avons occupé une maison à Freyming, au centre du bassin, où nous avons pu emménager après quelques semaines de travaux et d'ameublement. Je disposais, comme tous les directeurs, d'une voiture de fonction et d'un chauffeur et, comme tous les ingénieurs, d'un jardinier. La maison était entourée d'un jardin, d'agrément dans son voisinage immédiat, mais potager sur sa plus grande partie.
Au moment de la création des HBL, le bassin comportait trois compagnies: Sarre et Moselle, Petite Bosselle et Faulquemont, qui furent transformées en groupes d'exploitation du nouvel établissement public. Il n'y avait pas de locaux de la direction générale, et pour cause; un immeuble pour celle-ci ne fut construit que plusieurs années après. La direction générale était donc installée provisoirement dans les bureaux du puits V de Merlebach, au groupe de Sarre et Moselle. C'esl là qu'un bureau me fut attribué, près de notre logement, puisque les communes de Freyming et de Merlebach étaient contigües, et avaient même été fusionnées un temps, pendant l'occupation allemande.
Quatre services entrèrent dans la direction des études générales et des services financiers, qui m'était attribuée: la comptabilité, le contrôle de gestion, la mécanographie et le service économique. Janine, de son côté, n'avait pas été oubliée. P. Signard, avec psychologie, avait rapidement pensé que s'il voulait me fixer suffisamment dans le bassin, il ne fallait pas qu'elle s'y ennuie. Il lui confia donc, sur contrat, une mission d'architecture, en collaboration avec l'architecte des HBL, Henri Hanotaux. Cette mission lui permettait de participer aux constructions en cours dans le bassin, les cités destinées à accueillir les effectifs croissants de mineurs, et plus spécialement les immeubles à destination sociale.
Peu de temps après notre arrivée, le bassin fut malheureusement endeuillé par un très grave accident dans le puits Ste Fontaine, une explosion de grisou, le 29 mai 1959, qui fit 26 victimes et de nombreux blessés. En de pareilles circonstances, les services hospitaliers spécialisés de la région sont vite débordés, et cela me donna l'occasion d'apprécier le concours de la colonne de secours des CDF, dirigée par le docteur Zimmer, une alsacienne aussi aimable que compétente, que je devais retrouver plus tard comme médecin des CDF, en bénéficiant à plusieurs reprises de ses soins.
Les tristes circonstances de la catastrophe de Ste Fontaine ne connurent qu'un épisode plus distrayant. La direction générale des HBL reçut, parmi beaucoup d'autres, un télégramme de condoléances d'une certaine Jeanne Ney, qui plongea les réceptionnaires dans la perplexité. Il s'agissait en fait de Jean-Marcel Jeanneney, alors ministre de l'industrie. Les HBL devaient malheureusement connaître, le 1er août 1961, une autre catastrophe, un énorme éboulement en taille qui fit neuf victimes.
L'évolution économique du bassin, après mon arrivée, ne fut pas très favorable. L'année 1959 se présenta assez bien, avec une exercice presque équilibré financièrement. Le développement de la chimie représentait une donnée positive. Les HBL fabriquaient de l'ammoniac depuis 1954. L'année 1959 vit le lancement de productions d'acétylène et de styrène, qui devaient permettre la fabrication de matières plastiques. Mais dès 1960, les difficultés d'écoulement et le déficit commencèrent à croître. En juin 1960, le plan Jeanneney imposait aux CDF une baisse de la production nationale de 59 Mt en 1959 à 53 Mt en 1965. La production des HBL, bassin le plus productif, n'était pas appelée à diminuer, mais toute progression était stoppée. La démoralisation de la population minière fut d'autant plus grande qu'elle vivait toujours dans l'état d'esprit de la bataille du charbon, pas encore si lointaine, et de la pénurie de l'année 1956. Seuls les ingénieurs, et encore pas tous, avaient réalisé le début de déclin du charbon. Il en résulta un vif ressentiment, non seulement contre le gouvernement, mais contre les CDF, soupçonnés de mal défendre les intérêts de la profession.
Par mesure d'économie, la direction générale décida en 1962 la supression de la structure de groupes. Une direction de la production devait coiffer tous les sièges d'exploitation. Cette petite révolution ne se fit pas sans mal. L'état d'esprit des anciennes compagnies s'était conservé dans les groupes, assorti de méfiances et jalousies réciproques. Le directeur du groupe de Sarre et Moselle, Jean Carrier, partait en retraite. Mais celui de Petite Rosselle, André Puyte, était le plus difficile à maîtriser pour P. Signard, qui disait de lui avec humour: "Nous avons notre duc de Bourgogne". Son intégration à la direction générale suscita quelques remous.
Peu après, la direction générale dut d'ailleurs libérer les bureaux de Merlebach, lancer la construction d'un immeuble réellement destiné à son implantation, et s'installer, provisoirement une fois de plus, dans les bureaux de l'ancienne direction de Faulquemont. Pour moi, et pour beaucoup de cadres, cela représentait des temps de déplacement importants, quatre fois par jour, Faulquemont étant distant de Freyming de 20 km, souvent difficiles l'hiver.
Les services dont j'avais la charge ne soulevaient de problèmes que par les innovations dont ils étaient l'objet. En comptabilité, quelques problèmes nouveaux davaient trouver leur mode de traitement, par exemple les indemnités de dommages de guerre, qui arrivaient tardivement. Les responsables du service comptable se félicitaient, me disaient-ils, d'avoir un patron qui comprenne quelque chose à la comptabilité. Leur exigence était modeste, car si j'avais bénéficié, à l'école, d'un embryon de cours de comptabilité, je n'étais vraiment pas un expert.
Le service de contrôle de gestion était une création récente, consécutive à la mise en place de la direction générale du bassin. Il s'agissait principalement d'élaborer, en liaison avec les services gestionnaires, des prévisions de résultats, et d'analyser les écarts entre prévisions et réalisations. Les ingénieurs qui procédaient à ces analyses ne manquaient pas d'émettre, à l'occasion, quelques commentaires critiques à l'égard des gestionnaires. Ces derniers, peu habitués à ce type de surveillance, réagissaient contre ce qu'ils considéraient comme une immixtion insupportable dans leur gestion. A l'occasion d'une friction un peu plus forte que d'habitude, P. Signard, prenant leur partie, menaça même de supprimer le service de contrôle de gestion, et je dus modérer un peu l'ardeur de mes contrôleurs.
La mécanographie portait encore ce nom, bien que son équipement fût en passe de devenir beaucoup plus électronique que mécanique, et son intitulé d être converti en service de l'informatique. Les ordinateurs modernes faisaient leur apparition, même s'ils présentaient encore un matériel lourd et encombrant au regard de leur évolution future. J'avais eu la chance pendant mon séjour à Lyon, d'être initié à la mécanographie de type ancien, fondée sur un traitement mécanique de cartes perforées. Je connaissais donc un peu les principes, sinon les nouveaux équipements, et me trouvais relativement à l'aise avec les cadres chargés de les mettre en oeuvre, qui étaient fatalement presque aussi novices que moi. A l'occasion d'une visite du conseil d'administration, j'eus le privilège de faire un exposé d'initiation devant le conseil, et notamment L. Armand, auditeur attentif et curieux comme à son habitude.
Le service économique procédait à différentes études, à la demande du directeur général. La plus importante concernait les perspectives économiques des différents sièges d'exploitation du bassin. Ce fut pour moi la principale occasion d'utiliser la programmation linéaire, que ne connaissaient pas mes collaborateurs de Lorraine. Cette étude montra les perspectives douteuses du siège de Faulquemont, dont l'arrêt inévitable devait provoquer, mais longtemps après, de graves secousses sociales dans le bassin.
Je procédai aussi à des études de marché, ce qui provoqua un accrochage avec le directeur du service commercial des CDF, Yves Bertrand, avec qui j'avais pourtant des relations cordiales, mais qui prétendait garder le monopole des études de marché de la profession. Je finis par lui demander par écrit si les études de marché étaient un si maigre champ qu'il ne puisse être exploré qu'en un seul point dans la profession. Plus sérieusement, les problèmes de marché des HBL, à cette époque, étaient surtout relatifs à la sidérurgie. Le bassin développait ses cokeries, et devait donc trouver un débouché pour son coke dans les hauts-fourneaux lorrains. L'industrie sidérurgique avait malheureusement tendance à considérer que les contrats de longue durée d'achat de coke lui donnaient des droits à fourniture en période de tension du marché, mais ne lui créaient guère d'obligation d'enlèvement lorsque le marché était déprimé. Un de ses dirigeants, Léon Bureau, qui participait souvent aux négociations, traduisait abruptement cette attitude en répétant: "On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif".
Ayant participé à une étude sur l'extension de l'hôpital des Houillères à Freyming, je fus chargé d'aller plaider auprès de Simone Veil, alors ministre des affaires sociales et de la santé, la nécessité d'une subvention de l'Etat. Je m'attendais à ce qu'elle m'oppose l'insuffisance de ses crédits. Mais elle se contenta de me dire: "Monsieur, votre dossier n'est pas en ordre". Je le savais parfaitement. Mon dossier n'aurait pu être vraiment en ordre qu'après la publication, qui se faisait attendre, de certains des décrets d'application de la récente loi hospitalière. Mais j'admirais que le ministre (ou la ministre!) ait immédiatement mis le doigt sur certains points du dossier, qui paraissaient avoir échappé à ses services et à son cabinet.
J'allais de temps en temps à Nancy faire des conférences aux élèves de l'Ecole des mines de Nancy, alors dirigée par mon camarade Bertrand Schwartz. J'allais surtout deux fois par mois à Paris pour des réunions de conseils, et les réunions professionnelles des CDF. Janine m'accompagnait, et nous avions vite trouvé commode d'acquérir un petit pied-à-terre, Avenue Bugeaud. Le logement était encore difficile dans Paris, et l'administration était en quête de logements vacants. C'est ainsi que notre petit appartement, considéré comme peu occupé, ce qui se remarquait facilement, car il était au rez-de chaussée, fit l'objet d'un préavis de réquisition. L'intervention du sevice du contentieux des CDF nous permit d'échapper à cette menace, mais non à l'imposition d'une taxe sur les logements insuffisamment occupés.
J'avais aussi conservé mes mandats d'administrateur en Algérie. Je m'y rendais donc de temps à autre, ce qui me permit de suivre les derniers moments de la présence française, et d'observer le peu de clairvoyance des colons français. Ils n'étaient d'aileurs pas seuls dans ce cas. Les Houillères du sud-oranais perdaient beaucoup d'argent dans la mine de Kenadza. Peu de temps avant la négociation des accords d'Evian, le conseil d'administration apprit brusquement que le gouvernement en avait décidé la fermeture. La décision nous stupéfia par le choix du moment. Dans la période troublée précédant l'indépendance algérienne, la zone de Colomb-Béchar, avec l'emploi d'une main d'oeuvre nombreuse dans cette mine, représentait un verrou indispensable près de la frontière marocaine. Tous les administrateurs représentant l'Etat, y compris le représentant du ministre des finances, pourtant particulièrement intéressé à la disparition de ce puits à déficit, allèrent trouver Gaston Palewski, ministre chargé de l'Algérie, pour lui exposer avec force l'inopportunité de la décision dans les circonstances du moment. "Messieurs, répondit le ministre, ou bien la France reste en Algérie, et le plus tôt cette mine sera fermée, mieux cela vaudra...ou bien... Mais non, le gouvernement ne veut pas envisager d'autre hypothèse". Par chance le temps manqua pour exécuter la décision.
En 1962, la conférence mondiale de l'énergie se réunit à Melbourne, en Australie. P. Signard accepta de m'y envoyer, et Janine m'accompagna. Nous avons découvert le terrible complexe d'insularité des Australiens. Dans un escale à Darwin, au nord de l'ile, notre petit groupe de congressistes présents dans l'avion eut la surprise d'être accueilli à l'aéroport par une délégation d'ingénieurs. Ils avaient localement si peu de distractions qu'ils n'avaient pas voulu manquer ce passage, bien que ce fût au milieu de la nuit. La plupart des Australiens, même des classes aisées, ne faisaient à l'époque qu'un grand voyage dans leur vie, en Europe ou en Amérique.
Au début de 1963, J. Couture, alors président des HBNPC, préparant le départ de Jean Aurel, directeur général de ce bassin, qui devait prendre sa retraite à la fin de l'année, me demanda de venir assurer la succession, ce que j'acceptai. C'était donc, après un crochet d'une quinzaine d'années, le retour dans rétablissement qui avait souhaité m'accueillir au début de ma carrière minière. Il fut convenu que je rejoindrais Douai, siège des HBNPC, au milieu de l'année. Mais dans l'intervalle devait se produire une des crises les plus graves de la profession.
Les salaires des mineurs n'avaient bénéficié, au cours des années précédentes, que d'une revalorisation insuffisante au regard de l'évolution salariale générale.. Au début de 1963, le mécontentement grandit. Le besoin en charbon se faisait de nouveau sentir temporairement, l'hiver étant particulièrement rigoureux. Les circonstances étaient favorables à l'expression de ce mécontentement.
La grève commença le 1er mars. Le général de Gaulle, craignant une aggravation de la pénurie, et mal conseillé, signa un décret portant réquisition des mineurs. Cette mesure était applicable à partir du 4 mars. C'était un jour de repos pour les HBNPC et plusieurs des Houillères du Centre-Midi. La réponse au décret de réquisition reposait donc essentiellement sur les Lorrains, réputés disciplinés et généralement assez gaullistes. La date n'avait donc pas été choisie innocemment. Mais le personnel des HBL jugea qu'il y avait provocation et, depuis les ouvriers jusqu'aux ingénieurs, refusa d'obéir à la réquisition. A partir de là, la grève devint générale dans l'ensemble des bassins, et illimitée.
Le gouvernement dut abroger le décret de réquisition; mais le travail ne reprit que que le 4 avril, après de longues et laborieuses négociations. La CFTC, principal instigateur du conflit, pour la première fois de son histoire, eut le tort d'en faire un peu trop traîner le dénouement, sans profit appréciable de ces prolongations pour les mineurs. Ceux-ci avaient néanmoins obtenu une augmentation des salaires de 11% en deux étapes, après évaluation du retard de la profession par un comité de sages présidé par Pierre Massé, à cette époque commissaire général du Plan. Une table ronde fut instituée, pour débattre des problèmes de la profession, et un secrétariat général à l'énergie créé auprès du ministre de l'industrie.
Mais la colère du général, convaincu qu'il avait été induit en erreur par les dirigeants de la profession, se manifesta par la décision de limoger tous les directeurs généraux. A vrai dire, cette décision, qui aurait pu être spectaculaire à un tout autre moment, n'eut qu'un effet très réduit. Il se trouvait que P. Baseilhac avait annoncé peu avant au ministre de l'industrie son intention de renoncer à ses fonctions, pour prendre la présidence de la société sidérurgique Châtillon-Commentry. J. Couture était pressenti pour diriger le secrétariat général de l'énergie, nouvellement créé. J. Aurel prenait sa retraite. Quant aux directeurs généraux des Houillères du Centre-Midi, c'était trop petit calibre pour que la vindicte du général puisse descendre jusqu'à eux. La seule victime fut donc P. Signard, directeur général des HBL. Je lui proposai une manifestation de solidarité, mais il la récusa. On l'avait pressenti pour la présidence du Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, et celle de Sofrémines, filiale des CDF, créée pour l'exportation de l'ingénierie minière française. Il ne souhaitait pas que son départ des HBL fasse des remous.
Ainsi se termina un des plus durs conflits de l'industrie charbonnière nationalisée. Jean Lorimy, directeur des services techniques et sociaux aux CDF, devint directeur général des HBL. Il fallait trouver un successeur à P. Baseilhac à la direction générale des CDF. Bien qu'il fût toujours convenu que je prenne la place de J. Aurel aux HBNPC, certains me pressaient de briguer plutôt cette succession. Mais je préférais dans l'immédiat faire l'expérience de la direction d'un Bassin, et la direction des CDF fut finalement confiée à Jean-Claude Achille, un camarade de corps qui, à l'arrondissement minéralogique de Lille, puis dans divers cabinets de ministres de l'industrie, avait acquis une bonne connaissance de la profesion minière.
Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais
Le deuxième semestre 1963 était pour moi une période préparatoire. Je ne devais être nommé directeur général qu'au 1er janvier 1964, et en attendant, je renouais connaissance avec le bassin, ses installations et ses hommes. Je visitais les six groupes d'exploitation et leurs dirigeants. J'assistais à la plupart des réunions et réceptions que tenait encore J. Aurel. Quant à Janine, elle souhaitait une activité analogue à celle qu'elle avait eue en Lorraine. Cela soulevait un problème délicat. Car je ne me voyais pas lui souscrire un contrat, sous ma signature de directeur général. P. Baseilhac, encore directeur général des CDF, tourna la difficulté et m'offrit gentiment de passer le contrat au nom des CDF. Cela devait permettre à Janine de travailler avec Stanislas Tugendresh, architecte des HBNPC, d'ailleurs une relation amicale, sur les immeubles sociaux du bassin, et aussi d'être l'architecte de la future maison de direction générale, dont la construction fut entreprise, et dont nous devions être les premiers occupants.
Au 1er janvier 1964, j'ai été investi, comme convenu, de la direction générale des HBNPC. Un de premiers problèmes qui se posa à moi fut la mise en place de mes collaborateurs directs. Jean Dupont, directeur général adjoint, après avoir dirigé les Houillères d'Aquitaine, coiffait le service commercial et les industries de la houille. Il tenait parfaitement son rôle. Mais le deuxième directeur général adjoint, Maurice Mangez, qui supervisait l'activité minière et les services du personnel, devait prendre sa retraite six mois après J. Aurel, et je devais donc immédiatement lui trouver un successeur. Après un tour d'horizon des dirigeants du bassin, mon choix se porta sur Pierre Verrier, jusque là directeur du groupe d'Hénin-Liétard. Ce choix ne souleva de réticence que chez Norbert Bernard, directeur du groupe de Douai, qui aurait volontiers brigué cette fonction. Le problème fut résolu par les CDF qui appelèrent N. Bernard à la succession de J. Dumay, comme directeur général des services techniques de l'établissement.
A la direction générale se trouvait également un directeur des services techniques de la houille, Jean Aubery, qui aurait pu, lui aussi, avoir des visées sur la succession de M. Mangez. Modestement il n'en fit rien, et il ne présentait d'ailleurs pas toutes les caractéristiques voulues pour ce poste. Mais son maintien auprès de P. Verrier, qui visiblement s'occuperait des problèmes techniques miniers de plus près que M. Mangez, ne paraissait pas non plus indiqué. Après consultation des CDF, je fus en mesure de lui proposer la direction générale des Houillères du Dauphiné. Cela semblait un peu un exil, mais le titre de directeur général était une compensation. Je connaissais depuis longtemps J. Aubery, un camarade de l'X, que j'avais déjà rencontré au cours de mon séjour à St Etienne. Je pus donc négocier à l'amiable cette mutation. Après acceptation, l'intéressé me demanda, avec un peu d'hésitation dans la voix: "J'espère que nous pourrons conserver nos relations amicales". Cette demande me toucha, car, après tout, c'est lui qui aurait pu m'en vouloir. J. Aubery fut remplacé à Douai par Albert Proust, en provenance du groupe de Lens, qui fit une excellente équipe avec P. Verrier.
Le poste de secrétaire général demandait aussi mon attention. Ce poste se trouvant vacant, J. Aurel avait fait venir d'Auchel un ingénieur, Paul Mudry, dont il avait apprécié le comportement dans une situation difficile. Il l'avait nommé secrétaire général juste avant de quitter ses fonctions, sans me consulter, alors que j'étais déjà depuis plusieurs mois dans le bassin, et m'apprêtais à prendre sa succession. Je n'avais pas beaucoup apprécié. Le secrétariat général présente une importance très variable suivant les entreprises, et même suivant les périodes dans une même entreprise. Aux HBNPC, au moment où se posait la question, ce n'était pas un poste de premier plan. Je convoquai P. Mudry, et lui fis part de mes doutes sur le bien-fondé de sa nomination. Il crut d'abord que j'avais en vue un autre choix pour ce poste. Je le détrompai, mais lui expliquai que s'il restait trop longtemps dans ces fonctions, ce ne serait sans doute pas le mieux pour la suite de sa carrière. Il comprit très bien, et au bout d'un délai convenable, il sollicita et obtint un poste de directeur dans un groupe, et poursuivit une carrière qu'il termina plus tard comme directeur général de l'entreprise.
Le départ de leurs groupes de P. Verrier et de N. Bernard, quelques départs à la retraite d'autres dirigeants qui se préparaient, me conduisirent à un petit jeu de taquin, pour doter à nouveau chaque groupe du directeur délégué et du directeur des travaux du fond appropriés. J. Couture devait apprécier les conditions dans lesquelles se firent ces mouvements, car il déclara aux CDF: "Je ne sais pas comment fait Gardent, mais il fait valser tout le monde, et tout le monde semble content". Je fus sensible à ce diagnostic.
J'avais un autre problème à régler, dans le cadre des relations avec les organisations syndicales. Depuis les grèves de 1947 et 1948, un ostracisme régnait contre la CGT, taxée de comportement délictueux et inadmissible pendant ces grèves, et ses représentants n'étaient plus jamais convoqués aux réunions de concertation à la direction générale. Je pensais, comme d'ailleurs la plupart des cadres du bassin, que cette mise au ban avait assez duré, et je les convoquai un jour sans crier gare. J'avais par les Renseignements généraux de la préfecture des informations sur les débats internes de l'organisation, et je sus qu'ils étaient surpris et décontenancés par cette invitation, sans penser toutefois pouvoir la décliner. Je leur expliquai qu'il était temps de tirer un trait sur le passé, et que je me proposais, alors qu'ils étaient à l'index depuis quinze ans, de les inviter dorénavant avec les autres syndicats, et de prendre en considération leurs avis comme les autres. Ils s'attendaient à ce que j'exige des contreparties. J'exprimai seulement le souhait, sans en faire d'ailleurs une condition, qu'ils cessent de mettre en cause la responsabilité des dirigeants des Houillères, ou même de les traiter d'assassins dans leur journal La Tribune, à l'occasion de chaque accident grave. Une certaine modération dans l'expression fut en effet obtenue par la suite.
Je souhaitais développer au maximum la concertation dans l'énorme ensemble qu'étaient les HBNPC. Je procédais à des réunions régulières, une fois par semaine des principaux cadres de la direction générale, une fois par mois des dirigeants des groupes d'exploitation. Une fois par mois également, je passais une journée dans un groupe, avec descente de mine ou visite d' une installation de surface le matin, déjeuner et discussion avec les cadres du groupe l'après-midi. Au bout de quelque temps, à mon amusement, P. Verrier et A. Proust eurent peur que les directions de groupes en profitent pour m'en faire accroîre sur des sujets que je maîtrisais moins bien qu'eux, et souhaitèrent que l'un des deux m'accompagne dans ces visites, ce que j'acceptai volontiers.
Il fallait redéfinir la stratégie de l'établissement, et réorienter ses objectifs. La production de houille du bassin, qui avait approché 30 Mt en 1952 et 1959, était condamnée, dans le contexte de la crise charbonnière, à un déclin d'autant plus rapide que ses performances techniques, au regard des moyennes de la profession, étaient particulièrement modestes, et ce qui restait de son gisement de plus en plus difficile à exploiter. Les ingénieurs du bassin étaient mal préparés à ce déclin. La fermeture d'un premier siège important, le 11 de Béthune, venait d'être décidée lorsque je pris en charge les HBNPC. Je dus me rendre à la direction du groupe de Béthune, et réunir tous les ingénieurs du groupe pour leur expliquer la situation, et les convaincre de la nécessité de fermer ce siège. J'étais aussi, sur cette décision, l'objet de violentes attaques de la fédération CGT du sous-sol, au niveau parisien. A sa demande, j'invitai son secrétaire général, Achille Blondeau, à venir voir avec moi les plans du gisement du siège. Il dut se convaincre, même s'il ne l'avoua pas explicitement, qu'il ne restait plus que des lambeaux de gisement, pratiquement inexploitables.
Mais ce n'était qu'un coup d'envoi. Les fermetures de sièges se succédèrent tristement. La production de charbon, après son maximum proche de 30 Mt, et son niveau de 27 Mt en 1962, tomba à moins de 20 Mt en 1968, quand je quittai le bassin. On ne prévoyait plus que 13Mt en 1975, et la régression fut en fait plus rapide encore, puisque cette année-là on ne produisit guère plus de 8 Mt.
Les effectifs tombèrent de leur côté de 113 000 en 1963 à 83 000 en 1968, et devaient être voisins de 40 000 en 1975. Malgré ce déclin, l'embauche restait difficile, surtout pour les ouvriers productifs du fond, c'est à dire ceux qui travaillaient dans les chantiers d'abatage du charbon. La période du chômage n'était pas encore en vue. L'emploi était facile à trouver, et le pénible et dangereux métier de mineur n'attirait pas beaucoup, bien que la tradition minière fût encore fortement implantée dans les corons. Les HBNPC durent avoir recours à des ouvriers marocains immigrés, embauchés sur contrat de deux ou trois ans, renouvelés éventuellement une fois, après quoi les intéressés retournaient à leur douar d'origine, en se faisant remplacer aux Houillères par un frère ou un cousin. Le pécule qu'ils avaient accumulé leur permettaient d'acquérir femmes, moutons et oliviers, et surtout de se construire des maisonnettes pimpantes, comme je pus le constater quelques années plus tard, à l'occasion d'un voyage au Maroc où je me rendis dans la région de Goulimine notre principale zone de recrutement.
Le bassin du Nord Pas-de-Calais, plus encore que les autres houillères, dut faire face au problème de la silicose. Dès 1945, le bassin avait abandonné la foration à sec dans les roches siliceuses, ce qui avait porté remède aux formes les plus pernicieuses de la maladie. Mais les poussières de charbon, elles mêmes plus ou moins chargées de silice, engendraient une forme de maladie à évolution plus lente, la pneumoconiose du mineur, qui continuait à faire des ravages. Le bassin, depuis1960, s'était attaqué énergiquement au problème, d'abord en mettant en oeuvre des techniques de mesure, le comptage d'échantillons recueillis sur filtres, puis en développant l'infusion d'eau dans les massifs de charbon. En 1970, l'incidence de la maladie, c'est à dire le nombre de nouveaux cas apparaissant chaque année, aura pu être divisée par 4 ou 5, et si beaucoup de décès de mineurs restaient imputés à la silicose, leur espérance de vie était de moins en moins éloignée de la normale.
Les difficultés commerciales ne favorisaient pas non plus l'activité charbonnière. En particulier, les hivers 1966 et 1967 furent doux, l'hydraulicité élevée. L'écoulement vers les foyers domestiques des classés maigres, une des productions importantes du bassin, devint difficile, et la consommation des centrales électriques médiocre, malgré un arbitrage officiel de 1965 entre EDF et CDF, pour garantir un certain écoulement de charbon. Les difficultés financières devenaient importantes. Pour l'ensemble des Houillères, les CDF, encore en équilibre en 1960, durent bénéficier d'une aide de l'Etat qui atteignit le milliard de francs en 1967. Une part de cette aide était consacrée, depuis 1964, à couvrir l'excès, par rapport au régime général, des dépenses de retraite, en raison de la récession. Ceci montrait au passage l'inadaptation des régimes spéciaux de retraite, dès que leur situation démographique devenait instable.
Les HBNPC s'efforçaient de réagir en poursuivant leurs progrès techniques. Après des essais peu concluants d'emploi d'étançons hydrauliques, le soutènement marchant trouva sa place dans le bassin, grâce à l'ingéniosité d'un fournisseur allemand, qui eut l'idée de se faire payer sur les progrés de productivité permis par son matériel. Ce soutènement se développa avec le relais progressif des constructeurs français. Les haveuses trouvaient peu d'emploi dans le bassin, alors qu'elles étaient les principaux engins d'abatage en Lorraine. Mais l'usage du rabot se développa considérablement aux HBNPC. Le bassin perfectionna les machines de traçage, substitua progressivement l'électricité à l'air comprimé, mit en oeuvre le boutonnage du toit pour réduire les écoulements. Tous ces efforts ne pouvaient que ralentir un peu la récession.
Ne pouvant arrêter le déclin de la production charbonnière, les HBNPC devaient conserver leur dynamisme en développant d'autres activités. La plus évidente était l'activité chimique, sur laquelle le bassin avait déjà de fortes positions. Une nouvelle unité de production d'ammoniac fut installée à Mazingarbe. Les HBNPC participèrent aussi, en association avec l'ERAP et Air liquide à la nouvelle unité d'ammoniac créée à Nangis, en Seine et Marne, près de la raffinerie de Grandpuits qui l'alimentait en matières premières. Cette participation rapprochait leurs positions de production des zones de développement de leur marché d'engrais azotés.
La production de matières plastiques, polyéthylène, polypropylène, polystyrène, polyesters, avec de mouveaux procédés mis au point par le laboratoire de recherche chimique, se développa non seulement dans le bassin, mais dans une nouvelle usine à Lillebonne, en Basse-Seine, où l'entreprise pouvait disposer de matières premières pétrochimiques, alors que les ressources carbochimiques du bassin trouvaient leurs limites dans celles de la production de gaz de cokerie, dont elles étaient extraites. La production de polyesters à Drocourt s'accompagnait d'une annexe artistique, l'inclusion d'objets décoratifs, cristaux, fleurs, coquillages, champignons, etc, dans des enrobages de plastiques transparents.
Les HBNPC possédaient aussi de nombreuses filiales créées en participation avec des entreprises chimiques, notamment Kuhlmann et l'Air liquide. C'est ainsi que j'entrai dans les conseils d'administration de la Grande-Paroisse, où nous étions associés avec l'Air liquide pour la production d'engrais, et de Huiles-goudrons-dérivés, HGD, qui traitait les goudrons et benzols provernant de nos cokeries.
Notre réalisation la plus exceptionnelle fut une usine d'eau lourde construite à Mazingarbe. La réalisation de la bombe atomique française nécessitait une ressource en eau lourde, et le général de Gaulle ne voulait pas dépendre d'un approvisionnement étranger, qui n'aurait pu être trouvé qu'en Suède. Pour aboutir à une production française, qui nécessitait une ressource en hydrogène, deux procédés étaient en concurrence, l'un partant de l'hydrogène sulfuré, disponible en abondance à Lacq, et l'autre inventé par les HBNPC à partir de l'ammoniac. La décision gouvernementale en faveur de notre procédé tomba juste après ma nomination à la tête du bassin. Nos chimistes trouvèrent que c'était de bonne augure pour leur activité.
Le calendrier de livraison de l'eau lourde aux militaires était strictement impératif. Il avait même été annoncé en haut lieu qu'à défaut de respect des échéances, des têtes tomberaient ! Grâce à Dieu ... et à nos techniciens, les délais furent respectés. Sans doute, le coût prévisionnel fut dépassé de 60%. Mais j'avais en tête le propos de Deteuf, je crois: "Lorsqu'on construit une unité destinée à mettre en oeuvre un procédé entièrement nouveau, il faut faire établir un devis par trois experts distincts, ajouter les trois montants estimés, et se garder de diviser la somme par trois". Je trouvais donc que je ne m'en étais pas si mal tiré (L'usine d'eau lourde de Mazingarbe fut cependant arrêtée au bout de quelques années. Son coût de production était élevé, et la diversification de la production dans le monde permit des approvisionnements extérieurs sans grands risques et à moindre coût).
En 1967, les CDF estimèrent après avoir inventorié les réalisations des deux principaux bassins, HBNPC et HBL, dans le domaine de la chimie, que cette activité ne résisterait à la concurrence que si elle présentait une dimension et une cohérence suffisante. Ils décidèrent donc d'unifier le potentiel chimique de la profession, en créant une société distincte, CDF-Chimie, à laquelle les bassins devaient apporter leurs actifs chimiques. Cete création suscita naturellement quelques réticences des gestionnaires des bassins, dépouillés d'un de leurs attributs appréciés. Mais l'opération se déroula finalement de façon satisfaisante. La nouvelle société fut dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance. Le président du directoire était Jacques Petitmengin, que j'avais eu quelque temps comme collaborateur aux CDF. J. Desrousseaux prit la présidence du conseil de surveillance, dont j'étais vice-président.
La chimie apportait une contribution non négligeable au chiffre d'affaires, mais était peu créatrice d'emplois. Ses effectifs étaient sans commune mesure avec ceux qui disparaissaient de l'activité minière. Il apparut nécessaire de créer d'autres activités dans l'orbite des HBNPC, et pour y parvenir de mettre en place une filiale, la SICCA, chargée d'explorer et de mettre en oeuvre de telles activités. La société s'orienta dans deux voies très différentes, l'une asez classique dans le prolongement de l'activité chimique, la transformation des matières plastiques; l'autre plus novatrice, la construction préfabriquée tridimensionnelle. Cette dernière activité comportait la fabrication en usine de cellules immobilières qui, transportées sur les chantiers, permettaient la construction de logements dans le temps record d'un petit nombre de jours. Une telle usine fut créée dans le Pas-de-Calais et une autre au Mans. La présidence de la SICCA, et l'animation de ses activités étaient assurées par un de mes jeunes camarades de corps, Dominique Kirchner, que j'avais trouvé dans le bassin en y arrivant.
Quelques autres activités, dont les prémices existaient déjà dans le bassin, furent développées: l'utilisation des cendres de centrales électriques dans la fabrication de ciment et les revêtements routiers; la production de briques à partir des schistes, sous-produits des lavoirs de charbon; la conversion partielle des importants ateliers mécaniques du bassin à des activités commerciales. Pour préciser les orientations d'avenir de l'ensemble des activités traditionnelles et nouvelles de l'entreprise, je créai une commision, baptisée Horizon 1985, pour réfléchir, après audition de tous les responsables et d'experts extérieurs, sur les perspectives des HBNPC à l'échéance de dix ans.
Une autre initiative concerna le parc immobilier des houillères. Ce parc comportait plus de cent mille logements, répartis dans tout le bassin. Il comprenait des logements récents et en bon état, construits depuis la guerre, des corons très anciens qui ne pouvaient être voués à terme qu'à la démolition, et un catégorie intermédiaire, la plus nombreuse, composée de logements qui, au delà de l'entretien courant, nécessitaient des travaux importants de rénovation. Malgré la baisse rapide des effectifs, ces habitations devaient, pour le plus grand nombre, être occupées longtemps encore par les familles de mineurs, puisque les retraités conservaient le droit au logement. Cependant des maisons commençaient à se libérer et faire l'objet de ventes et de locations. Ce mouvement était destiné à s'amplifier progressivement. L'effort de rénovation, principalement en faveur des mineurs à l'origine, avait donc aussi pour objectif plus lointain de conserver la valeur commerciale du parc. Des tranches de rénovation de plusieurs milliers de logements par an furent donc inscrites aux budgets d'investissement des HBNPC.
J'avais aussi des contacts assez suivis avec l'évêque d'Arras, Mgr Huygues, qui s'intéressait avec intelligence aux problèmes de la population minière, et avec qui, plus prosaïquement, je devais traiter un autre problème immobilier, celui de la dévolution des églises, réalisation et propriété des anciennes compagnies minières, et qui n'avaient évidemment pas vocation à rester dans le domaine d'une entreprise publique.
Les réalisations propres des HBNPC ne pouvaient suffire, et de loin, à compenser les pertes d'emploi de la mine. Les CDF, de leur côté, avaient créé, avec la participation des bassins, une société financière, la SOFIREM, dont la vocation était de favoriser l'implantation dans les régions minières d'entreprises souffrant d'une insuffisance de fonds propres, en prenant dans leur capital un participation minoritaire et temporaire, moyennant un engagement de l'entreprise d'enbaucher dans ses effectifs des mineurs à reconvertir. La gestion de l'entreprise était en outre suivie et assistée, avec la présence dans son conseil d'un cadre de SOFIREM. Ces cadres, qui étaient d'anciens ingénieurs des Houillères, avaient reçu à cet effet une formation complémentaire appropriée. Plusieurs entreprises purent par cette filière être implantées dans le Nord Pas-de-Calais.
Pour compléter et poursuivre les initiatives de la profession charbonnière, je proposai à la Chambre régionale de commerce et d'industrie, à la délégation régionale du CNPF, et à la Chambre syndicale de la sidérurgie, dont les effectifs se réduisaient comme ceux des Houillères, de créer en commun une association pour l'industrialisation de la région. Cette proposition fut aussitôt acceptée. L'association permit de favoriser des implantations industrielles, qui complétèrent celles de SOFIREM. Le délégué général de l'association, Billecocq, fut d'ailleurs rapidement désigné commissaire à la reconversion par la DATAR, qui souhaitait associer les pouvoirs publics à l'effort entrepris.
Durant ma présence à Douai, furent entreprises les études préalables à l'élaboration du VI ème plan. Les préfets de région étaient chargés de proposer au gouvernement, après les consultations appropriées, les priorités jugées souhaitables. L'équipement téléphonique était alors très en retard en France. Les industriels demandèrent donc au préfet d'inscrire son développement dans les priorités. Le préfet Dumont, pourtant un homme intelligent et ouvert, refusa d'abord cette inscription au motif que " le téléphone, c'était pour la distraction !" C'est dire à quel point la nécessité d'un réseau de communication moderne était encore peu entré dans les esprits, en tout cas dans ceux des responsables administratifs. Devant les protestations unanimes, le préfet se résigna à proposer le téléphone. Celui-ci devait figurer en effet comme une des priorités du plan, et au prix d'un effort intensif, il rattrapa, en un temps finalement assez court le retard qu'il avait accumulé en France.
Le général de Gaulle vint dans la région pour inaugurer l'usine d'eau lourde et présider un certain nombre de réunions avec les responsables administratifs et économiques. J'eus l'occasion, au cours d'une de ces réunions, de présenter un rapport sur la situation de l'emploi. Le soir, il y avait une réception à la préfecture. Comme j'étais retenu par une réunion de conclusion, je suggérai à Janine d'aller m'attendre à l'entrée de la préfecture, où je la rejoindrais. Alors qu'elle se trouvait en effet dans la longue queue qui attendait de défiler devant le général, un ami qu'elle y retrouva lui proposa, pour éviter une attente de durée imprévisible, de la faire entrer comme si elle était son épouse. J'arrivai à temps pour éviter ce faux ménage. Heureusement d'ailleurs, car lorsque nous nous sommes trouvés, Janine et moi, devant le général, c'est à elle que celui-ci s'adressa: "Votre mari, Madame, nous a fait un exposé remarquable". Prise de court; Janine resta sans voix. "C'était très bien ainsi, lui expliqua-t-on après coup. Dans ce genre de défilé, déjà très long, il ne faut jamais répondre aux propos du général. Cela prolongerait beaucoup trop".
Je continuais à me rendre à la conférence mondiale de l'énergie. En 1966, je suis allé avec Janine à la session de Tokyo. Après celle-ci, nous avons fait, pendant une semaine, un voyage à travers le Japon, guidés par un jeune étudiant japonais. Nous sommes revenus en passant par le Cambodge et Angkor, que nous n'avions vu que trop brièvement en revenant d'Australie en 1962. Pendant que nous prolongions notre séjour au Japon, certains de mes collègues avaient fait une incursion en Chine, où débutait la révolution culturelle L'un d'eux, après avoir assisté à un défilé de gardiens de la révolution absolument interminable, déclarait: "Ils ne nous feront jamais croire qu'ils ne sont qu'un milliard !".
Au début de 1967, la nouvelle maison de direction, construite sous la maîtrise de Janine, fut enfin achevée, et nous avons pu nous y installer. Elle était plus spacieuse et mieux distribuée que notre demeure provisoire, avec notamment, dans le séjour, une agréable fosse à conversation autour de la cheminée. Le seul problème auquel nous avons été confrontés fut celui du chauffage. Le service thermique des houillères avait visiblement considéré notre installation de chauffe comme une base expérimentale sur laquelle il pouvait faire tous ses essais, et nous avait doté d'une chaudière à grains maigres, avec vis d'alimentation automatique, et trois distributions de chaleur distinctes, une par le sol, une par le plafond, et la troisième par radiateurs. Inutile de dire que la mise au point de cette installation s'avéra particulièrement laborieuse. A cette réserve près, nous avons pu profiter agréablement de cette nouvelle résidence, mais pour fort peu de temps.
Au début de 1968, J.C. Achille annonça son départ des CDF pour entrer à la direction de Rhône-Poulenc, et cette fois il m'était difficile de résister aux sollicitations unanimes de la profession, qui me demandait de prendre sa succession. Je serais volontiers resté quelques années de plus aux HBNPC. Mais je dus me résoudre à accepter la direction générale des CDF
La direction générale des Charbonnages de France
La situation présentait d'ailleurs pour moi un particularité propre à la profession. Au moment de la mutation de la CFTC à la CFDT en 1966, certaines fédérations avaient refusé cette mutation. C'était le cas de la fédération des mineurs qui restait rattachée à la CFTC maintenue. Parallèlement pourtant, un syndicat CFDT s'était peu à peu implanté. Il n'avait été que récemment reconnu par les CDF, avait encore une position assez faible et, pour cette raison même, se montrait particuliérement susceptible. Dans la négociation, cela créait facilement des incidents, non pas avec la direction, mais entre les organisations syndicales.
Malgré cet écueil, la négociation se poursuivit assez favorablement pour aboutir à un accord, ou tout au moins un projet d'accord à soumettre à la base, le soir du 29 mai, soit le deuxième jour du débat. Tous les problèmes de la profession avaient du être abordés. Parmi les principaux avantages accordés aux syndicats figuraient un augmentation des salaires de 10%, la réduction de la durée du travail à 40 h en trois ans, l'indemnisation des jours de grève à 50%. Résultat plus original, une commission était créée pour suivre en permanence les programmes d'activité des Houillères. Cette commision, dite de l'article 11, numéro de l'article du protocole d'accord qui la créait, joua par la suite un rôle non négligeable pour désamorcer les conflits toujours près de naître, à l'occasion des épisodes successifs de la régression de l'activité minière.
Paradoxalement, je faillis souffrir d'avoir terminé trop tôt, et peut-être trop bien, ma négociation. Celles des autres entreprises publiques, plus laborieuses, se poursuivaient. Les mineurs eurent le sentiment d'avoir sans doute été trop accomodants, et la reprise du travail s'avéra difficile. Mais après le départ de Paris et le retour théâtral du général de Gaulle les 29 et 30 mai, un discours énergique, et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, le sentiment prévalut que la récréation était terminée, et tout rentra assez vite dans l'ordre, dans les mines comme ailleurs. Il serait cependant faux de croire que mai 1968 ne laissa pas de traces. Dans la profession minière, un certain sens de la discipline avait été gravement atteint et ne fut jamais retrouvé.
J'abordai alors le cours normal de mes fonctions, et pour commencer, cette fois encore, les problèmes d'hommes. Pour me succéder comme directeur général des HBNPC, j'avais choisi Max Hecquet qui, après une longue carrière dans ce bassin, avait dirigé pendant quelques années le service commercial des CDF. Il devait retouver à Douai Robert Coeuillet qui, après un long séjour dans le service technique des CDF, avait été muté aux HBNPC en 1967, pour remplacer A. Proust, lui-même chargé de la direction du service technique des CDF. La nomination de M. Hecquet fut bien acceptée, sauf par D. Kirchner qui espérait être nommé à ce poste. Déçu,il quitta les HBNPC au bout de quelques années, pour prendre des fonctions à la Lainière de Roubaix, puis quitta définitivement l'activité industrielle, et consacra le principal de son temps à assister un de ses fils lancé dans une exploitation agricole.
Il était aussi nécessaire de nommer les dirigeants d'un autre établissement, les Houillères de bassins du centre et du midi, les HBCM, qui venait d'être créé par fusion des sept Houillères indépendantes qui couvraient jusque là les exploitations assez dispersées de la moitié sud de la France. Pour la direction générale, le choix de R. Tacquet s'imposait. Il dirigeait depuis plusieurs années les Houillères de la Loire. St Etienne était d'ailleurs choisie pour siège du nouvel établissement. La présidence soulevait plus de problèmes. Le candidat du gouvernement était Jean Runel, jusque là président des Houillères d'Aquitaine, une forte personnalité, assez sympathique au demeurant, mais qui avait la regrettable habitude d'interventions non concertées, et le plus souvent intempestives, dans les ministères. Sa candidature n'avait donc pas ma faveur, et lorsqu'elle fut soumise au conseil d'administration des HBCM, l'abstention des représentants des CDF fut remarquée, malgré le vote à bulletin secret. Comme il n'y avait pas, compte tenu de la composition du conseil, d'autre candidat possible, J. Runel finit pourtant, de guerre lasse, par être désigné. Après une inévitable période de froid, nos relations redevinrent normales, voire cordiales, mais je dus surveiller de près ses initiatives.
A la fin de 1968, après les élections législatives qui avaient donné au général une Chambre introuvable, le gouvernement estima le moment politiquement opportun pour reprendre en mains la situation économique, après les débordements du mois de mai. Au mois de décembre, fut promulgué un nouveau plan charbonnier, dit plan Bettencourt, du nom du nouveau ministre de l'industrie. Il prévoyait une réduction de la production de 43 à 25 Mt entre 1968 et 1975, les HBCM, les plus touchées, devant passer de 10 à 3 Mt, les HBNPC de 20à 10 Mt.
En Lorraine le plan prévoyait la fermeture de deux sièges, Ste Fontaine et Faulquemont. Pour Ste Fontaine, ce n'était qu'une confirmation. Pour Faulquemont, le problème était plus délicat. S'il fallait fermer un siège, le choix entre La Houve et Faulquemont, producteurs de la même qualité de charbon flambant sec, méritait des études complémentaires. Mais surtout, le siège de Faulquemont était isolé dans la nature, sans aucune activité de reconversion au voisinage, et l'annonce de sa fermeture était, à ce moment -là, psychologiquement très difficile. Après de laborieuses discussions, j'obtins du gouvernement que cette fermeture ne soit pas dès maintenant affichée, et qu' on se contente d'annoncer la fermeture probable d'un siège dans la période à venir.
Le directeur général des HBL, J. Lorimy, devait prendre sa retraite au début de 1970. Son adjoint, A. Puyte, n'avait que quelques mois de moins que lui. J'avais donc prévu une légère prolongation de la période d'activité de J. Lorimy pour que les deux départs coïncident, et que la direction générale puisse être réorganisée dans son ensemble. Mais A. Puyte, toujours aussi difficile à maîtriser, ne l'entendit pas de cette oreille, prétendit briguer la succession de J. Lorimy, sans se préoccuper des limites d'âge de règle dans la profession. Comme il s'était fait élire conseiller municipal de Forbach sur une liste RPR, il se fit appuyer de façon tout à fait intempestive par le député-maire RPR de Boulay, Julien Schwartz, qui n'appréciait pas les CDF, dont écrivait aimablement ce parlementaire, "je me méfie comme de la peste depuis toujours".
Naturellement je tins bon, et le 4 juillet 1970, J. Lorimy et A. Puyte, ce dernier de mauvais gré, quittèrent les HBL. Inutile de dire que mes relations avec J.Schwartz ne s'en trouvèrent pas améliorées, et je devais le retrouver en travers de mon chemin peu après. La direction générale fut confiée à Jean Lagabrielle, un de mes camarades de promotion à l'X, et membre du corps des mines qui, après une partie de carrière au Maroc, avait pris à son retour en France la direction générale des Houillères d'Aquitaine.
Le nouveau directeur général, après examen approfondi de la situation des sièges du bassin se convainquit, dans le courant de 1970, que c'était bien Faulquemont qui devait être fermé. L'implantation d'entreprises au voisinage du siège, pour la reconversion du personnel, était d'autre part décidée et amorcée. L'arrêt ne présentait pas d'urgence. Par contre les travaux coûteux entrepris pour préparer l'exploitation d'un nouvel étage, et les commandes des matériels les plus onéreux dont l'échéance approchait, n'avaient plus d'objet. Le programme d'investissements, présenté au conseil d'administration en novembre, comme chaque année, ne comportait donc plus de travaux d'approfondissement pour Faulquemont, ce qui laissait présager la fermeture prochaine du siège. Bien entendu les représentants du personnel s'en aperçurent aussitôt.
Les réactions des mineurs se développèrent lentement. Elles furent provoquées et excitées par J. Schwartz qui, dès le 21 novembre, au lendemain de la séance du conseil, menaçait par téléphone d'une action violente contre la fermeture envisagée. Après une invasion de la maison d'administration à l'occasion de la séance suivante du conseil, le personnel de Faulquemont se mit en grève, suivi plus ou moins rapidement des autres sièges, par solidarité. Les élections municipales devaient avoir lieu quelques semaines plus tard. Le moment était donc politiquement très inopportun, mais les HBL et les CDF n'avaient pas eu le choix du calendrier, qui leur était imposé par les textes réglementaires.
Le gouvernement se montra très irrité par cet épisode. Convoqué avec moi devant le premier ministre, Jacques Chaban-Delmas, le nouveau président des CDF, Yvon Morandat tenta d'invoquer une légère tendance à la reprise du travail. Cette amélioration épisodique et locale était parfaitement illusoire. Le premier ministre, qui n'était pas dupe, s'exclama d'un ton sarcastique: "Somme toute, c'est un succès! Et bien, comment allons nous sortir de ce succès?" Comme il ajoutait qu'il faudrait bien désigner, après le retour au calme, le responsable de cette situation, je dus résister à la tentation de lui dire que le responsable c'était lui, es qualité bien sûr, puisque tout découlait de décisions gouvernementales, assorties de la fronde d'un député de la majorité.
| Héros de la résistance, et célèbre surtout pour avoir pris possession de Matignon au moment de la libération de Paris, Yvon Morandat avait été successivement président des Houillères de Provence, puis des HBNPC, durant ma direction générale, avant que nous nous retrouvions aux CDF. |
Peu après, Matignon nous enjoignit de nous rendre en Lorraine le 19 février 1991, pour une rencontre avec les organisations syndicales, en terrain neutre, à la préfecture. Malgré mes objections, le préfet admit le député Schwartz dans la réunion, à la condition qu'il reste observateur muet. Bien entendu cette condition ne fut pas respectée, et au moment où j'avais laborieusement étendu le débat, de manière plus constructive, à l'avenir d'ensemble du bassin, le député demanda et obtint la parole, pour réintroduire la confusion dans le problème de Faulquemont. Ayant exigé qu'on impose de nouveau silence au parlementaire qui n'avait rien à dire dans cette réunion, je parvins, après des heures de discussion, à un projet d'accord avec les syndicats, qu'ils devaient soumettre à leurs mandants.
En dehors de garanties portant sur les autres sièges des HBL, l'accord prévoyait que l'arrêt de Faulquemont serait étalé jusqu'au début de 1975, que les travailleurs auraient le choix entre l'emploi dans les autres sièges du bassin, des reconversions et des retraites anticipées, qu'ils conserveraient leur logement s'ils le désiraient, et que les mutés bénéficieraient d'une garantie de rémunération . La signature était prévue pour le lendemain 10 février à Forbach. Ce jour-là, alors que je me trouvais dans une autre négociation à Paris, Matignon envoya à l'improviste Y Morandat en Lorraine pour servir de garant, au moment de la signature, aux dispositions adoptées la veille. En fait, il ne put éviter de nouvelles discussions, et dut accorder le paiement des jours de grève, avantage dicutable, et pas accordé jusqu'alors dans la profession. Dans l'immédiat, la grève prit fin, au grand soulagement du gouvernement. Mais le conflit devait évidemment rebondir au moment de la décision finale de fermeture du siège.
Dans l'ensemble des Houillères, la régression se poursuivait. L'écoulement restait difficile, malgré la dévaluation de 1969 qui permit, grâce à l'accroissement de prix des charbons importés, une résorption des stocks et une augmentation des prix de barème. Le plan Béttencourt prévoyait une réduction de la production française de charbon de 3 Mt par an jusqu'en 1975. En fait cette réduction atteignit 5 Mt par an. On ne prévoyait plus qu'une production de 13 Mt en 1980. Les effectifs, de leur côté, passaient de 164.000 en 1968 à 83.000 en 1974, et ne devaient plus être que de 50.000 en 1980.
Cependant en 1974 se produisit un événement majeur, la première crise pétrolière qui suivit la guerre des six jours entre Israël et ses voisins arabes, l'Egypte, la Syrie et la Jordanie. Le prix du baril de pétrole, voisin jusqu'alors de 1 ou 2$ par baril passa brusquement à 8$. Les contrats devenaient difficiles à honorer. Une fois de plus, les autorités s'inquiétèrent pour l'approvisionnement énergétique, et une fois de plus la régularité de la régression charbonnière se trouva troublée par des velléités de nouveau recours au charbon.
Pour moi, dans cette perspective, la première préoccupation était, dans la nouvelle ambiance du marché de l'énergie, de relever sensiblement les prix du charbon, pour maîtriser le déficit, condition sine qua non d'un freinage de la régression. Je me rendis avec Y. Morandat chez Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et des finances, pour solliciter l'autorisation d'un telle hausse. Je fus reçu très froidement dans ma démarche: "Nous sommes victimes d'un racket de la part des pays pétroliers, et vous voulez vous associer à ce racket".
J. Desrousseaux venait de montrer, dans une étude économique approfondie, que le prix optimum d'une ressource épuisable comme le pétrole n'était pas le coût marginal d'exploitation, à peu près appliqué jusqu'ici, mais un prix tenant compte des perspectives d'épuisement de la ressource, et des coûts des produits de substitution. Ce prix optimum, pour le pétrole, n'était pas tellement éloigné des nouveaux prix pratiqués par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Il ne s'agissait donc pas d'un racket, mais d'un nouveau prix de marché, sur lequel devaient se fonder les décisions économiques. Mais je renonçai, dans une courte entrevue avec un ministre, même bon économiste, à développer cette théorie. Je me bornai à exposer que j'avais pu faire accepter la régression charbonnière à mes troupes tant que la situation de concurrence interdisait aux Houillères de pratiquer des prix de vente rentables, et les condamnaient à un déficit de moins en moins acceptable. Je ne garantissais par contre plus rien, quant aux réactions des mineurs, si les décisions gouvernementales nous interdisaient arbitrairement de profiter d'un prix de marché brusquement favorable. Je n'obtins pourtant pas gain de cause dans l'immédiat.
Cela n'empêchait pas Jean Blancard, nouveau délégué général à l'énergie, d'exercer de fortes pressions sur les CDF en vue d'une révision en hausse des programmes de production. Les Houillères furent invitées à réexaminer leurs possibilités. Un programme de 20 Mt en1980, au lieu de 13Mt, fut envisagé.
Cependant la décision d'arrêt des Houillères de la Loire fut confirmée. Elle ne devait intervenir qu'en 1980.
Dans ces circonstances, arrivait la phase finale de la fermeture du siège de Faulquemont en Lorraine. Le programme de production des HBL pour 1980 avait été porté à 10 Mt au lieu de 7, mais il n'était pas possible de revenir sur la décision de fermeture de Faulquemont, qui ne pouvait plus être longtemps différée. Une fois de plus, la période s'y prêtait mal. Le bassin se trouvait confronté depuis un an à un état de trouble permanent, et à des grèves catégorielles successives. Au surplus, les espoirs plus ou moins fallacieux nés de la crise pétrolière étaient très défavorables à une fermeture de siège, même annoncée depuis longtemps. Les mutations qu'on tentait d'organiser depuis deux ans se heurtaient à l'opposition ouverte des syndicats non signataires de l'accord de Forbach, CGT et CFDT. Des primes de mutation durent être consenties en sus des avantages prévus par l'accord, ce qui permit un certain dégel de la situation. Une entrevue avec les édiles des communes intéressées aboutit à un consensus sur l'utilisation du carreau de la mine et sur l'alimentation en eau des communes à partir du siège minier partiellement ennoyé. Le 27 septembre 1974, dernier jour de l'extraction de charbon, le personnel fit une grève symbolique, et le siège s'arrêta de produire.
On pouvait espérer terminées les péripéties de Faulquemont, mais il n'en était rien Le lendemain 28 septembre, les conseils municipaux de Faulquemont et de Créhange démissionnèrent. Le 30 septembre, le bureau du chef de siège était envahi. Un commando, bien entendu sans encadrement, descendit au fond pour s'opposer aux opérations de démontage du matériel. Il s'en suivit une période de grande confusion. Les cars des ouvriers mutés étaient bloqués au départ. Pendant quelques jours, au début de novembre, la grève s'étendit à l'ensemble du bassin. Des élus locaux, maires et députés, pénétraient sans autorisation dans les établissements de l'entreprise, pour y prononcer des discours.
Une délégation de mineurs lorrains se rendit au siège des CDF pour une occupation de quelques heures, et le déversement symbolique de quelques tonnes de charbon de Faulquemont. Sur forte pression du préfet, l'ennoyage partiel du puits fut interrompu. Pendant une période heureusement courte, l'alimentation en eau de la plateforme chimique de Carling, qui était assurée par ce puits, fut arrêtée par un commando. Recevant une délégation, le ministre de l'industrie, Michel d'Ornano, crut devoir promettre une nouvelle étude sur les possibilités de reprise de l'exploitation de Faulquemont. Par deux fois, les nouveaux bureaux de la direction générale, à Merlebach, furent envahis, la deuxième fois avec séquestration du directeur général, qui réussit cependant à s'échapper par ses propres moyens. Enfin, après une réunion de la commission de l'article 11 aux CDF, et une nouvelle augmentation des primes de mutation, le mouvement prit fin, le démantèlement des installations de Faulquemont put reprendre, et les ouvriers mutés gagnèrent leurs nouvelles affectations.
Mais J. Lagabrielle était harrassé par la vie qu'il avait du mener en Lorraine pendant sa période de direction. J. Desrousseaux, qui avait exercé auprès de moi les fonctions de directeur général adjoint des CDF, prenait sa retraite, et J. Lagabrielle brigua sa succession, ce que j'acceptai volontiers. R. Coeuillet avait subi une nouvelle mutation, aux HBL en juillet 1972, pour apporter au directeur général une assistance bien nécessaire. Ce fut donc lui qui, tout naturellement, fut désigné pour prendre à son tour la direction générale.
L'arrivée de J. Lagabrielle aux CDF ne se passa pas aussi simplement. Le ministre d'Ornano me convoqua pour m'indiquer qu'il n'était pas d'accord sur cette affectation, et qu'il souhaitait que je prenne comme adjoint Jean Claude Sore, jusque là directeur des mines au ministère. Je lui marquai mon étonnement. Contrairement aux nominations de directeurs généraux, de la compétence gouvernementale en dernier ressort, la nomination d'un directeur général adjoint ne relevait que du directeur général. Celle de J. Lagabrielle lui avait déjà été notifiée, sans que j'aie cru devoir auparavant consulter le ministre. En fait celui-ci n'était pas véritablement hostile à cette décision, et se préoccupait seulement de trouver un point de chute à J.C. Sore, dès lors que, dans le cadre d'une réorganisation de l'administration du ministère, il se proposait de supprimer la direction des mines. Je pouvais très bien accueillir l'intéressé aux CDF. J'avais d'ailleurs déjà eu avec lui des conversations à ce sujet. Seul le titre de directeur général adjoint n'avait pas été évoqué; mais rien ne s'opposait à ce qu'il y ait deux directeurs généraux adjoints aux CDF. J. Lagabrielle et J.C. Sore furent donc nommés conjointement.
Cette double arrivée posa d'autant moins de problèmes que les ambitions de J.C. Sore portaient sur une activité entièrement nouvelle pour les CDF, qu'il se proposait de créer et de développer. L'idée d'un nouveau recours au charbon s'était manifestée non seulement en France, mais dans tous les pays occidentaux.
Mais comme il apparaissait bien que les charbonnages européens n'offriraient, compte tenu de leurs gisements difficiles et de leurs coûts de production trop élevés, que des possibilités réduites, l'attention se portait sur des gisements nouveaux et beaucoup plus favorables, susceptibles d'être mis en exploitation dans des pays d'outremer. Les grands groupes pétroliers, un peu paradoxalement, mais dans un souci de diversification, s'étaient lancés les premiers dans une telle prospection. J.C. Sore pensait que les CDF avaient, à défaut des moyens financiers de ceux-ci, la capacité technique de participer à cet effort de recherche de nouvelles ressources. Il obtint mon assentiment sur ce projet, et celui, beaucoup plus réservé des pouvoirs publics, de qui dépendaient les autorisations de financement.
La petite équipe réunie à cet effet porta ses investigations principalement sur des gisements exploitables en découverte, avec de faibles coûts salariaux, aux USA, au Canada, en Australie, en Afrique du sud, en Colombie. Un certain nombre de participations furent prises par les CDF dans des sociétés créées pour mettre en exploitation les gisements récemment explorés dans ces pays. Les principales se situèrent en Australie et au Canada. Les résultats financiers furent généralement décevants. Il ne pouvait guère en être autrement. Les autorisations requises du gouvernement n'étaient obtenues que lorsque les sommes à investir étaient suffisamment modestes, ce qui voulait dire, car il n'y a pas de miracles, qu'il s'agissait d'affaires relativement médiocres. Elles durent être abandonnées au bout de quelques années. Les CDF pouvaient, pour se consoler, constater que les groupes pétroliers internationaux, malgré leur puissance financière, abandonnèrent eux-mêmes beaucoup des investissements charbonniers qu'ils avaient entrepris, dès que la situation pétrolière se fut normalisée, et malgré des prix de marché demeurant à un niveau élevé.
Une de mes principales activités aux CDF était le contact et les négociations avec les organisations syndicales. Mes interlocuteurs les plus notoires étaient Achille Blondeau pour la CGT, que j'avais déjà accueilli dans le Nord, un homme de fort tempérament, assez difficile dans la discussion, mais accessible au compromis lorsqu'il en sentait l'intérêt, et Jean Bornard pour la CFTC, un homme affable, mais sachant tenir ferme lorsqu'il le croyait judicieux, avec qui j'avais non seulement des discussions efficaces, mais des relations vraiment amicales. Les négociations salariales, les plus fréquentes, étaient régies, depuis la grève de 1963, par la procédure dite Toutée, du nom du président de section au Conseil d'Etat qui avait été chargé de l'instituer. Le gouvernement fixait le taux d'accroissement de la masse salariale autorisé. La direction et les syndicats négociaient les mesures d'application de cette augmentation disponible: accroissement des salaires, hiérachisé ou non, primes diverses, etc.
Dans les acquits de la négociation de mai 1968, les représentants syndicaux avaient réussi à faire sauter la fixation autoritaire par le gouvernement de l'augmentation de la masse. Ce n'était qu'une apparence, dont les syndicats n'étaient d'ailleurs qu'à moitié dupes. Dans les faits, je devais aller discrètement recueillir les instructions de Matignon. La seule différence était qu'elles n'étaient pas publiques. Mais dans la négociation, je devais, comme auparavant, m'en tenir aux augmentations autorisées. Toutefois, en cas de blocage sévère, le gouvernement pouvait, sans perdre la face puisqu'il n'avait rien affiché, lâcher un peu de lest.
Mon interlocuteur à Matignon pour ces questions salariales, et les problèmes sociaux en général, était, durant le gouvernement Chaban-Delmas, Jacques Delors, promis par la suite à une brillante carrière. Il faisait preuve d'une loyauté parfaite, ne revenait jamais sur ce qui était convenu, et évitait toujours de mettre les dirigeants tels que moi en difficulté. Un jour il s'y mit lui-même, en m'autorisant à consentir dans une négociation un avantage, dont il était convenu entre lui et le ministère des finances, mais cela était sorti de son esprit, qu'il ne devait pas être accordé pour le moment. Il me téléphona, embarrassé, au milieu de ma négociation, pour me demander d'éluder, si possible ce point de l'ordre du jour. La question était déjà sur la table, et à tout autre j'aurais répondu qu'il était trop tard. Mais je tenais trop à mes excellentes relations avec lui, et je réussis à trouver un biais pour écarter le problème, lorsque je rejoignis les syndicats. Il m'en sut gré.
J'eus à mener d'autres négociations, notamment pour mensualiser les salaires des mineurs, ce qui était une réforme d'ordre général. Je négociai aussi la création de comités d'entreprise dans les Houillères. Ils n'étaient pas prévus par la loi dans les entreprises publiques; il s'agissait donc d'une création conventionnelle. Les avantages en nature des mineurs vinrent aussi en discussion. Enfin la commission de l'article 11 eut à délibérer souvent sur les programmes des Houillères, d'abord dans la ligne du plan Béttencourt, plus tard dans les perspectives un peu différentes liées à la crise pétrolière.
Bien que la sécurité dans les mines fît des progrès constants, nous n'étions malheureusement pas encore à l'abri de catastrophes. Le 22 décembre 1974, un coup de grisou à Liévin fit 42 morts. Ce drame provoqua des réactions syndicales assez modérées, mais surtout une violente agitation de mouvements gauchistes, en particulier du mouvement communiste révolutionnaire, et de son journal Front rouge. A son instigation, un soi-disant "tribunal révolutionnaire" réunit à Lens le 23 mars plusieurs centaines de personnes, et déclara les Houillères responsables de la catastrophe. L'agitation se poursuivit encore quelques mois, puis se calma.
Je croyais que l'affaire appartenait au passé lorsque, le 12 janvier 1976, nous avons été réveillés, Janine et moi, par un coup de téléphone matinal nous annonçant la livraison d'un pli urgent. Effectivement, entre 7h et 8h, on sonna à la porte d'entrée de notre appartement Janine ouvrit sans méfiance, et se trouva immédiatement assaillie, ligotée et bâillonnée, ainsi que notre fils, par quatre individus masqués et armés. Ils me trouvèrent moi-même dans ma chambre, me passèrent menottes et bâillon. Celui qui était visiblement le chef du commando me frappa au visage, me blessant assez sérieusement à l'oeil gauche, en déclarant qu'il s'agissait de venger les morts de Liévin et que, pour 42 morts, ce n'était pas grand chose. Ils arrachèrent les fils du téléphone et, avant de s'enfuir, inscrivirent en plusieurs endroits le sigle MRVV sur les murs de l'appartement. (Ce sigle n'a jamais été identifié. Il s'agissait de toute évidence d'un groupuscule gauchiste sans notoriété).
Janine, ayant pu se défaire de ses liens, me libéra de mon bâillon, me donna les premiers soins, avertit le gardien. Celui-ci alerta Police-secours qui arriva aussitôt, me retira mes menottes et me fit transporter à l'Hôtel-Dieu. On y diagnostiqua, outre des hématomes de la conjonctive, un oedème rétinien et une fracture de la paroi interne de l'oeil, qui m'a laissé une séquelle de diplopie, c'est à dire une vision dédoublée dans le champ latéral de l'oeil. Je dus subir une petite opération chirurgicale et rester quelques jours à l'hôpital.
Les journalistes voulaient me voir, et plutôt que d'être dérangé en permanence, j'acceptai de tenir dans ma chambre une petite conférence de presse. Comme on me demandait mes impressions, je rappelai le propos de Georges Bidault, aussitôt après la guerre: "La démocratie, c'est lorsque un coup de sonnette à 7h du matin n'annonce que le passage du laitier". Je déduisais de mon aventure que nous n'étions plus tout à fait en démocratie. J'ajoutai que le sort de ceux qu' on appelle ses grands commis ne paraissait pas préoccuper outre mesure le gouvernement, qui très empressé, en d'autres cas, à s'apitoyer sur les victimes, n'avait pas exprimé un mot de réprobation après l'attentat dont j'avais été l'objet.
La suite administative la plus astreignante fut pour moi, heureusement assisté par le service juridique des CDF, un long contentieux avec la Sécurité sociale, porté successivement devant les organismes contentieux propres à celle-ci, puis devant le Tribunal de première instance, la Cour d'appel et la Cour de cassation. Il s'agissait de savoir si mon agression constituait un accident du travail, ce que je plaidais, et que contestait la Sécurité sociale, bien qu'évidemment l'agressé fût le directeur général des CDF dans l'exercice de ses fonctions, et non M. Paul Gardent. Devant les différentes instances, je gagnais et perdais alternativement. Mon acharnement judiciaire n'avait pas pour objet principal la réparation de mon propre dommage, heureusement limité, mais le souci de faire établir une jursprudence favorable pour des victimes éventuelles d'attentats analogues, mais aux suites beaucoup plus graves. Je finis malheureusement par perdre devant la Cour de Cassation. La doctrine de la Sécurité sociale n'était pas susceptible d'être remise en cause. Un accident survenu hors du lieu de travail ne peut être classé accident du travail que s'il survient pendant le trajet vers le lieu de travail, et non à domicile. Si j'avais été agressé sur mon palier en partant à mon bureau, c'eut été un accident du travail. Mais l'agression avait eu lieu regrettablement dans mon appartement.
Les contacts avec les policiers et le juge chargé de l'instruction par le parquet m'occupèrent beaucoup moins. Ni les uns, ni les autres ne parurent faire preuve d'un zèle excessif, et l'affaire fut rapidement classée, sans que les auteurs de l'agression aient été découverts. Ce ne fut que dix ans après que j'eus quelques lumières. Un journaliste du Nouvel Observateur réussit à interviewer un des auteurs de l'agression. Jeune étudiant issu de la Gauche prolétarienne, dissoute en1974 après avoir animé pendant cinq ans l'action des maoïstes français, il avait plus ou moins fréquenté des groupes d'étudiants et de prolos gauchistes sans perspectives politiques ni programmes bien précis. Avec quelques camarades, visiblement tous étudiants d'après leur allure au cours de l'agression, ils avaient décidé d'organiser une action symbolique, dont j'avais été la cible, bien que je n'aie pu jouer aucun rôle, même lointain, dans l'accident de Liévin.
Détail piquant relaté par l'étudiant interviewé: Au cours de leur action, ils avaient remarqué sur ma table de nuit le livre de Maurice Clavel. Les paroissiens de Patente, relatant la lutte des ouvriers de Lip pour la sauvegarde de leur emploi. Cet ouvrage et son auteur étaient réputés de tendance gauchiste. Ils durent penser qu'ils n'avaient pas choisi une cible vraiment réactionnaire, et cela les troubla un peu. Quoi qu'il en soit, je pensais pour ma part que les journalistes étaient plus malins pour débusquer les jeunes terroristes que les policiers et les juges. Finalement, ma seule cause de satisfaction dans cette aventure fut la réprobation unanime par les syndicats de mineurs de l'attaque dont j'avais été l'objet.
Depuis le départ de J. Desrousseaux, j'assumais la présidence du conseil de surveillance de CDF Chimie, ce qui me conduisait à suivre d'encore plus près ses activités. Au moment de sa création, un vapocraqueur avait été construit à Carling, pour assurer l'approvisionnement en matières premières des fabrications de matières plastiques. En 1975, le marché se développant, le lancement d'une nouvelle unité sembla d'actualité. CDF Chimie conclut un accord avec l'Etat du Qatar pour la construction d'une raffinerie au Qatar, la fourniture par celle-ci des produits pétroliers nécessaires, et la construction en commun d'un vapocraqueur à Dunkerque. Mais à la fin de l'année, le marché de la chimie de base amorça un net déclin, et nous amena à conclure que l'opération envisagée était prématurée.
Norbert Ségard, député du Nord, un homme d'habitude aimable, mais pour qui la construction du vapocraqueur de Dunkerqe était un enjeu électoral important, s'éleva contre cet abandon. Il tint à J. Petitmengin des propos discourtois, et excita le ministre d'Ornano à ce sujet. Lorsque Jean Mattéoli, alors président des CDF,et moi-même nous sommes présentés devant le ministre pour lui annoncer notre renonciation, nous avons eu droit à une algarade et à l'injonction de maintenir notre projet.
|
Jean Mattéoli, résistant et déporté, avait été directeur des relations extérieures des HBNPC durant ma direction générale du bassin, puis commissaire à la conversion industrielle pour la région Nord-Pas-de-Calais. En 1973, il devint président des CDF, puis ministre du travail et de la participation de 1979 à 1981, enfin président du Conseil économique et social depuis 1987.
|
J'opposai alors au ministre que nous n'avions pas les fonds nécessaires pour lancer une opération conjoncturellement risquée et donc à rentrée financière douteuse. Ainsi je ne reprendrai le projet, sur lequel je maintenais mes réseves, que s'il procurait à CDF Chimie, par l'intermédiaire des CDF, les fonds nécessaires. Le ministre me donna des assurances . Mais lorsque le projet fut lancé, ces assurances s'avérèrent promesse de gascon et, comme je le craignais, une situation de marché de plus en plus médiocre nous obligea à limiter temporairement la réalisation du projet, qui comportait heureusement deux tranches, à celle de la première.
J'eus encore un sujet de litige avec M. d'Ornano, la succession de M. Hecquet directeur général des HBNPC, qui prenait sa retraite en 1976. Depuis un certain temps, j'avais prévu que cette succession pourrait être assurée par Jacques Ragot, qui avait dirigé le groupe d'Hénin-Liétard, puis avait rejoint M. Hecquet, comme adjoint à la direction générale. Cette fois, la décision était à prendre par le gouvernement, mais après une procédure débutant par une proposition du directeur général des CDF, suivie de l'avis des conseils d'administration du bassin et des CDF. Lorsque j'allai parler du problème au ministre, il m'exposa qu'il y avait trois solutions: une candidature extérieure à la profession; une candidature professionnelle mais extérieure au bassin; et enfin un choix dans le bassin lui-même. Ses prérences se situaient dans l'ordre énoncé. Je lui répliquai que mon propre classement allait dans l'ordre inverse, et que je souhaitais la nomination de J. Ragot. Le ministre, ayant vérifié lui-même la procédure, conclut à regret qu'il n'y avait pas de solution en dehors d'un accord entre lui et moi, ce que je confirmai.
L'affaire fut mise en délibéré et, au départ de M. Hecquet, il n'y avait pas de successeur nommé. J. Ragot dut, par la force des choses assurer la direction par intérim. La situation n'était pas confortable pour autant. La profession sentait mon autorité contestée par le gouvernement. Je voulais envoyer en Lorraine, comme adjoint de R. Coeuillet, avec droit de succession, Eugène Maurin, qui dirigeait jusqu'alors les Houillères de Provence. Il ne manqua pas de me faire remarquer que mes promesses étaient sous bénéfice d'inventaire, puisque je n'étais pas sûr de leur ratification par le gouvernement. La discipline professionnelle jouant, il accepta pourtant. Quant à la situation des HBNPC, elle se dénoua, mais au bout de plusieurs mois. Le ministre finit par admettre qu'en raison du long intérim de J. Ragot, il était devenu difficile de lui contester le titre.
Un nouveau désaccord avec les décisions gouvernementales intervint en septembre 1977. Le chômage commençait à se manifester, la crise pétrolière ayant cassé les fermes tendances des "trente glorieuses". Le gouvernement décida de suspendre toute immigration de main d'oeuvre étrangère. J'allai trouver Lionel Stoléru, un jeune camarade de corps, alors secrétaire d'Etat à l'emploi, pour obtenir une dérogation en faveur des ouvriers marocains des Houillères. Ces ouvriers n'étaient embauchés que sur contrats temporaires, puis rentraient au Maroc et n'étaient remplacés qu'en fonction stricte des besoins. Toute interdiction allait perturber ce processus bien rodé. Je n'obtins pas satisfaction. Il en résulta ce qu'on pouvait craindre. Les exploitants ne pouvant se passer de cette main d'oeuvre s'efforcèrent de fixer les ouvriers marocains présents aux effectifs. Ceux-ci, ne pouvant plus se faire relayer par d'autres membres de leurs familles, furent fortement incités par celles-ci à rester pour ne pas perdre cette source de revenu.
La situation se figea, les ouvriers marocains ainsi stabilisés demandèrent et obtinrent le bénéfice du statut du mineur, qu'ils ne songeaient même pas à revendiquer jusque là. Ils demandèrent et obtinrent le droit de faire venir leur famille et de disposer d'un logement, alors qu'ils vivaient dans des résidences de célibataires tant que leur séjour était de courte durée. Lorsque dix ans plus tard, l'exploitation des HBNPC approcha de son terme, il fallut procéder à de laborieuses négociations avec les autorités consulaires marocaines, et consentir à cette main d'oeuvre des primes de rapatriement importantes, alors que la situation se fût dénouée sans problème sans cette regrettable décision de 1977.
J'eus un problème d'un tout autre ordre avec André Giraud, un autre camarade de corps, ministre de l'industrie qui avait succédé à M. d'Ornano. Les perspectives de l'industrie sidérurgique s'étaient sensiblement réduites. La gestion des exploitations charbonnières de la Ruhr avaient été regroupée dans une société unique, la Ruhrkohle, et la société Harpen, contrôlée par Sidéchar, ne gérait plus que des participations industielles non minières. La Chambre syndicale de la sidérurgie et les CDF estimèrent que leur participation majoritaire dans cette société n'avait plus d'objet et en décidèrent la cession. La candidature la plus sérieuse à la reprise fut celle de Paribas. Les sidérurgistes s'en remirent à moi pour la négociation. Celle-ci dura plusieurs semaines et aboutit à un prix de cession convenable pour les deux parties.
L'affaire n'était cependant pas terminée. Après l'accord entre Paribas et les actionnaires de Sidéchar, une société d'investissement, Nord-Est, se manifesta tardivement en surenchérissant sur le prix convenu. A. Giraud me signifia que je devais dénoncer l'accord avec Paribas et accepter l'offre de Nord-Est. J'objectai que, lorsque, après la conclusion d'une soumission ou d'une vente aux enchères, un nouvel enchérisseur se manifestait, la règle était de l'éconduire. Mais A. Giraud maintint sa position. Nord-Est devait être poliiquement bien introduit. Comme toute cession par les CDF d'une participation, ainsi d'ailleurs que toute acquisition, doit être approuvée par le gouvernement, je n'avais aucun moyen de résister, et je dus obtempérer. Certes cela me permit d'encaisser, ainsi que mes associés sidérurgistes, un montant un peu plus élevé, mais dans la mesure où cet épisode me déconsidérait comme négociateur industriel, je trouvai cher le prix.
J'eus encore à regretter les positions gouvernementales dans une des dernières affaires que j'eus à traiter, peu avant mon départ de l'entreprise charbonnière. La mine de Carmaux, dans le Tarn, haut-lieu du parti socialiste, avait été un fréquent objet d'agitation syndicale. L'arrêt progressif de l'exploitation souterraine avait finalement, et non sans mal, été admise par la personnel. Mais on avait reconnu, non loin de cette mine, une partie de gisement relativement importante et dense qui, sans vraiment affleurer,était suffisamment proche de la surface pour que son exploitation en découverte ne fût pas inconcevable.Une préétude tendit à montrer que l'opération se situerait juste en limite de rentabilité. Je savais d'expérience que ce genre d'évaluation aboutit toujours à des conclusions trop optimistes, donc que l'exploitation serait à coup sûr déficitaire. Le montant de l'investissement nécessaire me paraissait au surplus disproportionné au regard du nombre d'emplois sauvegardés. Je fis part de ces conclusions à ma tutelle, la direction générale de.l'énergie. J'ajoutai que je croyais devoir renoncer à une étude approfondie, qui ferait naître dans la population minière des espoirs excessifs, et rendrait très difficile, quelles que soient ses conclusions, de renoncer à l'opération.
A ma surprise, les autorités gouvernementales, le plus souvent enclines à stopper toute décision nouvelle susceptible d'accroître le déficit des Houillères, rejetèrent ma conclusion, et m'enjoignirent de poursuivre l'étude ; il y avait cette fois encore un lobby politique agissant. Comme je l'avais prévu, les effets ont suivi. Après mon départ des CDF, l'étude, bien que peu encourageante, aboutit, sans qu'aucune discussion soit possible, au lancement des investissements et à la mise en exploitation. Les résultats financiers furent rapidement désastreux, et il fut nécessaire de mettre un terme à l'opération bien avant que la totalité du charbon en place ait pu être extraite.
J'eus cependant, à la fin de ma présence aux CDF, une occasion de négociation avec le gouvernement beaucoup plus satisfaisante. Au début de 1978, sous l'impulsion du directeur du budget Desroches, un homme intelligent, qui savait faire preuve aussi bien de fermeté que de souplesse, et pour qui j'avais une grande estime, il fut décidé de conclure entre l'Etat et les CDF un contrat d'entreprise de trois ans, qui établirait plus précisément les droits et obligations de l'entreprise, tout en lui assurant une plus grande liberté de gestion.
Les CDF obtenaient, pour la première fois de leur histoire, la liberté de fixation de leurs prix de vente qui, malgré les clauses précises du traité de la CECA, était jusque là constamment battue en brèche par le gouvernement. Ils devaient recevoir chaque année une aide financière de l'Etat, dont les bases de calcul étaient fixées forfaitairement dès le point de départ du contrat. En contrepartie, les CDF s'engageaient à assurer leur équilibre financier pendant cette période. Ces clauses, assorties de quelques dispositions complémentaires, affermissaient la responsabilité de gestionnaire de l'établissement, et précisaient ses relations avec l'Etat. J'eus la satisfaction que ce contrat soit intégralement respecté pendant ses trois années d'application, qui se trouvèrent précéder mon départ. D'une manière regrettable, Desroches et moi ayant disparu de la scène, cette heureuse procédure ne fut pas reconduite.
Mon activité très absorbante aux CDF ne me fit pas renoncer à suivre, avec Janine, la conférence mondiale de l'énergie, dont les sessions m'offraient une détente bien utile. En août 1968, c'est à Moscou que se tint la nouvelle session, dérivatif bienvenu après les péripéties du mois de mai. Mais cette session ne fut pas de tout repos. C'est pendant son cours que les troupes de l'URSS et de ses alliés envahirent la Tchécoslovaquie à la suite du printemps de Prague. Bien entendu cet événement causa une intense émotion parmi toutes les délégations occidentales présentes à Moscou. Chacune se précipita dans son ambassade pour demander des instructions sur la conduite à tenir. Certaines furent priées de regagner leur pays; d' autres de s'abstenir de participer aux réceptions; d'autres encore de battre froid aux membres russes de la conférence. Quant à notre délégation, elle ne trouva pas l'ambassadeur qui, absent de Moscou, ne jugea pas utile d'y revenir. Les services de l'ambassade furent hors d'état de nous prodiguer le moindre conseil ou instruction. Nous avons donc prolongé notre participation, sans montrer trop de chaleur à nos hôtes russes.
Ceux-ci n'avaient nulle expérience d'une conférence rassemblant, comme la notre, 5000 personnes. L'organisation respirait l'improvisation. Nous étions logés à l'hôtel Rossia, avec le statut d'hôtes de première classe. A ce titre, nous avions droit, deux heures par jour, à une voiture, un chauffeur et un guide, pour visiter Moscou. Les séances importantes ayant lieu le matin, et les réceptions en fin de journée, c'est au début d'après-midi que tous les congressistes se présentaient en même temps au bureau d'accueil pour obtenir voiture et accompagnateurs. Il en résultait une joyeuse pagaille. Un jour, ayant obtenu la voiture et une guide, le chauffeur restait introuvable, si bien que la jeune guide, visiblement une collaboratrice d'occasion, recrutée comme beaucoup pour les besoins de la conférence, se mit à pleurer devant tant d'impéritie. Je dus la consoler avant que soit enfin récupéré notre chauffeur.
En 1971, nous sommes allés en Roumanie, pour une session sans grand relief à Bucarest. En 1974, nous nous sommes trouvés à la session de Détroit, où nous avons eu le privilège d'un discours de Gerald Ford, qui venait d'accéder à la présidence des USA après la démission de Richard Nixon. Nous avons ensuite participé à un voyage depuis Phoenix en Arizona jusqu'à san Francisco, à travers le Nevada et la Californie, en passant par des sites célèbres tels que le grand canyon du Colorado, Las Vegas et Los Angeles. Pour ne pas oublier le contexte de la conférence de l'énergie, nous sommes aussi passés par une mine de charbon. L'accès de la mine était pentu, et les superbes cars Grey hound dans lesquels nous voyagions se montrèrent bruquement poussifs. Nous avons du descendre de voiture, et avons échappé de justesse à la nécessité de pousser les cars pour achever la montée. La direction de la mine avait, pour principales préoccupations, la remise en état du site après exploitation et la promotion sociale des indiens navajos qui en constituait la main d'oeuvre.
En 1977, ce fut la session d'Istambul qui nous accueillit. Nous avions déjà voyagé en Turquie en 1970, visitant, outre Istambul, une grande partie de l'Anatolie occidentale et centrale Aussi, après la conférence et un voyage de groupe qui nous amena des barrages du haut Euphrate à Diyarbakir, nous avons avec une voiture de location, un chauffeur et un guide, parcouru le sud de l'Anatolie orientale. En 1980, j'ai participé, pour la dernière fois à une session de la conférence à Munich.
Quelques nouvelles fonctions marquèrent aussi les dernières années de ma présence aux Charbonnages. J'eus à assurer la présidence de la commission pour l'amélioration des conditions de travail, où siégeait en particulier, comme représentante du ministre du travail, Martine Aubry, alors une jeune femme plutôt timide, ce qui semble lui avoir passé depuis.
J'ai présidé aussi, pendant plusieurs années, à la même époque, le comité national pour le développement des Grandes Ecoles, organisme qui avait été fondé après mai 1968, à un moment où l'existence de celles-ci, en tout cas leur autonomie, paraissaient menacées par l'impérialisme de l'Education nationale. Ce comité rassemble des directeurs de Grandes Ecoles, des représentants des associations d'anciens élèves, et des industriels. Il s'occupe de la défense administrative et politique des Ecoles, mais aussi de la coordination des positions des directions et des entreprises vis avis de l'orientation des études et de la formation dans les Ecoles..
En 1980, A. Giraud me convoqua pour me dire que le renouvellement de mon mandat n'allait pas de soi. Le propos était mal ciblé, puisque la nomination du directeur général des CDF était statutairement sans terme fixe, donc qu'aucun renouvellement de mon mandat n'était au calendrier. Mais cela signifiait en clair qu'après douze ans à la direction des CDF, le gouvernement et l'Elysée m'avaient assez vu dans cette position. Les litiges dont j'ai parlé pouvaient avoir joué un rôle dans cette réaction. Mais plus généralement, les gouvernants n'aiment pas voir perdurer les attributions de charges publiques, craignant qu'elles génèrent à la longue des attitudes proconsulaires. V. Giscard d'Estaing, président de la république, était d'aileurs en train d'imposer des dispositions pour limiter systématiquement la durée des fonctions des dirigeants d'entreprises publiques. Il avait au surplus fait bloquer les rémunérations de ces dirigeants pendant deux ans.
Dans cette ambiance, je n'étais pas enclin à m'incruster davantage dans mes fonctions, et n'étais donc pas tenté d'organiser une résistance, pour peu qu'on m'offre une sortie honorable. A. Giraud m'aurait volontiers fait attribuer une présidence, mais celles auxquelles il avait songé étaient bloquées ou réservées. Finalement on m'offrit d'entrer au Conseil d'Etat, ce qui ne me déplaisait pas. Je pensais que vers la soixantaine, il n'était pas mauvais de quitter des responsabilités de gestionnaire pour des activités de réflexion et de conseil. Je souhaitais seulement qu'il s'agisse d'une nomination au tour extérieur, qui vous place dans le même statut que les conseillers d'Etat nommés par promotion interne, et non, comme on me le proposait d'abord, d'une situation de conseiller d'Etat en service extraordinaire, qui n'a qu'une durée de cinq ans, et ne donne que des prérogatives limitées par rapport au service ordinaire.
Grâce à l'appui d'A. Giraud et aux interventions énergiques de J. Mattéoli, je fus finalement nommé, à la fin de 1980, conseiller d'Etat au tour extérieur. A. Giraud demanda aux CDF de m'accorder un contrat de conseil, pour couvrir la perte de rémunération découlant de ma nouvelle situation. Il obtint aussi, pour reconnaître les services que j'avais rendus à la tête de la profession charbonnière, dans la situation difficile liée à la récession, ma promotion au grade de commandeur de la légion d'honneur.
Le Conseil d'Etat
Je pris place dans le "tableau", c'est à dire l'ordre de classement des conseillers, et découvris à cette occasion que cet ordre était immuable, l'avancement se faisant strictement à l'ancienneté. Seules les nominations du vice-président et des présidents de sections restent à la discrétion du gouvernement. La place de chacun dans la grande salle de l'assemblée générale correspond à l'ordre du tableau. Non seulement cet ordre détermine le rang où l'on siège, mais dans ce rang le plus ancien est au milieu, le suivant immédiatement à sa droite, le suivant à sa gauche, et ainsi de suite. A l'occasion de chaque départ pour détachement, démission ou retraite, tous les suivants dans le tableau changent de place pour maintenir cet ordre, et l'on erre un moment à la recherche de son nouveau fauteuil.
Quand je me suis retrouvé sous l'or et les lambris du Palais-Royal, j'ai constaté que je n'aurais pu changer plus complètement de conditions matérielles de travail. Quittant une situation où je disposais, comme tout dirigeant d'entreprise, d'un grand nombre de commodités, bureau, secrétariat, voiture et chauffeur, collaborateurs m'assistant pour toutes mes obligations, je me suis retrouvé nu comme Job. Un conseiller d'Etat n'a ni secrétaire ni bureau, ni téléphone. (La photocopieuse venait seulement, quand j'arrivai au Conseil, d'entrer dans les usages, et des téléphones mobiles reliés au standard n'apparurent que quelque temps après. Des secrétariats de sections, d'usage commun, permirent aussi de disposer progressivement, et pour un usage discret, de sténodactylos).
Le Conseil d'Etat est en effet un somptueux palais, avec de très belles salles de séance, mais en dehors des services administratifs, il n'y a de bureaux que pour le vice-président et les présidents de sections. Les membres ordinaires travaillent à la bibliothèque, honteusement encombrée de leurs dossiers, dans quelques salles banalisées, ou chez eux.
Corrélativement, après avoir eu sous mon autorité un effectif de 100.000 personnes, et m'être senti responsable de leur devenir professionnel et de leur situation sociale, je n'avais plus le moindre agent sous mes ordres, pas même une secrétaire ou un chauffeur. C'était très inconfortable à certains égards, mais très reposant à beaucoup d'autres. En fait le métier de conseiller d'Etat s'apparente à une situation de profession libérale. Le Conseil d'Etat n'est pas, ou si peu, une organisation hiérarchisée. En dehors de la distribution du travail, personne ne donne d'ordres. On propose, on demande, on suggère. Le mécanisme décisionnel diffère totalement de celui des entreprises. Dans celles-ci, les problèmes importants sont étudiés par plusieurs personnes et services; les conclusions remontent à un responsable qui prend la décision finale. Au Conseil d'Etat, l'étude initiale des dossiers est faite par un seul rapporteur; par contre les décisions sont toujours collégiales, dans le cadre d'une section ou de l'assemblée générale.
A mon arrivée au Conseil d'Etat, j'ai été affecté à une sous-section du contentieux. Tout nouvel arrivant, à l'exception des conseillers en service extraordinaire, débute par le contentieux, qu'il vienne de l'ENA ou du tour extérieur. La section du contentieux comporte dix sous-sections. Deux d'entre elles sont spécialisées dans le droit fiscal. Les autres traitent le contentieux général, c'est à dire toutes les autres affaires. Je me présentai à François Gazier, président de la 4ème sous-section qui m'accueillait. Il m'informa des conditions de travail, me mit en mains quelques affaires simples pour commencer ma formation, et me désigna un mentor, en l'occurence Jean Massot, qui devait me donner les conseils nécessaires lorsque je serais embarrassé.
Je ne fus pas très longtemps dépaysé par le droit administratif. Son mode de raisonnement déductif s'apparente assez au raisonnement mathématique. Au surplus, il s'agit essentiellement d'un droit procédural. Le contenu concret des dossiers peut concerner toutes les catégories de droit: droit civil, droit commercial, droit social, droit économique, urbanisme, fonction publique, responsabilité de la puissance publique, etc. Personne ne peut être à la fois un spécialiste de chacun de ces droits. Toute étude de dossier nécessite donc, pour les plus anciens comme pour les novices, de se plonger dans les textes, dans la doctrine, et surtout dans la jurisprudence. Celle-ci joue en effet un très grand rôle, la loi étant loin de résoudre, surtout dans le domaine de la juridiction administrative, tous les problèmes qui se posent. Compte tenu de cette complexité, il arrive parfois qu'un "jeune", comme moi, puisse en remontrer, sur un dossier particulier, à un conseiller chevronné. C'est toujours une satisfaction d'amour-propre.
L'étude d'un dossier se termine par la rédaction d'une note et d'un projet de décision. Après examen par un assesseur de la sous-section, qui joue le rôle de réviseur, le projet est discuté par la sous-section, puis étudié par un commissaire du gouvernement (désignation maintenue par la tradition, mais tout à fait inappropriée, puisqu'il s'agit d'un membre du Conseil, sans aucune attache avec le gouvernement) , qui expose ses conclusions devant une formation de jugement. Ce peut être, suivant l'importance de l'affaire, deux sous-sections réunies, la section du contentieux elle-même, ou enfin l'assemblée du contentieux, présidée par le vice-président, et qui est normalement réservée aux affaires requérant une novation jurisprudentielle.
Après F. Gazier, j'eus successivement, à la 4ème sous-section, deux présidents du sexe féminin, Suzanne Grévisse et Nicole Questiaux. Cela apportait incontestablement un enrichissement aux débats. N. Questiaux, qui avait été ministre de la solidarité nationale, s'était alors fait brocarder en déclarant, à propos de la Sécurité sociale, qu'elle ne s'intéressait pas à la comptabilité. Un jour, à l'occasion d'un recours contre les résultats d'un examen de comptabilité, elle s'en remit à un des assesseurs de la direction des débats, en rappelant avec humour qu'elle ne connaissait rien à la comptabilité. Il faut d'ailleurs noter à ce propos que dans le domaine de la fonction publique, le Conseil avait progressivement, et avec un certain laxisme, déclaré recevables les recours les plus insignifiants, par exemple celui d'un fonctionnaire contestant la baisse d'un demi-point de la note inscrite annuellement à son dossier.
Au bout d'un an, j'eus vocation à être nommé membre d'une section administrative, et Roger Grégoire me demanda d'entrer à la section des travaux publics qu'il présidait, mais plus pour longtemps. Il prit sa retraite peu après et fut successivement remplacé par Jacques Ducoux et Femand Grévisse. Les sections administratives ont pour principale attribution l'examen, assorti d'un avis et, s'il y a lieu, d'un contre-projet, des projets de loi et des projets de décrets les plus importants présentés par le gouvernement, et relevant de leur compétence. Cette compétence couvre, pour la section des travaux publics, les activités des ministères des travaux publics, de l'industrie, de l'agriculture, des transports et de l'environnement.
En matière législative l'avis du Conseil n'est que consultatif et le parlement reste évidemment libre de ses délibértations, au seul risque peu fréquent d'une censure du Conseil constitutionnel. Pour ce qui est par contre des décrets, si le gouvernerment n'est pas lié non plus par l'avis du Conseil d'Etat, il risque, en ne le suivant pas, une annulation au contentieux, si un recours en excès de pouvoir est présenté contre le texte finalement retenu. L'avis est donc généralement suivi. Parmi d'autres attributions, la section des travaux publics doit approuver les déclarations d'utilité publique des ouvrages importants, et les décisions concernant les concessions minières, pour lesquelles j'étais souvent rapporteur.
Quand on entre au Conseil d'Etat vers la soixantaine, comme c'était mon cas, on est fatalement soupçonné d'y venir chercher une sinécure de fin de carrière. Si l'on joue le jeu, et qu'on fait les efforts nécessaires pour apprendre ce nouveau métier et le pratiquer activement, on jouit par contre d'une certaine considération, et vos collègues s'intéressent à l'apport de votre formation et de votre carrière antérieure. En entrant à la section des travaux publics, j'aurais pu être libéré de mon activité au contentieux. Mais cette activité m'intéressait, et je demandais à la conserver, au prix bien entendu d'un supplément de travail. N. Questiaux, qui prit la présidence de la 4ème sous-section en 1983, me demanda, à l'initiative du président de la section, Claude Heumann, d'en devenir accesseur, ce qui était reconnaître la rapidité de mon acquit en droit administratif.
Le contentieux administratif était victime en cette période, comme d'ailleurs toutes les activités judiciaires, d'une marée montante, à laquelle il était difficile de faire face, malgré les efforts pour accélérer l'instruction des affaires. Aussi le vice-président créa une commission chargée d'étudier les modalités d'une réforme plus importante du contentieux. On me demanda d'en faire partie. Je manifestai un certain étonnement, en rappelant la fraîcheur de mes connaissances contentieuses. On me répondit: "Justement, vous ne serez pas prisionnier des vieilles ornières". Cela dénotait la volonté de renouveau des autorités du Conseil. Les travaux de cette commission aboutirent, mais après mon départ, à la création de cours administratives d'appel, placées entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'Etat, et destinées à libérer celui-ci d'une part importante des recours en appel qui jusqu'alors remontaient à lui.
En mai 1981, j'ai été nommé président de la commission interministérielle des radioéléments artificiels, la CIREA. Cette commission est statutairement présidée par un conseiller d'Etat. Mes compétences en matière énergétique avaient évidemment présidé à ce choix. La commission comprend des représentants de tous les ministères intéressés. Elle émet un avis sur les textes réglementaires concernant l'emploi des radioéléments. Mais son rôle principal est de se prononcer sur les autorisations de production, de cession, d'importation, d'exportation et d'emploi des radioéléments, en veillant essentiellement aux conditions de sécurité de ces activités.
En créant cette commission par une ordonnance de 1959, le gouvernement a eu le souci de s'épargner une dépense budgétaire, en chargeant le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, d'assurer le secrétariat de la CIREA. Cela n'est pas sans inconvénient, puisque le CEA est un des organismes contrôlés par la CIREA, et que le secrétariat est ainsi dans une position de juge et partie. Surtout, le secrétariat dépend du bon vouloir du CEA pour obtenir les moyens nécessaires en personnel et en matériel. En cas de réticence, le président ne dispose que d'une possibilité de recours au premier ministre, évidemment exceptionnel et d'ailleurs problématique dans ses effets. La CIREA a une autre singularité. Pour les emplois de radioéléments en médecine et en biologie, elle fonctionne comme toute commission consultative, et la décision relève du ministre de la santé. Pour tous les autre emplois, dans l'industrie, les travaux publics, la consommation alimentaire, etc, la décision relève du président de la commission, moi-même en l'occurence, qui se trouve ainsi dans la position dite d'autorité administrative indépendante, en disposant bien entendu d'une possibilité de délégation au secrétaire permanent.
En juin 1985, toujours dans la mouvance du Conseil d'Etat, j'ai été nommé président de la commission d'aide aux riverains des aéroports. Cette commission, compétente pour Orly et Roissy, alimentée budgétairement par une taxe sur les mouvements des avions, est chargée de l'attribution des aides financières aux riverains dont les logements, lorsqu'il s'agit de particuliers, ou les établissements pour les écoles et les hôpitaux, nécessitent une insonorisation en raison de la trop grande proximité des pistes. Ces aides sont bien entendu soumises à une réglementation précise, insuffisante cependant pour régler tous les cas particuliers et les problèmes de détail. Un des rôles importants de la commission fut donc d'établir une véritable jurisprudence pour régler ces problèmes.Les propositions d'aide étaient alors soumises à la direction de l'aéroport de Paris qui gérait le fonds d'aide, et prenait les décisions en dernier ressort, mais suivait pratiquement toujours l'avis de la commission.
En 1980, et dans un contexte différent, j'ai été nommé président du conseil de perfectionnement de l'école des mines de Paris, dont j'avais été élève, et quelque temps après de celui de l'école des mines de St Etienne, ce qui m'amenait à des déplacements périodiques dans cette ville et cette école, dont j'avais accidentellement suivi les cours. J'avais aussi à suivre les activités d'Armines, association pour la recherche et le développement des méthodes et processus industriels, qui avait été créée, à côté des écoles des mines, pour gérer des contrats de recherche appliquée souscrits par des industriels, que les écoles ne pouvaient juridiquement conclure elles-mêmes, et dont les produits apportaient une contribution importante au financement de leurs laboratoires de recherche. L'activité de cette association soulevait périodiquement les soupçons du ministère des finances et de la Cour des comptes, et nécessitait de laborieuses discussions avec eux. En 1984, Pierre Laffitte qui allait devenir sénateur des Alpes maritimes, quitta la direction de l'école des mines des Paris et je lui en cédai la présidence, ainsi que celle de l'école de St Etienne un peu plus tard.
Je ne devais pas non plus négliger mon activité de conseil aux CDF, et je tenais à ce que le travail que j'effectuais à ce titre justifie la rémunération que j'en tirais, et ne puisse laisser place au moindre soupçon de "recel d'abus de biens sociaux", même si ce type d'accusation, à l'étrange intitulé, était encore fort rare à l'époque, au regard des nombreuses affaires de l'espèce qu'on a vu fleurir, au cours des années plus récentes, dans les directions des grandes entreprises ou des administrations. Les études qui m'occupaient concernaient souvent l'activité de la Commission de Bruxelles, en tant qu'elles intéressaient les charbonnages, ou les conditions de concurrence dans les industries pratiquées par les CDF, notamment la chimie. Je suivais également, pour le compte des CDF, les travaux du Comité national pour le développement des grandes écoles, dont j'avais été président pendant quelques années.
J'acceptai aussi en 1984, avec l'accord du vice-président, une mission d'arbitrage en Algérie. La société algérienne qui avait succédé aux sociétés françaises pour l'exploitation du pétrole et du gaz sahariens avait réalisé à Arzew, près d'Oran, un terminal pétrolier, complété par une usine de production d'ammoniac à partir du gaz d'Hassi R'mel. Cette dernière réalisation avait eu pour maître d'oeuvre un groupement de deux sociétés françaises d'ingénierie, Creusot-Loire-lndustrie et Technip. Les difficultés techniques de mise au point de l'usine donnèrent lieu à un litige entre la société algérienne et ses contractants, et à une suspension des paiements. Ma mission consistait donc à situer et répartir les respnsabilités. J'étais heureusement accompagné de deux techniciens, avec lesquels je m'installai à Arzew por une semaine avant d'aller, après rédaction de mes conclusions, en discuter avec le ministre de l'industrie algérien. En marge de ce travail d'expertise, j'eus l'occasion de nombreuses conversations avec des cadres algériens. L'Algérie était alors politiquement calme, et je fus surpris des craintes qu'ils exprimaient sur la poussée du fondamentalisme musulman, qu'on ne percevait pas encore en France. La suite des événements devait, hélas, amplement justifier leurs appréhensions.
En dehors de ses studieux travaux, la section des travaux publics organisait parfois des déplacements, auxquels les conjoints étaient conviés. Nous avons ainsi participé, avec Janine, à une descente du Rhin, à un voyage en Alsace, à une excursion dans le Mercantour. Ces petits voyages avaient toujours pour fondement, les mauvaises langues diraient pour prétexte, un objet professionnel. Il s'agissait de s'informer sur un parc en voie de classification, sur un vin à qualifier, etc, avant avis à formuler par la section. Bien entendu, l'essentiel du voyage restait touristique.
En 1983, Janine fut élue conseiller municipal de Cannes sur la liste d'Anne-Marie Dupuy, ma collègue au Conseil d'Etat, qu'elle avait connu à ce titre, mais aussi à Cannes où elle préparait sa candidature. Janine fut désignée comme adjoint, chargée de l'urbanisme et de la circulation. Ce mandat municipal expirait en 1989. Je devais moi-même quitter le Conseil d'Etat cette année-là, à soixante-huit ans, âge de la mise à la retraite au moment de mon entrée au Conseil. Et nous nous félicitions de cette coïncidence dans la fin de nos vies professionnelles actives respectives. Malheureusement, l'âge de la retraite pour les membres des grands corps de l'Etat, qui avait déjà été ramené de soixante-dix à soixante-huit ans pendant la présidence de Giscard d'Estaing, fut encore abaissé à soixante -cinq ans pendant celle de Mitterand. Cette mesure fut particulièrement critiquée au Conseil d'Etat, où elle allait priver les sections administratives, dont la jurisprudence est largement verbale, de leurs membres les plus anciens qui en étaient la mémoire vivante. Quoiqu'il en soit, j'étais immédiatement touché par cette nouvelle disposition, qui me conduisait à quitter le Conseil en juillet 1986.A vrai dire, c'était l'année d'un changement de majorité parlementaire et de la première cohabitation. Il fut immédiatement annoncé que le nouveau gouvernement allait revenir sur ce régime de retraite, et l'on m'assura que je pourrais regagner le Conseil peu après l'avoir quitté. Effectivement les conseillers d'Etat furent habilités, avec seulement quelques restrictions de capacité, à demeurer au Conseil en surnombre entre soixante-cinq et soixante-huit ans. Mais lorsque fut évoqué le cas des quelques conseillers qui, comme moi, avaient dû partir dans l'intervalle des deux décisions, l'administration compétente, bien qu'ayant examiné le problème avec une apparente bonne volonté, déclara qu'il était déjà laborieux de mettre un fonctionnaire à la retraite, mais que pour l'en faire revenir, elle ne savait pas faire. C'est ainsi que je restai retraité et que je dus attendre trois ans que mon épouse me rejoigne dans cette situation.
En retraite
Peu après, le ministre de l'environnement, toujours Alain Carignon, et le ministre de l'industrie, André Giraud, me chargèrent d'une autre étude sur le régime juridique d'exploitation des carrières. Ce régime manquait en effet de cohérence, relevant à la fois du code minier et de la loi de 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. L'ossature générale de ces deux législations était heureusement la même, mais des divergences non négligeables apparaissaient. Lorsque c'était le cas, j'ai proposé ce qu'il convenait de retenir de chacune de ces législations, mais en conservant le code minier comme cadre général. Le problème soulevait incidemment un conflit d'attribution entre les deux ministères. Il s'agissait de savoir qui resterait ministre de tutelle à titre principal. Aussi bien, et contrairement à mon précédent rapport, celui-ci resta des années sans aboutir à une mise au point législative.
En 1989, une dernière mission du même type me fut confiée par le ministre de l'industrie, Roger Fauroux. Un groupe de travail présidé par mon camarade de corps Pierre Faurre avait travaillé sur une éventuelle réforme des Ecoles des mines, placées sous l'autorité du ministre de l'industrie. J'étais chargé de préciser le projet et d'examiner sa faisabilité, en m'appuyant sur l'expérience que j'avais acquise en présidant quelques années auparavant les Ecoles de Paris et de St-Etienne. Dans mon rapport, je déconseillais la transformation envisagée des Ecoles, alors services extérieurs du ministère de l'industrie, en établissements publics, et préconisais par contre la transformation de l'association pour la recherche Armines en société anonyme.
Je conservais la présidence de la CIREA. L'épisode le plus saillant, pendant cette période, fut un litige avec la Commission de Bruxelles. Une société néerlandaise souhaitait vendre en France des moissonneuses-batteuses équipées d'un compteur des quantités récoltées, actionné par une source radioactive. Je fis obstacle au nom de la CIREA à ces importations. Deux thèses juridiques s'affrontaient: celle de la Commission qui défendait la libre circulation des produits au sein de l'Union européenne; celle de la CIREA qui, s'appuyant sur le traité de la CEE, qui maintient une compétence des Etats en matière de sécurité et d'hygiène, estimait que l'avantage assez réduit procuré par ce dispositif ne justifiait pas les risques radioactifs introduits dans le milieu agricole, où le contrôle en serait malaisé. Malgré les pressions de la société néerlandaise, la Commission dut renoncer à nous imposer l'importation de ces machines. Un autre problème original concerna l'implantation par EDF, l'hiver en montagne, de compteurs de l'épaisseur de la neige, destinés à prévoir les ressources hydrauliques qui seraient disponibles au moment de la fonte des neiges. Les dispositions pour protéger le public des irradiations des sources qui équipaient ces compteurs furent longuement étudiées et mises en oeuvre.
Je conservais aussi la présidence de la commission d'aide aux riverains des aéroports. Mais, en novembre 1987, le Conseil d'Etat, sur recours du syndicat des transporteurs aériens, annula le décret de 1984 qui avait institué la redevance d'atterrissage alimentant le fonds d'aide. Cette redevance s'était elle-même substituée à une taxe parafiscale qui n'avait pas eu un meilleur sort. Après un fonctionnement provisoire sur le reliquat des fonds de ladite taxe, une loi du 31 décembre 1992 institua un nouveau régime. Le financement était cette fois légalement assuré par un taxe sur les décollages d'avions. Mais surtout le destinataire, et donc le gestionnaire des fonds, n'était plus l'Aéroport de Paris, mais l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, qui pouvait cependant conclure un convention avec l'Aéroport pour l'instruction des dossiers.
Ce nouveau régime entraîna des complications. La tutelle jugea que les dispositions jurisprudentielles, jusque-là adoptées par la commission et automatiquement approuvées par l'Aéroport, devaient être agréées par le conseil d'administration de l'ADEME. Or il se trouva que les membres de ce conseil devaient être renouvelés, et que le renouvellement était bloqué par un litige entre les ministres intéressés. Les mesures proposées par la commission se trouvèrent donc elles-mêmes bloquées. Mais à la fin de1997, mon mandat à la présidence de la commission prenait fin. Il ne fut pas renouvelé, sans d'ailleurs que Madame la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet, de qui dépendait dorénavant la nomination, ait cru devoir m'en informer directement. Ce sont les moeurs gouvernementales actuelles. Ceci dit, il était tout à fait normal que je quitte cette présidence que j'occupais depuis douze ans, laissant à mon successeur le soin de traiter les problèmes non réglés.
Entre temps, j'avais hérité d'une nouvelle présidence. Michel Rocard, nommé premier ministre après les élections présidentielles de 1988, créa par décret du 8 février 1989, sur proposition de Gérard Renon, un camarade du corps des mines, alors secrétaire d'Etat chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, le Collège de la prévention des risques technologiques. J'en fus nommé président le 20 février 1989. A la fin de 1991, Jean-Jacques Salomon, professeur au conservatoire national des Arts et métiers me succéda à la présidence, mais je restai membre du Collège.
La composition du collège traduisait la préoccupation de ne plus se contenter, pour développer une politique de prévention, des avis de techniciens souvent trop spécialisés et trop dépendants de la politique de leur ministère ou organisme d'affiliation. On trouvait au Collège des membres des grands corps de l'Etat, mais aussi des personnalités scientifiques et des représentants de la société civile: un syndicaliste, un journaliste, un sociologue, un médecin. Il était ainsi possible d'éclairer les diverses facettes des préoccupations de la société. Le gouvernement pouvait saisir le collège des questions sur lesquelles il souhaitait son avis. Mais le collège disposait aussi d'un pouvoir d'autosaisine et pouvait, de sa propre initiative, examiner toute question de sa compétence. En outre il pouvait décider de la publication de ses avis et recommandations.
Entre autres domaines, le collège suivit les problèmes de la politique nucléaire, et se prononça notamment en faveur de l'enfouissement profond des déchets de longue durée de vie, sur lequel le gouvernement ne cesse d'ailleurs de différer les décisions. Il s'intéressa aux biotechnologies. Laissant aux organismes à compétence médicale les applications à l'homme, il formula des recommandations pour limiter les risques de leurs applications dans le domaine agricole.
Mais il était fatal que les avis du collège comportent d'éventuelles critiques des politiques publiques. Aussi bien, la détermination de favoriser l'expression d'avis indépendants sur les risques encourus par notre société faiblit assez rapidement. Lorsque le collège critiqua l'insuffisance de l'étude de danger du passage du TGV Méditerrannée au voisinage des installations nucléaires de Pierrelatte, ou lorsqu'il nota que la remise en service de Superphénix, d'ailleurs suspendue depuis, n'était pas accompagnée d'une définition suffisamment précise des missions confiées à ce réacteur, il suscita de la mauvaise humeur. La tendance du gouvernement à consulter le collège déclina vite, et il ne travailla plus guère que par autosaisine, sans que ses avis, toujours transmis aux ministres concernés, aient beaucoup de suites. En fin de compte, par un article de deux lignes, curieusement inséré dans un décret de moindre portée juridique que le décret fondateur, et dont l'objet n'avair rien à voir avec le collège, le gouvernement d'Alain Juppé mit fin à son existence en mars 1996, sans aucune consultation préalable. Comme on ne peut supposer que les risques technologiques aient miraculeusement disparu, il faut bien admettre que le gouvernement ne peut plus supporter qu'un organisme indépendant puisse formuler publiquement critiques ou réserves sur ses décisions ou propositions. Un tel organisme est condamné à diparaître. C'est la version moderne des "Porteurs de mauvaises nouvelles".
Postface
On pourrait se demander pourquoi je suis resté pourtant imperturbablement, et si longtemps, dans le secteur charbonnier public. Ce n'est pas que les occasions d'en sortir m'aient manqué. Successivement, j'ai fait l'objet de propositions de l'entreprise Nord-Est dans la sidérurgie, de Kuhlmann dans la chimie, du groupe Lambert dans la banque, de René Meyer pour les entreprises de prospection pétrolière qu'il créait, de Roger Goetze, président de la SN Repal, pour reprendre la direction générale de cette entreprise pendant la période où elle put rester française, malgré l'indépendance algérienne, enfin de Thomson dans l'électronique.
En restant dans le domaine public, Georges Combet, directeur général de Gaz de France, m'avait aussi sollicité au temps de ma présence au cabinet de J.M. Louvel. Jean Monnet avait tenté de m'attirer dans l'administration de la CECA. Plus tard Jean-Marcel Jeanneney, alors ministre de l'industrie, m'avait proposé d'être son candidat, pour la nomination d'un commissaire français, lors d'un renouvellement des membres de la Commision de Bruxelles.
Ma persévérance aux Charbonnages tenait-elle aux garanties que m'offrait ma position de fonctionnaire en service détaché? Mais à l'époque des trente glorieuses, les craintes pour la continuité de l'emploi n'existaient guère. Je pense que cette persévérance traduisait essentiellement mon goût pour le service public, quelles que soient ses servitudes, et aussi un véritable attachement à la population des mineurs, dont j'appréciais, sous leurs dehors frustes, le goût du travail et le grand courage dans les coups durs.
J'ai cependant apprécié de diversifier mes activités et centres d'intérêt. Dans le domaine professionnel, j'ai évoqué les missions et présidences qui me sont échues, et que j'ai toujours volontiers acceptées.
J'ajouterai que mes fonctions professionnelles, ainsi que les diverses présidences que j'ai exercées, m'ont procuré de fréquents contacts avec les hommes politiques. J'ai toujours été intéressé par les situations et les problèmes politiques. Mais je n'ai pas été tenté de faire moi-même de la politique active, n'ayant pas de goût pour les compromis, voire les compromissions, qu'elle implique trop souvent.

Publié sur le web avec l'autorisation de l'auteur
Publié dans Mines Revue des Ingénieurs, Septembre/octobre 2012, #463 :
Paul Gardent, entré à l'X en septembre 1939, y fit une première année allégée suivie d'un passage à l'École d'Artillerie de Fontainebleau, interrompu par l'invasion allemande de mai 40. Après la défaite et un début de mise en place des Chantiers de Jeunesse en Haute Savoie, démobilisé en novembre 40, il passa sa 2ème année à l'X devenue civile et repliée à Lyon. Sorti dans le Corps des Mines, il fit une première année normale à l'École des Mines à Paris. L'instauration du Service du Travail Obligatoire en juin 43 risquant d'envoyer ses élèves dans les usines allemandes, l'École organisa une 2ème année à l'École des Mines de Saint-Étienne en alternance, quatre jours au fond (les mineurs étant dispensés de STO), deux jours à l'École.
Affecté à Valenciennes en juillet 44, en pleine débâcle allemande, il y exerça les tâches normales de surveillance des exploitations minières, avec toutes les péripéties de cette période (épuration, nationalisations, grèves quasi-insurrectionnelles en 46 et 47 après le départ des ministres communistes du gouvernement, etc.) plus quelques tâches non charbonnières, comme professeur de physique à l'École des Mines de Douai. Début 1950, J.M. Louvel, ministre de l'Industrie, l'appela à son cabinet, pour y suivre les affaires énergétiques, puis entamer les discussions préalables à la mise en place de la Communauté Européenne Charbon-Acier. En mars 1952, il profita d'un remaniement ministériel pour entrer aux Charbonnages, où il allait rester près de 30 ans. Il y organisa, à Paris, la Direction des Études Générales et du Marché Commun. À l'automne 1958, tout jeune marié avec Janine, il partit en Lorraine y prendre la Direction des études générales et des services financiers. En juillet 63, Paul retourna dans le Nord et devint, le 1er janvier 1964, directeur général du bassin... Et c'est en mai 1968 que Paul devint Directeur Général des Charbonnages, responsable opérationnel de l'ensemble du Groupe ; il le resta jusqu'à septembre 1980.
Cette période a vu la production nationale de charbon culminer à 60 Mt/an vers 1960, pour retomber à 20 Mt en 1980, les effectifs correspondant passant de 200 000 à 60 000. Le combat d'arrière-garde du charbon français était perdu d'avance face à la concurrence du fuel et du charbon importé. Il n'y avait qu'une solution : réduire la production de charbon au niveau des débouchés économiquement possibles, tout en minimisant l'impact social des fermetures de mines par la reconversion ou la retraite des mineurs. C'est cette tâche délicate que Paul mena de façon exemplaire. Et avec quels handicaps !
De sorte qu'il inspirait à tous ses interlocuteur, mineurs, syndicalistes, fonctionnaires, un très grand respect. Et lui s'efforçait d'ajuster ses décisions aux capacités, caractères et souhaits de chacun. D'où l'appréciation suivante de Jean Couture, président des HBNPC, lors de la prise de fonction de Paul : «Je ne sais comment fait Gardent, mais il fait valser tout le monde, et tout le monde semble content».
En 1980, la campagne présidentielle battait son plein. François Mitterrand voulait consolider son soutien communiste en acceptant sans trop y croire leur projet de relance de la production charbonnière à 30 Mt/an, alors que le président Giscard d'Estaing et son ministre de l'industrie André Giraud voulaient au contraire la réduire de 20 à 10Mt/an. Pour manifester eux aussi leur souci de l'avenir des charbonnages français, ces derniers décidèrent d'en changer le directeur général... Paul Gardent fut nommé au tour extérieur Conseiller d'État en service ordinaire et reçut la cravate de la Légion d'Honneur en reconnaissance de ses services exceptionnels. Il accepta ce changement avec sérénité : «Vers la soixantaine, il n'était pas mauvais de quitter des responsabilités de gestionnaire pour des activités de réflexion et de conseil».
Pourquoi Paul est-il resté si longtemps aux Charbonnages ? Il a donné lui-même la réponse : «On pourrait se demander pourquoi je suis resté pourtant, imperturbablement et si longtemps, dans le secteur charbonnier public. Ce n'est pas que les occasions d'en sortir m'aient manqué... Je pense que cette persévérance traduisait essentiellement mon goût pour le service public, quelles que soient ses servitudes, et aussi un véritable attachement à la population des mineurs dont j'appréciais, sous leurs dehors frustes, le goût du travail et le grand courage dans les coups durs».
Paul s'habitua aux us et coutumes du Conseil d'État, à l'intendance Spartiate pour quelqu'un habitué aux moyens des Charbonnages. Il compléta son activité par des tâches compatibles avec son nouveau métier, comme la présidence des conseils de perfectionnement des Écoles des Mines de Paris et St-Étienne (1980) et celle de la CIREA (Commission Interministérielle des Radio-Éléments Artificiels -1981).
Après sa retraite en 1986, Paul continua à intervenir dans différents groupes de travail, ou comités d'études ; il apprécia particulièrement sa participation à l'éphémère «Collège de la prévention des risques technologiques», créé par Michel Rocard en 1989, dont il fut le premier président. Composé de hauts fonctionnaires, de scientifiques et de représentants de la société civile, il devait donner son avis sur tous les types de risques technologiques, soit sur demande du gouvernement, soit par autosaisine, avec possibilité de publier ses avis. Ceux-ci comportant fatalement d'éventuelles critiques des politiques publiques, cela conduisit à sa suppression par décret en 1996, sans concertation préalable. Pendant plusieurs années, il présida également l'Amicale des Ingénieurs du Corps des Mines, dont les groupes de travail réfléchissent à tous les problèmes relatifs à l'industrie en France et aux actions de l'Administration dans ces domaines.
Lourdement handicapé à la suite d'un AVC, Paul termina ses jours alité à l'hôpital Sainte Périne. Mais tous ceux qui ont travaillé avec lui garderont, avec gratitude, le souvenir d'un grand mineur et d'un grand patron ayant réussi, sans drame, le repli en bon ordre d'une industrie condamnée. Ils expriment leur profonde sympathie à Janine son épouse, qui, en mettant au service des Charbonnages ses talents d'architecte, a partagé au jour le jour les soucis professionnels de Paul, à Philippe leur fils et à tous les siens.
Jacques Petitmengin (P49)
Ingénieur Général des Mines
Président du Directoire de la Société Chimique des Charbonnages (1967-1980)
Directeur Général des Charbonnages de France (1980-1982)